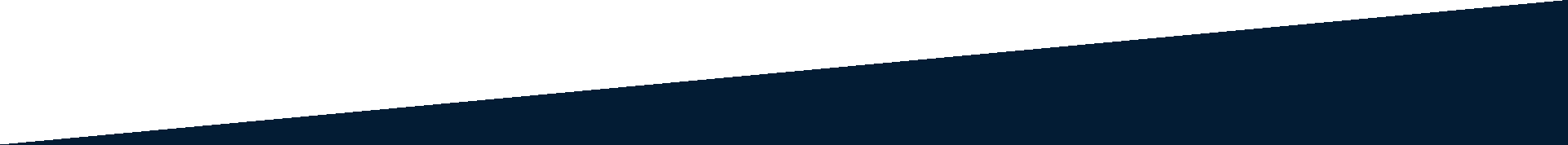1er mars 2011
ÉDITION MISE À JOUR
Rédigé par : Vic Mollot, Winnipeg, Canada. Recherches effectuées par : Pascal Pierre, généalogiste, Trouans, France, et Vic Mollot, Winnipeg, Canada.
(Les recherches généalogiques révèlent sans cesse de nouvelles informations. Si vous possédez une édition antérieure de ce document, veuillez la jeter. Cette dernière édition est beaucoup plus détaillée et complète.)

Histoire de la famille Mollot (Liens rapides)
Partie 1 - Un voyage au cœur de l'arbre généalogique des Mollot et Benoît Partie 2 - Événements et circonstances Partie 3 - Événements et circonstances (suite) Partie 4 - Événements et circonstances (suite) Partie 5 - Origine du nom Mollot Partie 6 - Les racines des Mollot Partie 7 - Chronologie Partie 8 - Chronologie (suite) Partie 9 - Chronologie (suite) Partie 10 - Chronologie (suite) Partie 11 - Chronologie (suite) Partie 12 - Château Blandin Partie 13 - Tour de France 2008 Partie 14 - Les racines des Benoît Partie 15 - Le mariage Mollot-Benoît Partie 16 - Le mariage Mollot-Benoît (suite) Partie 17 - Canada Partie 18 - Décès de Fortune Mollot Partie 19 - Décès de Léopoldine Mollot Partie 20 - Conclusion
DÉDICACE : à ma femme Lucille
Je souhaite dédier ce document à mon épouse Lucille pour son soutien indéfectible à ma passion pour la recherche de nos racines familiales. Ces quinze dernières années, ces recherches nous ont conduits à de nombreuses reprises en France, où nous avons passé de longs séjours dans divers services d'archives et dans de petits villages et villes à la recherche de nos ancêtres. Je dois dire que ces recherches ont été extrêmement fructueuses et enrichissantes. L'engagement et la contribution de Lucille nous ont également permis de mener à bien d'autres projets familiaux. Ces activités n'auraient pas été possibles sans le soutien indéfectible de ma chère épouse.
Août 2008 à Blandin, France.
Vic et Lucille Mollot sont reconnus pour avoir organisé le Tour de France.
Partie 1 UN VOYAGE DANS L'ARBRE GÉNÉALOGIQUE MOLLOT ET BENOIT perspective de notre ascendance.
L'étude de l'histoire familiale est toujours intéressante, mais cette histoire est encore plus fascinante car elle relate l'époque, les événements, les succès et les échecs de nos ancêtres. Une solide connaissance de l'histoire familiale enrichit notre compréhension de nous-mêmes. Une famille, une société, qui connaît son passé est mieux à même de contribuer à son avenir. Nous sommes profondément reconnaissants de tout ce que l'on sait de nos ancêtres, notamment de Fortuné Louis Joseph Mollot et de sa famille, grâce à ses mémoires. Nous possédons également de nombreux objets, photos, tableaux, etc. Notre collection comprend aussi de nombreux documents et lettres de la famille de Léopoldine Benoit, l'épouse de Fortuné. Nous avons même des lettres datant du début des années 1860, transmises de génération en génération. C'est incroyable tout ce que nous avons pu découvrir sur nos ancêtres. À ce jour, nous avons retracé l'histoire de notre famille jusqu'en 1613, soit 395 ans, quatre siècles ou treize générations, grâce à des certificats et des registres contenant noms, dates de naissance/baptême, mariages, professions, décès, etc. Dans les différents hameaux, villes et villages, il est remarquable de pouvoir encore aujourd'hui visiter les maisons, les églises et les commerces où nos ancêtres ont vécu. Nous tenons également à exprimer notre gratitude à de précieux amis en France : M. Pascal Pierre, notre chercheur et généalogiste, originaire de Trouans, berceau de la famille Mollot ; Yves et Martine Marquié, de Lyon ; et Michel et Arlette Auclerc, propriétaires actuels du Château de Molinière, anciennement Château Blandin, demeure de mon arrière-grand-père. Tous ont manifesté un vif intérêt pour notre patrimoine familial et ont contribué de manière inestimable à la recherche, en y consacrant leur temps et leurs efforts.

Nous avons également la grande chance que les archives familiales en France existent encore, ayant survécu à des événements terribles tels que les guerres de Religion du XVIe siècle, la Révolution française de 1789-1793, les guerres napoléoniennes du XIXe siècle et les deux guerres mondiales du XXe siècle. Malheureusement, lors de ces conflits, de nombreuses archives ont été détruites.
Partie 2 Événements et circonstances
Les événements et circonstances suivants, survenus en Amérique du Nord et en France, ont permis de faire des découvertes très intéressantes qui ont considérablement enrichi notre généalogie familiale. Durant l'été 1988, notre fils Marc participait à un échange étudiant organisé par le Rotary International. Le hasard a voulu qu'il soit en séjour à Lyon chez une famille française, Yves et Martine Marquié, originaires de la ville natale de Fortuné Mollot. La famille Marquié s'est passionnée pour les origines de Marc, lisant les mémoires de Fortuné Mollot et lui faisant découvrir Lyon et ses environs. Ils se sont même rendus au village de Blandin et ont visité le château du même nom. En 1993, Lucille et moi sommes allées en France et avons eu l'occasion de rencontrer la famille Marquié. Yves était tellement fasciné par l'histoire familiale qu'il a retranscrit le manuscrit de 93 pages des mémoires de Fortuné Mollot afin que nous puissions tous le lire plus facilement. L'écriture européenne est parfois difficile à déchiffrer pour les Nord-Américains. Depuis, la famille Marquié nous a rendu visite au Canada et nous avons tissé des liens familiaux très étroits. Ces expériences nous ont permis de mieux apprécier la richesse de notre histoire familiale et nous ont motivés à explorer nos racines.

Yves et Martine Marquié avec Marc Mollot, août 2008, 20 ans après l'échange étudiant de Marc.
Un autre événement s'est produit en septembre 1999. Lucille et moi étions en visite à Châlons-en-Champagne avec nos cousins Marcel et Louise Mollot. Nous cherchions le village de « Chouan-le-Grand », orthographié ainsi dans la transcription des Mémoires de Fortuné. Nous étudiions attentivement une carte dans la cathédrale de Châlons-en-Champagne, sans succès. Une bénévole âgée, responsable de la paroisse, est venue à notre secours, expliquant qu'elle ne connaissait aucun village du nom de « Chouan ». Lui précisant qu'il se situait sur la rivière Lhuitre, elle a supposé que nous cherchions probablement Trouan-le-Grand. Après avoir examiné les mémoires manuscrites et la transcription sur laquelle nous travaillions, elle nous a montré que dans cette dernière, un « T » avait été écrit par erreur comme un « C », créant ainsi le village inexistant de « Chouan-le-Grand ». Cette dame nous a sauvés car elle nous a mis sur la route de « Trouan le Grand » et sur le bon chemin dans nos recherches généalogiques.
Nous devons cette découverte au petit village de Trouan-le-Grand (207 habitants en 1999), berceau de la famille Mollot, à notre cousine Louise Mollot qui, grâce à sa persévérance avec la carte, nous a menés. Ce jour-là, nous avions presque renoncé à trouver Trouan-le-Grand, mais grâce à la ténacité de Louise, par un beau samedi après-midi d'été, nous avons pu rejoindre ce village typique et paisible. Nous y avons notamment visité une ancienne église Saint-Georges du XIIIe siècle, aujourd'hui abandonnée. Quelle expérience formidable ! À l'époque, nous étions loin de nous douter que nos ancêtres étaient originaires de Trouan-le-Grand depuis 1613 ! D'après les mémoires de Fortuné Mollot, nous savions seulement que la famille de son père était originaire de ce village.
Un événement qui a soudé notre grande famille a eu lieu en juillet 2002. Nous avons organisé une réunion de famille Mollot de trois jours à Winnipeg, au Manitoba, ville où nos ancêtres Fortuné et Léopoldine ont émigré de France en 1892. Quelque 160 membres de la famille, venus de partout au Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, se sont retrouvés et, pour beaucoup d'entre nous, ce fut l'occasion de faire de nouvelles rencontres. Ce week-end fut une grande réussite pour tous.
En 2004, avant notre départ pour la France en août de cette année-là, Lucille et moi avons reçu un appel de nos amis Michel et Arlette Auclerc, les actuels propriétaires du Château Blandin. Ils nous ont proposé de nous retrouver non pas à Blandin, mais dans un petit village nommé Lhuitre (261 habitants en 1999), près de Châlons-en-Champagne. Michel nous a dit : « Je veux que vous rencontriez des gens là-bas, vous les trouverez très intéressants ! » Nous avons accepté sans nous douter de ce qui nous attendait. Le 31 août, nous avons pris la route de Bruxelles, en Belgique, pour Lhuitre, en France. Nous étions loin de nous douter que Lhuitre n'était qu'à quelques kilomètres du village de Trouans, où nous étions allés en 1999 avec nos cousins Marcel et Louise Mollot. Là, nous avons retrouvé nos amis de Blandin dans la résidence d'été d'un couple de personnes âgées, René et Yolande Rosez. Après environ six bouteilles de vin français et un repas à six plats qui dura, à la française, plusieurs heures agréables, nous avons découvert comment Michel et Arlette avaient fait la connaissance de Yolande et nous avaient invités à les rencontrer à Lhuitre.
Voici l'histoire ! Quelques mois auparavant, une amie de Yolande se rendait à Blandin (200 habitants en 1999) pour rendre visite à des amis. Intriguée, Yolande lui demanda d'aller au château pour se renseigner afin de savoir si des membres de la famille Mollot y vivaient encore. Michel et Arlette Auclerc indiquèrent à leur amie que la famille Mollot, ancienne propriétaire du château, avait disparu depuis plus d'un siècle… environ 110 ans… qu'en réalité, elle avait vendu le château et immigré au Canada en 1892. Cependant, Michel expliqua à l'amie de Yolande qu'ils connaissaient des descendants Mollot au Canada et que, par une heureuse coïncidence, ils seraient bientôt en France pour des vacances d'automne. Michel et Arlette Auclerc échangèrent leurs coordonnées avec l'amie de Yolande, qui les transmit ensuite à cette dernière. Une semaine plus tard environ, les familles Auclerc et Rosez organisèrent une rencontre pour nous tous dans le petit village de Lhuitre, en France, à quelques kilomètres seulement de Trouans, berceau de la famille Mollot, comme nous l'avons découvert par la suite. C'est ainsi que nous fûmes amenés à la connaissance de la famille Rosez. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Ce n'était que le début !
Troisième partie : Événements et circonstances (suite)
Après le dessert et, bien sûr, un autre verre de vin, Yolande nous a montré de magnifiques photos du Château Blandin, ainsi que de nombreuses lettres et cartes postales de Fortuné Mollot et de sa tante Françoise Collet, née Mollot, et d'autres parents. Yolande avait conservé ces objets après les avoir hérités de ses parents, Gabriel et Suzanne Gombault de Lhuitre. Ces lettres, photos et cartes postales laissaient entrevoir un lien possible entre nos familles ! L'énigme fascinante qui se présentait à nous était la suivante : où, dans notre arbre généalogique, se situait ce lien ? À cette époque, la généalogie de nos deux familles n'était pas très développée et nous ne pouvions remonter que sur quelques générations. Cependant, Yolande possédait également des documents attestant l'existence d'une ancêtre nommée Marie Angélique Mollot. Notre généalogie familiale s'arrêtait à Pierre Mollot, que Fortuné Mollot avait mentionné comme son grand-père dans ses mémoires. Le lien possible semblait donc se situer autour de Marie Angélique Mollot dans l'arbre généalogique de Yolande et de Pierre Mollot dans le nôtre.
Le lendemain, Michel et Arlette Auclerc partirent, mais nous restâmes quelques jours de plus chez les Rosez à Lhuitre pour visiter divers sites historiques des environs. Dans l'espoir d'établir nos liens familiaux, nous rendîmes visite à M. Jacques Caillot, maire du village voisin de Trouans, berceau de la famille Mollot. Il se souvint que des familles Mollot avaient vécu dans la région autrefois, mais qu'il n'y en avait plus aucune récemment. Curieusement, lors de notre visite à son bureau, M. Caillot nous raconta une anecdote intéressante. Il se rappelait que, dans son enfance, vivait à Trouans un homme du nom d'André Mollot. André avait perdu une main (la gauche ?) pendant la Première Guerre mondiale. Le grand-père de M. Caillot avait lui aussi perdu une main (la droite ?). Chaque automne, les deux hommes allaient ensemble, en riant, au magasin pour acheter une paire de gants pour l'hiver.
M. Caillot s'intéressait vivement aux différents documents d'archives de Yolande et aux mémoires de Fortuné. Il indiqua que la mairie conservait de nombreux documents (registres de naissance, de mariage et de décès) concernant les habitants de Trouans, remontant à plusieurs siècles. Il précisa également que le village de Trouans avait recours aux services de M. Pascal Pierre, architecte et généalogiste, et qu'il lui demanderait d'effectuer des recherches sur l'histoire de notre famille. Quelle découverte ce fut pour nous, comme vous le verrez plus loin dans ce document !
Un autre événement qui a considérablement enrichi nos connaissances sur les origines de Léopoldine Mollot, née Benoit, s'est produit en septembre 2004. Lucille et moi avons eu l'occasion de visiter la petite ville gallo-romaine de Dié, en France, située dans les Alpes. C'est à Dié que l'on retrouve les origines de la famille Benoit. À l'office de tourisme, nous avons indiqué que mes arrière-grands-parents, les Benoit, étaient les fondateurs du « Martouret », une station thermale et un centre de soins situé aux portes de Dié. L'agent touristique nous a immédiatement suggéré de rencontrer un historien local qui serait ravi de nous renseigner sur le « Martouret ». L'après-midi même, après la visite du « Martouret », nous avons rencontré cet historien, Christian Rey. Le lendemain, Christian nous a présentés au directeur du musée de la ville, Jacques Planchon. Il nous a retracé toute l'histoire du « Martouret », fondé par le père de Léopoldine, le docteur Alexandre Benoit. Au musée, nous avons examiné une exposition illustrant le procédé thermique utilisé par le docteur Benoit pour soigner les patients atteints d'arthrite et de rhumatismes. Depuis, nous avons échangé des informations avec M. Rey, qui a également écrit et publié des articles dans une revue provinciale sur l'histoire de Fortuné et Léopoldine, du Martouret et de la famille Benoit.
Nos amis de Die nous ont cependant indiqué que pour approfondir nos connaissances sur la famille Benoît/Croze, il nous fallait nous rendre à Privas, en Ardèche, où se trouvent les Archives départementales de l'Ardèche. Le lendemain, nous partons pour Privas. Nos découvertes furent à la hauteur de nos espérances ; elles nous fascinèrent. Nous y trouvons des documents relatifs à la famille de la mère de Léopoldine (les familles Croze et Azémar). De plus, un généalogiste travaillant dans ce centre d'archives nous fournit les titres d'ouvrages historiques et d'autres documents retraçant l'arbre généalogique complet de la famille Azémar, dont est issue Léopoldine Mollot, née Benoît. Quelle découverte majeure ! Les Azémar étaient une famille très influente, issue de l'aristocratie et de la noblesse françaises. Durant mon enfance, plusieurs membres de ma famille m'avaient confié que la famille de Léopoldine était de ce milieu, mais sans preuves concrètes. Les documents obtenus ce jour-là confirmaient désormais ces récits. Nous pouvions désormais facilement retracer l'ascendance de Léopoldine jusqu'à la famille Azémar !
À notre retour chez nous cette année-là (2004), j'ai commencé à fouiller dans tous les documents en ma possession et, à ma grande surprise, j'ai trouvé des lettres et des cartes postales oblitérées de Lhuitre et de Trouans, ainsi que d'anciennes photos sur verre d'une église que nous avons identifiée plus tard comme étant l'église Sainte-Tanche de Lhuitre. Cela n'a fait qu'attiser davantage notre curiosité et notre intérêt.
En septembre 2005, nous nous sommes retrouvés à Lhuitre, en France, avec Yolande et René Rosez et M. Pascal Pierre, notre généalogiste. Le fait que Pascal Pierre ait grandi à Trouans, berceau de la famille Mollot, était une aubaine pour nous, car il pouvait accéder aux documents pertinents conservés aux archives municipales de Trouans. Entre-temps, M. Pascal Pierre avait approfondi ses recherches et élaboré un arbre généalogique détaillé et complet des Mollot, qu'il nous a présenté.
Partie 4
Événements et circonstances (suite)
Il a également obtenu un grand nombre d'actes de naissance, de mariage et de décès concernant plusieurs de nos ancêtres. Cela nous a permis d'obtenir des informations sur leurs professions, leurs parents, leurs parrains et marraines, etc. : une quantité incroyable de données sur notre histoire familiale ! Pascal Pierre nous explique ses recherches. L'arbre généalogique remonte désormais à l'année 1613, date de naissance d'un certain Georges Mollot à Trouans. Pour vous donner une idée de la quantité de données, on nous a remis quatre grandes feuilles de papier imprimées d'environ 90 cm x 3,60 m, contenant au total 1 200 noms de notre arbre généalogique. Et, bien sûr, nous avons établi le lien entre nos ancêtres et ceux de Yolande ! Pierre et Marie Angélique Mollot remontent à six générations. Ils étaient frère et sœur dans une famille de sept enfants ; leurs parents étaient Georges Mollot et Sire Beaurieux. Nous pourrions maintenant célébrer nos retrouvailles familiales avec un repas du midi, commençant par une eau-de-vie (une liqueur distillée à base de prunes), suivi d'un somptueux déjeuner de trois heures et demie, agrémenté, bien sûr, de quelques bouteilles de vin français. La vie à la française, c'est parfois difficile à supporter !

L. to R. Yolande Rosez, Pascal, Vic Mollot and René Rosez.
Depuis, j'entretiens d'excellentes relations de travail avec M. Pascal Pierre, qui ne cesse de découvrir de nouvelles informations sur nos origines familiales. Nous avons également intégré à la base de données les noms des générations les plus récentes. En consultant le site web Mollot.ca, il est possible de retracer notre histoire familiale jusqu'en 1613.
Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que M. Pierre, qui a découvert une grande partie de ces informations sur notre famille, est né et a grandi juste en face de l'église Saint-Georges de Trouans, le lieu où, à ce jour, on retrouve les traces les plus éloignées de notre famille. Le monde est vraiment petit ! Sans tous ces événements et circonstances, la richesse de nos connaissances sur l'histoire de notre famille ne serait pas aussi grande. Nous sommes, en tant que famille, extrêmement chanceux.
Non seulement nous avons accumulé une grande quantité de connaissances sur nos ancêtres, mais les événements et circonstances susmentionnés nous ont donné l'occasion d'organiser un circuit en bus guidé de douze jours, surnommé le « Tour de France » de Mollot, en août 2008.

Aug 2008 Tour de France at Eglise St. Georges, Trouans, France
Le voyage a réuni une quarantaine de membres de notre famille, venus du Canada, des États-Unis et de Nouvelle-Zélande. Grâce à nos contacts et amis en France, nous avons pu explorer nos racines ancestrales dans différentes régions, notamment à Trouans, Lhuitre, Châlons-en-Champagne, Lyon, Die et enfin Blandin. Nous avons été extrêmement bien accueillis dans tous les villages et villes visités. Ce fut une expérience familiale incroyable et inoubliable !
Je tiens également à remercier nos cousins John et Cécile (née Thériault) Mestan, qui m'ont incité, il y a quelques années, à entreprendre des recherches généalogiques. En 1988, j'ai eu l'occasion d'assister à un congrès à Orlando, en Floride, où résident les Mestan. J'en ai profité pour leur rendre visite… et quelle visite mémorable ! Outre leur grande chaleur et leur hospitalité, j'ai découvert une magnifique demeure ornée de nombreux objets de famille, dont les portraits de Fortuné accrochés aux murs. Au fil des ans, Cécile et moi avons échangé des objets ayant appartenu à nos ancêtres. Nos familles sont devenues très proches et apprécient de se retrouver.
Nous adressons également nos plus sincères remerciements à Louise Mollot (épouse de Marcel Mollot) qui, depuis quinze ans, compile, développe et met à jour avec diligence toutes les données de notre famille dans un logiciel de généalogie. Son dévouement, qui lui a permis de consacrer d'innombrables heures, a été inestimable pour la préservation de l'histoire familiale.
Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude à plusieurs personnes qui ont précieusement conservé de nombreux documents familiaux, lettres, souvenirs, photos et tableaux, et les ont transmis de génération en génération. Outre Fortuné et Léopoldine, je pense notamment à Gabrielle, leur fille aînée, avec qui ils ont parfois vécu à Winnipeg, et à ma tante Alice Mollot, qui portait un grand intérêt à nos racines et traditions familiales. Toutes deux ont préservé l'histoire de notre famille. Aucune des deux ne s'est mariée. Toutes deux étaient professeurs de musique et se rendaient fréquemment en France.
Sans aucun doute, l'une de mes plus grandes sources de motivation pour explorer notre héritage a été ma tante Alice Mollot, envers qui je serai toujours redevable. Dès ma plus tendre enfance, elle nous racontait sans cesse des histoires sur la vie et l'époque de Fortuné et Léopoldine Mollot. À de nombreuses reprises, lors de réunions de famille, ma tante Alice nous montrait ses photos de Blandin et du château. Dès 1953, elle avait voyagé en France avec mon oncle Barney et ma tante Gil Mollot. « Un jour, vous devez absolument aller visiter le château de Blandin », disait-elle. Une autre expérience fascinante fut la visite de son appartement à Winnipeg. C'était comme un véritable musée d'objets de famille, avec des tableaux et des photos accrochés aux murs, ainsi que des meubles anciens, dont certains avaient été rapportés de France par Fortuné et Léopoldine.
Avant son décès en 1997, tante Alice m'a légué la majeure partie de la correspondance et des documents familiaux qu'elle avait conservés.
Je manquerais également à mon devoir si je ne mentionnais pas mes parents, John et Blanche Mollot, mes oncles et tantes, Archie et Aline, Barney et Gil, ainsi que Louis et Eleanor, frères de ma tante Alice, qui nous a transmis la fierté de notre héritage familial. Dès notre plus jeune âge, lors des réunions de famille, mes parents, oncles et tantes nous racontaient d'innombrables histoires. Nous avons découvert nos grands-parents et arrière-grands-parents. Nous avons également appris des choses grâce aux Mémoires de Fortuné et aux tableaux qui ornaient nos maisons. La famille perpétuait des traditions telles que la préparation des quenelles et du gâteau au rhum à Noël. Ce sont des recettes lyonnaises, transmises de génération en génération. Les quenelles sont des quenelles de poisson à la sauce onctueuse, et le gâteau au rhum, un délicieux trifle lyonnais.
Toutes ces expériences ont éveillé ma curiosité et m'ont incitée à en apprendre davantage sur mes ancêtres.
De plus, je suis très reconnaissant envers de nombreux autres parents qui ont partagé diverses photos, documents, etc., qui m'ont fourni des informations pour ce traité.
L'un des objectifs de ce document est de partager la richesse des informations que nous possédons sur nos racines familiales les plus intéressantes et fascinantes.
Partie 5 Origine du nom Mollot
Certains indices suggèrent que le nom de famille Mollot pourrait avoir une origine au IVe siècle en Auvergne, région française située dans le centre de la France. Les Auvergnais étaient originaires de Gaule. Une ancienne famille du nom de Mollot était établie en Auvergne, où elle possédait des terres, des domaines et un manoir. Comme pour la plupart des noms de famille, de légères variations orthographiques sont apparues au cours des premiers siècles, probablement en raison d'appartenances politiques ou religieuses. Nombre de ces variations étaient dues à des erreurs, d'autres étaient intentionnelles. Par ailleurs, il arrivait souvent qu'une personne dicte sa version phonétiquement à un scribe, un prêtre ou un greffier. Les préfixes et suffixes variaient également. C'est pourquoi on trouve des variantes du nom Mollot : Mollet, Mallot, Malo et Molot, entre autres. La présente recherche porte sur la variante « Mollot » du nom de famille.
LE NOM MOLLOT
Le nom Mollot n'est pas exclusivement français, bien qu'il s'agisse d'un nom de famille français. D'après les recherches menées à ce jour, on le trouve en Angleterre et en Russie. Aux États-Unis, et plus particulièrement dans l'État de New York, une importante famille juive orthodoxe Mollot a immigré de Minsk, en Russie. Dans l'un de leurs bulletins familiaux, ils ont tenté d'établir un lien entre leurs origines et les soldats de la Grande Armée de Napoléon Bonaparte lors de l'invasion de la Russie en 1812 ! Historiquement, ce ne serait pas la première fois qu'une guerre donne naissance à un nom dans un nouveau pays. Il est indéniable que l'invasion désastreuse de la Russie par Napoléon a laissé derrière elle de nombreux soldats français.
Il existe également une autre branche de Mollot, actuellement implantée au Colorado. L'origine de ses racines est inconnue.
Une troisième famille Mollot vit dans la province de Québec, dans la région d'Ottawa. En les contactant, nous avons appris que cette branche est originaire d'une région du nord-est de la France, tout près de celle où notre famille a ses racines.
Cependant, des trois branches Mollot mentionnées ci-dessus en Amérique du Nord, nous n'avons jusqu'à présent pas pu les relier à nos ancêtres qui remontent maintenant à l'année 1613.
D'après les annuaires téléphoniques et internet, nous savons qu'il existe de nombreuses familles Mollot en France. Avons-nous des parents éloignés là-bas ? Deux importants envois postaux ont été effectués ces douze dernières années auprès de familles Mollot à travers la France. Nous avons pu entrer en contact avec une vingtaine d'entre elles. Cependant, nous n'avons encore établi aucun lien concret, à l'exception de René et Yolande Rosez. Comme indiqué précédemment, Yolande est apparentée à nous six générations auparavant.
Une autre raison pour laquelle nous n'avons pas beaucoup de parents éloignés en France aujourd'hui est que, pendant deux générations consécutives au XVIIIe siècle, notre arbre généalogique a connu une faible descendance. En consultant notre arbre généalogique complet, vous constaterez que Pierre Mollot et son épouse n'ont eu que deux enfants. Leur aînée, Françoise, a épousé le capitaine Collet, mais ils n'ont pas eu d'enfants. Leur second enfant, Louis Mollot, s'est marié plus tard (à 53 ans) avec Thérèse Annequin et a eu un fils, Fortuné, qui a immigré au Canada, et une belle-fille, Thérèse Pauline. Ainsi, la majeure partie de nos ancêtres français remonte à avant 1700.
Partie 6 Les racines de Mollot
Nos racines Mollot remontent à 400 ans, dans un petit village nommé Grand Trouan, devenu ensuite Trouan-le-Grand, puis Trouans, dans le département de l'Aube, en région Champagne. Trouans se situe à environ 150 km à l'est de Paris, sur la rivière Lhuitrelle, ou à 40 km au sud-ouest de Châlons-en-Champagne. Avant sa fusion en 1973, Trouan-le-Grand se trouvait sur la rive nord de la Lhuitrelle et Trouan-le-Petit sur la rive droite. Historiquement, aux XIVe et XVe siècles, la Lhuitrelle marquait la frontière entre les territoires des puissants ducs de Bourgogne et les royaumes de France. C'est à Jeanne d'Arc qu'on doit l'unification, en 1477, de ces deux régions par les Français, permettant ainsi de fonder la France, incluant l'ancien royaume de Bourgogne, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Autrefois très boisée, la région de Trouans est aujourd'hui une zone agricole fertile où l'on cultive notamment la pomme de terre, le tournesol et les céréales. L'agriculture y est devenue l'activité principale. Le village de Trouans compte aujourd'hui environ 200 habitants. La région évoque les prairies canadiennes ou le Midwest américain.

Origines des Mollot en France. Aux XVIe et XVIIe siècles, la plupart des familles Mollot étaient des agriculteurs. Nos recherches archivistiques ont révélé qu'autrefois, de nombreuses familles Mollot étaient également présentes dans les villages et communes environnants. Outre Trouan-le-Grand, on trouvait des familles Mollot à Dosnon, Poivres, Grandeville, Lhuitre et Trouan-le-Petit, tous situés dans un rayon de 10 kilomètres. Aujourd'hui, le nom de Mollot a quasiment disparu de la région, mais certaines familles, comme les Noblet, les Gombault et les Milliat, dont les racines maternelles remontent à plusieurs générations, y vivent encore. Un arbre généalogique très complet et détaillé a été établi, retraçant ces liens avec la famille Mollot de 1613 à nos jours.
Comme mentionné précédemment, la Champagne est la région où nous pouvons retracer avec précision nos origines les plus anciennes. C'est une province très riche, pittoresque et diversifiée du nord-est de la France. Le département de l'Aube fait partie de cette région. La position stratégique de la Champagne en a fait un champ de bataille pendant des siècles, à chaque invasion de la France. Nos ancêtres Mollot ont vécu au cœur des conflits et des guerres à travers les siècles : la guerre de Cent Ans (1337-1453), la guerre de Trente Ans (1618-1648), la guerre franco-prussienne (1870-1871) et les deux guerres mondiales du XXe siècle.
Il est également intéressant de noter que Clovis, premier roi de France, franc et considéré comme le fondateur du pays, fut couronné en 507 après J.-C. dans la magnifique cathédrale de Reims, l'une des principales villes de la région. Tout au long de l'histoire de la France, les rois furent couronnés à Reims. Le nom « France » signifie littéralement « pays des Francs » en latin.
Dès l'époque de l'empereur Charlemagne au IXe siècle, la Champagne était l'une des grandes régions d'Europe, une riche zone agricole également célèbre pour ses foires.
À la lecture de ce document, vous comprendrez le lien étroit qui existe entre l'économie de la région et la façon dont nos ancêtres gagnaient leur vie au fil des siècles : agriculture, commerce de vêtements, viticulture et production du vin mousseux appelé champagne.
Le relief de la région est très varié : certaines parties sont plates, d’autres vallonnées, certaines boisées, d’autres encore de vastes plaines. Certaines zones sont très fertiles et on y cultive diverses céréales, ainsi que des pommes de terre, du maïs et des betteraves sucrières. Cependant, la région est mondialement connue pour sa magnifique Côte des Blancs, un ensemble de collines calcaires couvertes de vignobles luxuriants, où est produit son célèbre vin mousseux, le Champagne, qui y a vu le jour ! La Route touristique du Champagne, qui inclut la Côte des Blancs, est l’une des régions les plus pittoresques de Champagne et de France. On comprend aisément pourquoi ce vin mousseux a donné son nom à la région que nous appelons Champagne ! En français, la région s’appelle « la Champagne » et le vin mousseux, « le Champagne ».
Les principales villes commerciales de cette région sont Reims, Épernay, Châlons-en-Champagne et sa capitale, la ville médiévale de Troyes.
Chronologie de la partie 7
LES DÉBUTS DE NOTRE FAMILLE MOLLOT EN AMÉRIQUE DU NORD
Fortuné Louis Joseph Mollot (1845 – 1924) (8) et son épouse, Marie Anaïs Léopoldine Benoit (1852 – 1944) (10), ont immigré au Canada le 25 août 1892 avec leurs quatre enfants : Gabrielle, Ernest, Marcel et Marie Louise (Lili). Thérèse est née au Canada un an plus tard, en 1893.
Afin de donner une perspective plus claire de l'ascendance MOLLOT et BENOIT qui suit, les antécédents familiaux historiques de Fortuné Mollot et de Léopoldine Benoit ont été décrits séparément au début.
CHRONOLOGIE
Pour les ancêtres suivants, veuillez vous référer au petit arbre généalogique Mollot ci-joint afin de comprendre leur lignée. Le numéro suivant chaque nom indique sa position dans l'arbre. Il est fortement recommandé de suivre cet arbre généalogique, car traditionnellement, les prénoms se transmettaient de génération en génération, ce qui peut engendrer des confusions. Exemple : Georges Mollot (1) et Georges Mollot (4) selon l'arbre généalogique, et les suivants :
1613 – 1693 GEORGES MOLLOT (1) – À ce jour, Georges est le parent dont nous avons pu retracer la lignée le plus loin grâce à divers documents. Né en 1613, il épousa Jeanne Gombault à l'âge de 27 ans, en 1640, au village de Trouan-le-Grand. Ils furent tous deux baptisés à l'église Saint-Georges, l'église paroissiale construite au XIIIe siècle et toujours debout aujourd'hui. À ce jour, nous n'avons pas pu identifier ses frères et sœurs. Georges et Jeanne eurent au moins un fils, Claude Mollot, notre ancêtre direct. Nous n'avons pas non plus cherché à déterminer le nombre d'autres enfants de Georges et Jeanne. Ils vécurent pendant la guerre de Trente Ans (1618-1648), considérée par les historiens comme l'un des conflits les plus destructeurs de l'histoire européenne. L'une des conséquences majeures de cette guerre fut la destruction massive de régions entières, ravagées par les armées de pillage. Les épisodes de famine et d'épidémies décimèrent considérablement les populations et ruinèrent la plupart des puissances belligérantes, comme le roi Louis XIII de France.
Quant à son métier, Georges était charron, « le charron » de la ville : il fabriquait des roues, des chars, des chariots et des voitures. Comme vous pouvez l'imaginer, ce métier n'existe plus de nos jours. Georges est décédé le 20 novembre 1693, à l'âge de 80 ans, à Trouan-le-Grand.
À cette époque, les naissances et les décès étaient enregistrés au domicile familial. Avant la Révolution française de 1789, l'Église était la seule institution officielle à tenir des registres d'état civil. L'État procédait toutefois occasionnellement à des recensements afin de déterminer la population totale du pays et, surtout, d'identifier les personnes à assujettir à l'impôt. Après la Révolution française, des lois furent promulguées pour séparer l'Église et l'État. Il devint alors obligatoire, après une naissance, un mariage ou un décès dans la famille, qu'un membre de celle-ci déclare l'événement à la mairie. L'Église continua néanmoins à tenir des registres de baptêmes, de mariages et de décès. Par conséquent, en France, de 1789 à nos jours, il est courant de trouver des actes d'état civil pour les naissances, les mariages et les décès, ainsi que des registres paroissiaux pour ces mêmes événements. Certains de nos ancêtres étant nés après 1789, nous avons pu retrouver des documents provenant à la fois de l'État et de l'Église, comme vous le constaterez tout au long de ce document.

Église Saint-Georges construite au XIIIe siècle à Trouan-le-Grand
Dans toute l'Europe occidentale, y compris en France, des églises aux clochers élancés et aux arcs-boutants élancés parsèment villes et campagnes. La construction d'églises et de cathédrales grandioses a débuté dès 400 après J.-C. et a connu son apogée au XIIe siècle, à l'époque des croisades. Au Moyen Âge, on estime qu'un édifice religieux, ou église, était construit pour environ 300 habitants. On compte aujourd'hui près de 90 000 églises en France, dont environ 17 000 sont classées monuments historiques ou architecturales, ce qui confère à la France la plus forte densité d'édifices religieux de tous les pays européens. L'église Saint-Georges de Trouan-le-Grand, construite au XIIIe siècle et berceau de la famille Mollot, en est un bel exemple.
1645 – 1727 CLAUDE MOLLOT (2) – D'après les registres de la paroisse Saint-Georges, Claude est né en 1645 et décédé à l'âge de 82 ans, le 26 mai 1727, également à Troun-le-Grand. À 26 ans, il épousa Louise Gombault, âgée de 19 ans, le 4 novembre 1671. Son épouse, Louise, était née le 4 juillet 1652 et décédée le 12 février 1733, à l'âge de 81 ans. Claude était juge de garde. Tous deux furent baptisés dans l'église Saint-Georges, construite au XIIIe siècle et toujours debout aujourd'hui. Claude et Louise eurent onze enfants que nous avons pu identifier à ce jour, dont Louis Mollot, notre ancêtre direct.
1674 – 1747 LOUIS MOLLOT (3) – Louis est né en 1674 et décédé à l'âge de 73 ans, le 21 décembre 1747, également au village de TROUAN-LE-GRAND. D'après leur acte de mariage, il épousa JEANNE MILLIAT le 23 novembre 1701, à l'âge de 27 ans. Ce long acte fournit de nombreuses informations intéressantes sur les témoins de la cérémonie, leurs liens de parenté et leurs professions. Jeanne était née le 28 avril 1682 à DOSNON, un village voisin. On retrouve également la trace de huit enfants nés en douze ans. L'un d'eux est Georges, notre descendant direct. Les noms et les détails concernant les enfants figurent dans notre arbre généalogique détaillé de la famille Mollot. Jeanne mourut le 22 mars 1721, à l'âge de 39 ans. Louis et ses enfants furent tous baptisés à l'église Saint-Georges de Trouan-le-Grand, datant du XIIIe siècle. On ignore la profession de Louis, mais il était probablement agriculteur, car plusieurs de ses descendants l'étaient également. L'agriculture à cette époque contrastait fortement avec celle d'aujourd'hui. Les paysans produisaient de quoi subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Une partie de leur production servait au troc pour acquérir quelques biens, et une autre était versée au roi et à la Couronne à titre d'impôt, en échange de leur sécurité et de leur protection contre d'éventuels envahisseurs. Cependant, ce système d'imposition était régulièrement détourné et les paysans étaient exploités. Les livres d'histoire nous apprennent que la vie rurale française de cette époque était rude et impitoyable.
1706 – 1769 GEORGES MOLLOT (4) - Georges était le troisième enfant de Louis Mollot et de Jeanne Milliat. Il naquit à Trouan-le-Grand et fut baptisé à l'église Saint-Georges le 18 avril 1706, selon les registres paroissiaux. À cette époque, il était courant de baptiser les nouveau-nés le jour même de leur naissance, car beaucoup ne survivaient pas aux complications de l'accouchement, aux maladies, etc. Comme indiqué sur leur acte de mariage, Georges épousa Sire Beaurieux de Dosnon, village voisin situé à environ 5 km, le 26 novembre 1742 à Trouan-le-Grand, à l'âge de 36 ans. Sa nouvelle épouse avait 28 ans. Elle était née le 7 juin 1714. La date de son décès est inconnue à ce jour. Georges et Sire eurent sept enfants, tous nés à Dosnon et baptisés à l'église Saint-Pierre-des-Liens, comme l'attestent leurs actes de naissance. Les noms des enfants étaient : Sire, né en 1743 ; George Dominique, né en 1745 ; notre ancêtre direct, Pierre, né en 1747 ; Marie Jeanne, née en 1749 ; Marguerite, née en 1750 ; Marie Tanche, née en 1754 ; et Marie Angélique, née en 1758. À ce jour, le seul parent direct en France que nous ayons pu relier à notre arbre généalogique est un descendant de Marie Angélique. Depuis 2005, nous avons établi un lien de parenté avec la famille Mollot entre moi, Victor Mollot, et l'arrière-arrière-petite-fille de Marie Angélique, Mme Yolande Rosez. Notre branche de la famille Mollot descend de Pierre Mollot. Pierre et Marie Angélique étaient frère et sœur. Comme mentionné précédemment, lors de notre première rencontre avec la famille Rosez en 2004, Mme Rosez nous a montré des photos du château de Blandin, des cartes postales et des lettres de Fortuné et Léopoldine Mollot, mais nous n'avions alors pas pu établir le lien de parenté.
Georges et Sire Mollot vécurent à une époque marquée par un conflit majeur entre la France et l'Angleterre, principalement dû à la rivalité pour les colonies à travers le monde. Ce conflit aboutit à la guerre de Sept Ans en 1754 et, par conséquent, au traité de Paris de 1763 qui permit à l'Angleterre d'obtenir une colonie alors appelée Nouvelle-France. Les Britanniques la renommèrent plus tard Canada.
Georges Mollot décéda le 26 octobre 1769 à Dosnon, à l'âge de 63 ans. Son décès à Dosnon, l'origine de son épouse et le fait que tous ses enfants y soient nés et baptisés permettent de supposer qu'il avait quitté Trouan-le-Grand pour s'établir à Dosnon, situé à environ 5 km. D'après les actes de naissance de ses enfants, Georges était agriculteur aux alentours du village de Dosnon. À cette époque, la région était probablement assez boisée et parsemée de petites exploitations agricoles.
1747 – 1810 PIERRE MOLLOT (5) – Pierre est né à Dosnon et a été baptisé à l'église Saint-Pierre-aux-Liens le 23 mai 1747. Il était le troisième d'une fratrie de sept enfants. Son acte de naissance et de baptême, extrait des microfilms 5MI 101P et 5MI 102P conservés aux Archives départementales de l'Aube à Troyes, en France, figure ci-après. Il a été retrouvé dans le registre paroissial de l'église Saint-Pierre-aux-Liens de Dosnon. Ce même acte est également disponible sur le microfilm n° 1897626 du Centre d'histoire familiale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Cet exemple illustre la documentation relative aux naissances, mariages et décès de l'époque et est représentatif de nombreux autres documents similaires.
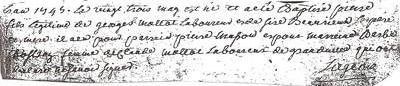
La transcription et la traduction de ce qui précède sont les suivantes :
L’an 1747, le vingt trois may est né et a été baptisé Pierre, fils légitime de Georges Mollot, laboureur et de Sire Beaurieux, ses père et mère. Il a eu pour parrain Pierre Masson et pour marraine Barbe Geoffroy, femme de Claude Mollot (Frère de Georges), laboureur de Grandville qui ont déclaré ne savoir signer.
Signature: Liégeois (curé de Dosnon)
En l'an 1747, le 23 mai, naquit et fut baptisé Pierre, fils légitime de Georges Mollot, cultivateur, et de Sire Beaurieux, son père et sa mère. Il eut pour parrain Pierre Masson et pour marraine Barbe Geoffray, épouse de Claude Mollot (frère de Georges), cultivateur de Grandville, qu'ils déclarèrent ne sachant comment souscrire.
Signature: Liégeois (Priest of Dosnon)
Chronologie de la partie 8 (suite)
Pierre est le premier de nos ancêtres dont nous pouvons retracer la personnalité, le caractère et les ambitions. Grâce à des lettres, des actes de naissance et de décès, ainsi qu'aux mémoires de Fortuné Mollot (dont Pierre était le grand-père), nous savons qu'il était un entrepreneur, un homme dynamique et ambitieux, déterminé à réussir ! Célibataire, il quitta son village natal de Dosnon, probablement peu intéressé par l'agriculture, pour s'installer à Châlons-sur-Marne (aujourd'hui Châlons-en-Champagne). Il y créa un petit commerce de vêtements de style nouveau, de tissus et d'accessoires tels que boutons, aiguilles, fils, rubans, etc. (Commerce de nouveautés et mercerie). Châlons se situe à une quarantaine de kilomètres au nord de Dosnon. À l'époque, Châlons était un important centre commercial pour la fabrication et le commerce de la laine et des textiles. La ville était surtout réputée pour la production de laines de la plus haute qualité, d'où l'origine du mot « châle » (en français, « châle », dérivé de Châlons). Les marchands européens se réunissaient à Châlons lors des foires commerciales. C’est là que Pierre Mollot a fait ses débuts dans les affaires et qu’il a rencontré sa future épouse, FRANÇOISE MARIE JOSEPH FREMINET.

Françoise Marie Joseph Mollot - née Freminet circa 1840.
Il s'agit de la plus ancienne photo de la collection familiale importée au Canada. Remarquez qu'elle porte un châle. À titre d'information, la photographie moderne a vu le jour dans les années 1820 en France et est rapidement devenue populaire. Parmi les objets de notre collection familiale, nous possédons non seulement de vieilles photographies, mais aussi d'anciens négatifs sur verre, un procédé photographique ancien datant du début des années 1840. Ces négatifs représentent l'église Sainte-Tanche et la chapelle de L'Huître.
D'après leur acte de mariage, Pierre et Françoise se sont unis par les liens du mariage le 7 mai 1787 en l'église Saint-Alpin, connue comme la paroisse des commerçants les plus riches. Si vous avez l'occasion de visiter l'église Saint-Alpin à Châlons-en-Champagne, admirez tout particulièrement la grande fresque murale représentant saint Michel. Selon le site web de l'église, elle fut offerte par la famille Freminet, alors en fonction.
Au fil des siècles, les églises se sont embellies grâce à leurs vitraux. De nombreuses photos sont disponibles sur le site web vitrail.mdoduc.com, dans la rubrique France-ville/commune. On peut y admirer les magnifiques vitraux des églises où nos ancêtres venaient prier, comme ceux de l'église Saint-Alpin à Châlons-en-Champagne dans le département de la Marne (51), de l'église Saint-Pierre à Dosnon, de l'église Sainte-Tanche à Lhuitre et de l'église Saint-Pierre à Trouans, toutes situées dans le département de l'Aube (10).
Au moment de leur mariage, Pierre avait 40 ans et Françoise 31. On pourrait dire que pour l'époque, ils ont commencé tard !
D'après les registres de naissance, de mariage et de décès, la famille Freminet était solidement implantée dans le commerce à Châlons. Les archives locales de Châlons que nous avons consultées indiquent que le beau-père de Pierre, Jean Toussaints Freminet, né le 31 octobre 1722, était marchand de vêtements, connu sous le nom de « marchand drapier », et un homme d'affaires très en vue à Châlons-sur-Marne. Un site web consacré à la famille Freminet, où figure Pierre Mollot, révèle que cette famille était active dans le commerce du textile depuis plusieurs générations. Nul doute que le savoir-faire et l'expérience acquis par Pierre Mollot dans l'industrie textile et de l'habillement à Châlons ont joué un rôle important dans la réussite financière de son fils, Louis, qui a suivi ses traces. Louis a ainsi amassé une fortune considérable, dont a hérité plus tard son fils artiste, Fortuné Mollot.
D'après les mémoires de Fortuné, la famille Freminet possédait des vignobles et était à l'origine de la Maison de Champagne Freminet. « Mon cousin Freminet a fondé la Maison de Champagne, que ses fils dirigent aujourd'hui », précise Fortuné. L'existence de cette Maison de Champagne entre 1826 et 1882 peut être vérifiée sur le site web français « Les Grandes Marques & Maisons de Champagne » (www.maisons-champagne.com), et notamment sur la page suivante : http://www.maisons-champagne/bonal/pages/04/04-012.htm. À cette époque, on comptait une dizaine de Maisons de Champagne à Châlons, dont « Freminet et Fils ». Par ailleurs, une conversation avec un certain Gérard Freminet âgé (sans lien de parenté connu), originaire de la région, a confirmé l'existence d'une telle Maison de Champagne à la fin du XIXe siècle.
À l'automne 2010, Lucille et moi avons eu l'occasion de passer quatre jours à Châlons. Nous avons alors entrepris des recherches sur les origines de la Maison de Champagne Freminet. Ce fut une expérience passionnante ! Grâce à des informations recueillies lors de recherches préalables et à une visite aux Archives de la Marne, nous avons rencontré, entre autres personnes, M. Biaux, maire de Fagnières, commune de Châlons. Nous avons découvert qu'au XIXe siècle, Fagnières abritait dix grandes maisons de champagne. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une : la Maison Joseph Perrier. La plupart de ces maisons se sont développées et ont déménagé dans des centres plus importants comme Reims et Épernay, capitale mondiale du champagne.
Grâce à la mairie, nous avons eu la joie de découvrir l'emplacement exact et les vestiges des caves de la Maison de Champagne Freminet, au n° 4 de la rue Basse à Fagnières. Ces caves étaient idéalement nichées le long d'une longue falaise. Aujourd'hui, la plupart de ces caves et anciens entrepôts sont abandonnés.
Outre la découverte des caves de Freminet et Fils, toujours avec l'aide de la mairie, nous avons pu identifier, dans le vieux Châlons, l'adresse exacte de la Maison de Champagne Freminet et Fils d'origine. Elle se situait au 24 rue Pasteur, anciennement rue Saint-Nicaise. Aujourd'hui, un grand immeuble occupe les lieux, mais, chose étonnante, le porche d'origine, ou portail, offre toujours une entrée majestueuse !

Vue du n° 4 rue Basse. À l'origine, les grottes du Freminet se trouvaient derrière ce bâtiment.

Vue du n° 24 rue Pasteur.
À noter que l'arche d'origine a été conservée comme entrée de la propriété.
Chronologie de la partie 9 (suite)
Et nos découvertes ne s'arrêtèrent pas là ! Aux Archives départementales de la Marne à Châlons, on nous conseilla de nous renseigner auprès des archives de Reims, qui recèlent probablement d'autres informations sur la Maison de Champagne « Freminet et Fils ». Ni une ni deux, nous nous rendîmes à Reims ! Sur place, nous découvrîmes divers documents, principalement des factures et des bons de vente à l'exportation vers l'Angleterre, qui devaient alors être remis au gouvernement français. Ces documents nous apprirent également qu'Adrien Freminet était l'un des agents de « Freminet et Fils ».
Le champagne « Charles Freminet » est toujours produit aujourd'hui par le Château Malakoff, une maison de champagne renommée d'Épernay. Cette maison produit également de nombreuses autres marques. Cependant, le champagne Charles Freminet est commercialisé et distribué dans le monde entier par une autre grande maison de champagne d'Épernay, sous le nom de « Champagne de Castellane ». Nous pensons qu'il existe un lien entre Freminet et Fils du XIXe siècle et le champagne Charles Freminet actuel, mais cela reste à confirmer.
Pierre et Françoise eurent deux enfants seulement : Jeanne-Françoise Mollot (6 ans) et Louis Fortune Mollot (7 ans), le père de Fortune. On remarquera qu'à cette époque, il était courant de donner à la première fille le nom de sa mère et au premier garçon celui de son père. Cette coutume peut prêter à confusion pour les historiens et les généalogistes. Les beaux-parents de Pierre Mollot étaient Jean Toussaints Fréminet et Françoise Collard. D'après leur acte de mariage, Jean Toussaints et Françoise se marièrent le 18 février 1754 à l'église Saint-Éloi de Châlons. Il convient de noter la succession de trois événements familiaux importants survenus durant les quatre années entourant la Révolution française, entre 1789 et 1793 : Pierre et Françoise se marièrent le 7 mai 1787. Leur fille, Françoise Jeanne, naquit le 23 juin 1788 et, un an plus tard, le beau-père, Jean Toussaints Fréminet, décéda le 31 août 1789, à l’âge de 66 ans. La Bastille fut prise à Paris le 14 juillet 1789 par des révolutionnaires ou des antimonarchistes ; cette date correspond donc environ à la sixième semaine de la Révolution française, plus connue sous le nom de Terreur. On ne peut qu’imaginer les conditions de vie de nos ancêtres, compte tenu des troubles sociaux qui engendrèrent cette terrible guerre civile, à la fois religieuse et politique. Les livres d'histoire nous apprennent qu'aux XVIIIe et XIXe siècles, le système féodal et les rois Bourbons (1610-1789) ont maintenu le peuple français dans une oppression sévère, tandis que les rois Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et enfin Louis XVI, la noblesse et leur cour menaient une vie fastueuse. Fait intéressant, la sécheresse, et notamment la pénurie alimentaire, fut une autre cause de la Révolution française. Le peuple français mourait de faim tandis que la noblesse et la royauté vivaient à ses dépens. Ces événements ont finalement conduit à la sanglante Révolution française, qui fit des milliers de morts.
Revenons à Pierre et Françoise Mollot : leur deuxième et dernier enfant, leur unique fils, Louis Fortuné Mollot, naquit et fut baptisé le 15 février 1791, également en l’église Saint-Alpin de Châlons-sur-Marne. Louis vécut son enfance durant des années particulièrement troublées de l’histoire de France : la Révolution française, ou Terreur, se déroula entre 1789 et 1793, marquée par la décapitation du roi Louis XVI le 21 janvier 1793 et celle de la reine Marie-Antoinette le 16 octobre 1793. Ces temps difficiles prirent fin avec la chute du gouvernement révolutionnaire et, peu après, avec l’accession au trône de l’empereur Napoléon Ier.
L'épouse de Pierre Mollot, Marie Joseph Françoise Freminet, est née et a été baptisée le 25 février 1756 à l'église Saint-Éloi de Châlons, comme l'atteste son acte de naissance. Son acte de décès, quant à lui, indique qu'elle est décédée le 15 janvier 1846 à Châlons-sur-Marne, à l'âge de 89 ans. Son nom et l'année de son décès ont également été retrouvés inscrits au dos d'un cadre photo orné de mèches de cheveux tressées. Conserver des mèches de cheveux en souvenir était une coutume assez répandue à l'époque. L'inscription se lit comme suit : « Cheveux Provenant de Marie Joseph Françoise Freminet, Épouse de Pierre Mollot, Décédée dans sa 90e année… Leurs descendants, Louis Mollot, Jeanne Françoise Mollot. » Ce souvenir est un autre témoignage de notre histoire familiale.
D'après les registres d'état civil de la ville, Pierre Mollot est décédé à Châlons-sur-Marne le 5 juillet 1810, à l'âge de 63 ans, alors que Napoléon et ses armées dominaient la majeure partie de l'Europe. Ces registres indiquent que Pierre était marchand au moment de son décès.
Il est également intéressant de noter que leur fille unique, Jeanne-Françoise Mollot (6), née le 23 juin 1788 à Châlons-sur-Marne (aujourd'hui Châlons-en-Champagne), épousa le capitaine Jean-Marie Fortuné Collet. Né à Turin en 1781, il décéda, selon son acte de décès, le 7 octobre 1850 à Châlons-sur-Marne à l'âge de 68 ans. Son acte de décès indique également que sa dernière adresse était le numéro 4, place de la Comédie. Aujourd'hui, ce lieu abrite un centre commercial en plein cœur de Châlons, appelé la Galerie de l'Hôtel de Ville.
Le capitaine Collet servit dans les armées de Napoléon Ier et de Louis XVIII et fut blessé deux fois au combat. De l'Empereur et du Roi, il reçut des certificats d'honneur de « Chevalier de Saint-Louis et Saint-Ferdinand d'Espagne » ainsi que des médailles de bravoure. Parmi les autres objets qui nous ont été transmis figurent les décorations de son uniforme militaire, notamment ses épaulettes et la visière métallique de sa casquette. Tous ces souvenirs sont encore aujourd'hui en possession de sa famille.

Capitaine Fortuné Collet and spouse Françoise Collet née Mollot
D'après son acte de décès, Jeanne Françoise Collet, née Mollot, est décédée le 29 septembre 1869 à son domicile, au n° 1 de la rue Saint-Joseph à Châlons-sur-Marne, à l'âge de 81 ans. Cette maison existe toujours et est connue sous le nom de Maison Saint-Joseph, un établissement d'hébergement pour personnes âgées géré par les Sœurs de l'Adoration. En septembre 2010, Lucille et moi avons visité cette résidence. Elle avait été fondée et construite en 1614 par l'ordre religieux des Bénédictins. L'agencement de la Maison Saint-Joseph est particulièrement intéressant car il rappelle celui d'un monastère médiéval : une belle chapelle et des chambres entourant un cloître-jardin.
Durant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux bâtiments de Châlons furent détruits. La ville et la région furent libérées par le général Patton et la division Blue Ridge de la 3e armée américaine en août 1944. Aujourd'hui, plusieurs rues portent le nom de héros de guerre américains, comme le boulevard du Général Patton et l'avenue du Président Roosevelt.
Le capitaine Fortuné Collet et son épouse Françoise n'eurent pas d'enfants. Son unique frère, Louis, âgé de 78 ans, et son neveu, Fortuné, âgé de 24 ans, assistèrent à ses obsèques à Châlons, comme en témoignent leurs signatures sur son acte de décès. Il est également intéressant de noter que sur cet acte, c'est son nom de jeune fille, Mollot, qui est mentionné, et non son nom d'épouse, Collet. À cette époque, il était courant que les femmes reprennent leur nom de jeune fille après le décès de leur mari. Parmi les objets familiaux, nous conservons de nombreuses lettres qu'elle adressa à son neveu, Fortuné Mollot, datant de 1862. En effet, à la mort de Françoise en 1869, Fortuné hérita de 42 000 francs, une somme considérable pour l'époque.
Historiquement, le XIXe siècle fut une période de transition en France. La Révolution française et l'ère napoléonienne mirent fin au règne des monarques et des empereurs. Elles marquèrent le début d'une ère démocratique, parfois instable. Cependant, l'esprit d'entreprise put s'épanouir, n'étant plus sous le contrôle des monarques et de la noblesse. Ce facteur permit sans aucun doute à des personnes comme nos ancêtres directs, Pierre Mollot et, surtout, son fils, Louis Fortuné Mollot, de devenir entrepreneurs, de prospérer et de bénéficier d'une bien meilleure qualité de vie.
Chronologie de la partie 10 (suite)
1791-1871 LOUIS FORTUNE MOLLOT (7) Comme mentionné précédemment, Louis Fortuné Mollot était le fils unique de Pierre Mollot et de Françoise Marie Joseph Freminet, originaires de Châlons-sur-Marne. Il naquit et fut baptisé le 15 février 1791 en l'église Saint-Alpin de Châlons-sur-Marne. Il commença très probablement à travailler dans le commerce de vêtements, de mode et d'accessoires de son père, Pierre, à Châlons, où il apprit les ficelles du métier. Souffrant de problèmes de vue, Louis Fortuné quitta l'armée napoléonienne en 1811. Âgé alors de 20 ans, il s'installa à Paris en quête de meilleures opportunités et d'expériences variées dans le secteur de la mode et du vêtement. Son parcours révèle des traits de caractère similaires à ceux de son père, Pierre : un homme d'affaires ambitieux et déterminé, fonceur et ambitieux. Après son séjour à Paris, Louis Fortuné s'installa plus au sud, à Lyon, alors centre névralgique de l'industrie de la soie en France, en Europe et dans le monde occidental. Du XVIe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale (1918), la soie fut l'une des principales industries de la ville, générant une immense richesse et contribuant à la construction de nombreux édifices Renaissance. À ses débuts à Lyon, Louis Fortuné Mollot travailla comme vendeur et courtier en produits de soie. Plus tard, il créa sa propre manufacture de soie au cœur du Vieux Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse. Ce quartier est encore connu aujourd'hui comme le quartier des anciens tisserands de soie. À ce jour, nous n'avons pas mené de recherches et ne disposons pas d'informations concernant l'emplacement précis de son entreprise, mais il est fort probable qu'elle se soit établie dans ce quartier. D'après de nombreux ouvrages consacrés à l'industrie de la soie à Lyon, la plupart des recherches se concentrent sur ce secteur. On sait toutefois que c'est au numéro 2 de la place Sathonay, dans le vieux Lyon, que Louis Fortuné exerçait initialement le commerce de la soie. Il habitait d'ailleurs au troisième étage de ce même immeuble, qui abritait nombre de marchands de soie. L'ouvrage « Les filières de la soie lyonnaise », consacré à l'histoire de la soie à Lyon, démontre clairement que la place Sathonay était alors le cœur de l'industrie soyeuse lyonnaise.
Il est intéressant de noter que Louis Fortuné Mollot, à la fin de sa vie, n'a pas transmis son commerce de soie, pourtant florissant, à son fils ni à sa belle-fille. Les dernières années de son activité furent peu rentables, probablement en raison d'une concurrence accrue, des importations en provenance d'Orient et, peut-être aussi, de sa santé et de son âge. Par ailleurs, son fils avait été victime d'un accident : à 22 ans, Fortuné avait fait une chute de cheval et s'était retrouvé partiellement paralysé. De plus, Fortuné n'avait jamais manifesté un grand intérêt ni d'aptitudes particulières pour le commerce ; il préférait se consacrer à une carrière artistique, comme il le mentionne lui-même dans ses mémoires. À ce moment-là, Louis avait sans doute compris que son fils n'était pas fait pour le commerce. Il vendit donc l'entreprise de soie.
Un autre document intéressant relatif aux affaires de Louis est un certificat de propriété d'obligations mexicaines n° 1488, daté du 31 août 1869 à Paris. Entre 1864 et 1865, Louis acquit dix de ces obligations auprès du gouvernement impérial du Mexique. Comme aujourd'hui, à cette époque, les investissements risqués étaient monnaie courante, et l'on peut se demander si celui-ci fut profitable à Louis. « Plus ça change, plus c'est la même chose ! »
Sur le plan personnel, Louis Fortuné ressemblait beaucoup à son père, Pierre ; il se maria sur le tard, à l’âge de 53 ans ! D’après leur acte de mariage civil, il épousa Thérèse Annequin le 8 décembre 1844 au village de Châbons, en Isère. Elle avait alors 37 ans. Thérèse était née le 31 décembre 1806 au petit village de Châbons, dans la commune de Grand-Lemps, près du village de Blandin où leur fils Fortuné construirait plus tard le château de Blandin. Les parents de Thérèse étaient Joseph Annequin, un agriculteur décédé le 20 décembre 1824, et Marie Malens.
On peut supposer que Louis Fortuné a rencontré sa femme Thérèse Annequin grâce à ses intérêts commerciaux à Châbons, où se trouvaient des fermes de soie avec lesquelles il avait probablement des intérêts commerciaux, ou dans la ville de Lyon.
Concernant la famille, Louis Fortune Mollot et Thérèse Annequin eurent deux enfants : Thérèse Pauline Mollot (9 ans) et Fortuné Louis Joseph Mollot (8 ans). Il est à noter que les prénoms se sont transmis de génération en génération. D'après des lettres et autres documents, nous savons que Thérèse Pauline était adoptée. Était-elle issue d'un précédent mariage de Thérèse ? Thérèse Annequin était-elle veuve ? Nous savons que Thérèse Pauline avait 12 ans lors de leur mariage et que Louis Fortuné l'a adoptée comme sa fille, comme l'attestent un acte d'adoption civile daté du 31 août 1852 à Lyon et son testament.
Après des recherches approfondies, il a été établi qu'avant son mariage avec Louis Fortuné Mollot en 1844, Thérèse Annequin, âgée de 26 ans, avait donné naissance à un enfant le 12 septembre 1832 à Lyon. Le nom de l'enfant inscrit sur l'acte de naissance est Thérèse Mulin. Environ huit jours après la naissance, Thérèse Annequin, la mère, fit changer le nom de l'enfant en Thérèse Pauline Annequin, comme indiqué dans l'acte de naissance daté du 20 septembre 1832. Lorsque Thérèse Annequin épousa Louis Fortuné Mollot en 1844, ce dernier adopta par la suite Thérèse Pauline comme sa fille. Des recherches complémentaires seront nécessaires pour établir le lien avec le nom de famille Mulin.
D'après les mémoires de Fortuné, environ un an après le mariage de Louis Fortuné et Thérèse, leur fils unique, Fortuné Louis Joseph Mollot, naquit à leur domicile, le 4 novembre 1845 à 15 heures, dans leur appartement situé au 3e étage, au n° 4 de la place Sathonay. Cependant, des documents tels que son acte de naissance et son acte de baptême indiquent que la naissance eut lieu au n° 2 de la place Sathonay, dans le 1er arrondissement de Lyon. Comme mentionné précédemment, ce quartier se trouvait alors au cœur de l'industrie de la soie, dans le vieux Lyon. Les parents de Fortuné n'étaient plus de première jeunesse à sa naissance : son père avait 54 ans et sa mère 39. Fait remarquable, il y avait quinze ans d'écart entre eux ! Selon son acte de baptême paroissial, Fortuné fut baptisé à l'église Notre-Dame de Saint-Louis, aujourd'hui appelée église Saint-Vincent, 17 rue Vieille, le 16 novembre 1845. Son parrain était son oncle le capitaine Fortuné Collet qui avait épousé Françoise Jeanne Mollot de Châlons sur Marne.
Selon d'autres documents, au début des années 1850, Louis et Thérèse Mollot ont quitté leur appartement de la place Sathonay pour s'installer au 18, rue du Béguin à Lyon, où leur jeune fils Fortuné a passé ses premières années d'enfance.
Le 13 septembre 1852, sa belle-fille Thérèse Pauline Mollot, âgée de 19 ans, épousa Jean-Baptiste Benoit Bonaventure Algoud à Lyon, comme l'atteste leur acte de mariage civil. Son acte de naissance indique également qu'il était né le 14 juillet 1819. Ses parents étaient Barthélémy Algoud, négociant en soie, et Jeanne Marie Davchez, de Lyon. Les nombreuses lettres et documents de Jean-Baptiste Algoud témoignent de son éducation et de son sens aigu des affaires. Ils eurent trois enfants : Louis Jean-Baptiste, Marie Thérèse et, incroyable mais vrai, un autre Fortuné !
La famille Algoud était également impliquée dans l'industrie de la soie à Lyon et dans ses environs. On trouve sur un papier à en-tête commercial la mention suivante : Soieries Unies, Algoud Frères, 3 Montée de Griffon, Lyon. Il s'agissait d'une manufacture de soie située au cœur de l'ancien centre du commerce lyonnais de la soie, mais aujourd'hui, c'est une boîte de nuit ! Par ailleurs, Jean-Baptiste Algoud, beau-frère de Fortuné, possédait une entreprise séricigénique à Grand Lemps, à seulement 11 km de Blandin. À cette époque, les élevages de vers à soie étaient des activités très florissantes à Grand Lemps et dans ses environs. Tout porte à croire que les Algoud étaient une famille très fortunée. Il est intéressant de noter qu'il devait exister des liens d'affaires entre ces deux familles. À titre d'exemple, un parent des Mollot, Paul Thévenot, originaire de Trouans en Champagne, berceau de la famille Mollot, était le gérant de l'entreprise séricigénique de Grand Lemps, près de Blandin en Isère. Ce lien serait une énigme intéressante à résoudre. Actuellement, nous avons des amis personnels du nom de Thévenot dont les ancêtres ont immigré au Canada depuis la même région de France que les nôtres !
Revenons à Louis Fortuné Mollot ; homme d’affaires extrêmement prospère, il amassa une fortune considérable, qualifiée de « colossale » pour l’époque par un historien contemporain. Outre cette fortune, il hérita de sa femme, Thérèse, d’une propriété : la ferme de la Molinière, située dans le village de Blandin, dans la vallée de la Bourbe, à environ 80 km de Lyon. Ironie du sort, son fils Fortuné y consacra plus tard une partie de son héritage pour y construire le château de Blandin (aujourd’hui château de la Molinière) destiné à sa future épouse, Léopoldine Benoit, qui n’appréciait ni le château ni la vie à la campagne ! Cette propriété se trouve à moins de 15 km du village de Châbons, où Thérèse Annequin, l’épouse de Louis Fortuné Mollot, était née et avait grandi. Cette propriété, appartenant à l'origine à la famille Annequin, faisait partie de la dot de Thérèse Annequin lors du mariage de Louis Mollot et Thérèse en 1844. Louis hérita plus tard de la propriété de sa femme Thérèse.
À l'origine, la propriété comprenait une grande ferme et une grange sur environ 17 hectares (42 acres) de terrain… et, incroyable mais vrai, la ferme d'origine est toujours debout aujourd'hui, quelque 200 ans plus tard ! Les propriétaires actuels sont la famille Dominique et Frédérique Buisson, de très bons amis de la famille. D'après leurs recherches, cette ferme ancestrale a été construite en 1821.
Il est intéressant de noter que Louis Fortuné Mollot a également laissé une empreinte indélébile dans le village de Blandin. Il a fait don du terrain pour le cimetière actuel. En effet, sur une grande pierre du cimetière est inscrite l'inscription suivante : « Souvenir de Reconnaissance à M. Louis Fortuné MOLLOT (Donateur de ce cimetière) ». Comme mentionné précédemment, Louis Mollot a hérité du domaine de Blandin de son épouse Thérèse Annequin, qui l'avait reçu en dot. Ceci explique peut-être le lien entre les noms inscrits sur ce monument : Marguerite Chaboud, née Annequin, et Louis Fortuné Mollot.
Thérèse, épouse de Louis Fortuné, n'eut pas une longue vie. Après seulement dix-huit ans de mariage, elle décéda d'un cancer du sein le 4 décembre 1862, à l'âge de 56 ans, à Lyon. D'après son acte de décès, elle s'éteignit à leur domicile, situé alors au 18 rue du Béguin à Lyon. Il est stupéfiant qu'à cette époque, on parvenait à diagnostiquer de telles maladies sans disposer de traitements efficaces ! Dans ses mémoires, son fils, Louis Fortuné, raconte : « Elle subit une opération pour un cancer du sein qui lui apporta espoir et soulagement pendant un an ou deux, mais la maladie revint avec une violence inouïe, plus intense et plus douloureuse qu'auparavant, faisant de ma mère une véritable martyre durant sa dernière année ! » On imagine aisément le désarroi des personnes confrontées à une maladie aussi terrible à cette époque. Au moment du décès de Thérèse, sa fille Pauline avait 30 ans et son fils Fortuné 17. Son époux, Louis Fortuné, avait 71 ans. En souvenir de son épouse Thérèse, Louis Fortuné fit réaliser un cadre photo composé de mèches décoratives tressées de ses cheveux et portant au dos l'inscription suivante : 'Cheveux Provenant de Thérèse Annequin, Epouse de Louis Mollot, décédée le 4 décembre 1862, dans sa 56 ième année. Ses descendants : Louis Joseph Fortuné Mollot et Thérèse Mollot.' C'est le deuxième souvenir de cette nature qui est transmis en souvenir.

Monument au cimetière de Blandin, France
Chronologie de la partie 11 (suite)
Louis Fortuné Mollot s'éteignit à l'âge de 80 ans, le 10 juin 1871, au village de Blandin, dans la ferme de la Molinière, toujours habitée aujourd'hui, voisine du futur château de Blandin que son fils Fortuné allait construire. Souffrant d'une grave maladie cardiaque, Louis Fortuné avait décidé de passer l'été 1871 à Blandin pour se reposer. Par ailleurs, le contexte politique de l'époque était source d'inquiétude. La France venait d'être vaincue et humiliée par Bismarck lors de la guerre franco-prussienne. Ce conflit, déclenché par l'empereur Napoléon III avec la signature du traité de Francfort, avait entraîné l'abandon de l'Alsace et de la Lorraine par la France au profit de l'Allemagne. Les Français furent également contraints de rembourser les frais de guerre : la somme colossale de quelque cinq milliards de francs. Pour couronner le tout, des troubles sociaux menacèrent le pays de guerre civile. L'anarchie régna à nouveau dans les rues de France pendant quelques mois : monarchistes contre républicains. Durant la « semaine sanglante », les troupes gouvernementales, dans leur tentative de maintenir l'ordre, se livrèrent à des combats de rue et massacrèrent environ 25 000 personnes. Les dernières victimes furent alignées contre le mur du cimetière du Père-Lachaise à Paris et fusillées. Cet épisode brutal laissa une cicatrice indélébile sur le paysage politique et psychologique du pays. Pour reprendre les mots de Fortuné dans ses mémoires : « Nos émotions oscillaient avec angoisse entre espoir et découragement au fil des événements. » Napoléon III fut déposé et, finalement, en 1871, la France retrouva la raison et instaura la Troisième République. Ce gouvernement se maintint jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1946.
Louis Fortuné Mollot et son épouse Thérèse reposent tous deux au cimetière de la Guillotière à Lyon. D'après les registres du cimetière, Louis y fut inhumé le 13 juin 1871, emplacement n° 23/24. Conformément à la législation funéraire française, les concessions funéraires ne sont pas perpétuelles ; elles sont acquises pour une durée déterminée et, si elles ne sont pas renouvelées, vendues. En l'occurrence, la concession expirait en 1924 et, aucun membre de la famille n'étant plus en mesure de l'utiliser ou de la renouveler, la concession fut rachetée par une autre famille. Les sépultures sont enregistrées au cimetière, mais aucune pierre tombale ne porte plus leurs noms.
Il est à noter que Louis Fortuné est né en 1791, durant la Terreur (1789-1793), et mort en 1871, peu après la guerre franco-prussienne de 1870. Il est frappant de constater que ces deux événements tragiques et tumultueux de l'histoire de France ont coïncidé avec sa naissance et sa mort. De fait, Louis Fortuné a vécu dans un contexte de grande instabilité politique.
1845-1924 FORTUNÉ LOUIS JOSEPH MOLLOT (8) Comme beaucoup d'entre vous le savent, si nous connaissons si bien nos ancêtres, c'est grâce aux mémoires détaillées de Fortuné. Ces mémoires se sont transmises de génération en génération. Nous sommes profondément reconnaissants à Fortuné d'avoir consacré autant de temps et d'efforts à leur rédaction. Ces soixante-six pages nous offrent un aperçu précieux de la vie et de l'époque de la famille. Le document original est manuscrit et, bien sûr, en français. Il fut achevé le 18 juillet 1912, alors que Fortuné avait 67 ans, soit douze ans avant son décès. Par conséquent, nous ne disposons que de peu d'informations sur leur vie entre 1912 et 1924.
Au cours des vingt dernières années, ses mémoires ont été dactylographiés en français et traduits en anglais. Ils sont disponibles en version imprimée, en français et en anglais, ainsi que sur CD, le tout au format PDF. Les mémoires de Fortuné sont publiés sur le site web de Mollot : Mollot.ca
Pour mieux comprendre cet homme, la lecture de ses mémoires est vivement recommandée. Toutefois, nous tenterons de retracer sa vie en nous appuyant non seulement sur ses mémoires, mais aussi sur des lettres de famille, de nombreux documents (testaments, actes de naissance, de mariage et de décès), des articles d'historiens parus dans des revues locales, des entretiens avec des personnes disparues ayant connu la famille, et enfin, des témoignages de ses descendants.
Comme l'indiquent son acte de naissance et son certificat d'état civil, Fortuné Louis Joseph Mollot est né à son domicile le 4 novembre 1845, dans un appartement situé au 3e étage du 2, place Sathonay à Lyon. Aujourd'hui, cet immeuble abrite la mairie du 1er arrondissement de Lyon. La place Sathonay donne sur une charmante place de la ville. D'après son acte de baptême, il a été baptisé le 16 novembre 1845 à l'église Notre-Dame de Saint-Louis à Lyon, aujourd'hui appelée église Notre-Dame Saint-Vincent, au 17, rue Vieille à Lyon. De 5 à 17 ans, entre 1850 et 1862, il a fréquenté le pensionnat de l'Abbé Bland à Lyon et a souvent accompagné son père lors de ses voyages d'affaires à travers la France. Il appréciait particulièrement ces voyages.

Capitaine Fortuné Collet and spouse Françoise Collet née Mollot

Durant les étés, ils passaient du temps à la ferme de la Molinière, dans le village de Blandin, avec famille et amis, et voyageaient dans la région de Châlons-sur-Marne (Trouans et L'Huître) pour rendre visite à leurs proches. Après l'école primaire, Fortuné entra au séminaire de Minimes pour y suivre des études classiques. Il n'appréciait guère cet établissement. Cependant, c'est là qu'il commença à développer un intérêt pour le dessin et la peinture. Durant sa scolarité, il suivit pendant un an un cours de dessin dispensé par son professeur, Pierre Bonirote, un professeur renommé de l'École des Beaux-Arts de Lyon. Il poursuivit ensuite ses études artistiques au lycée de Lyon. Toutefois, vers la fin de ses études, le décès prématuré de sa mère, Thérèse, le 4 décembre 1862, le détourna profondément de ses études… Son désir était désormais de terminer rapidement ses études et de passer à autre chose… mais à quoi ?
Pour reprendre les mots de Fortuné : « Je me trouvais alors confronté à la difficile question de savoir ce que je devais faire ensuite. J’aurais vraiment aimé intégrer l’école des beaux-arts. Mais mon père, comme la plupart des hommes de la génération de 1830, nourrissait un préjugé tenace contre les artistes et refusait catégoriquement d’en entendre parler. Il avait fait fortune dans les affaires et c’est ce qu’il envisageait pour moi. Mais ce genre de métier ne me convenait absolument pas et je savais que je ne pourrais jamais devenir l’homme d’affaires qu’avait été mon père. Néanmoins, je me résignai à lui faire plaisir et, grâce à l’aide de mon beau-frère, M. Algoud, je commençai comme jeune employé dans une grande maison de vente en gros de nouveautés, Magnun Fauré & Compagnie, située au 40, rue de l’Impératrice à Lyon. »
À la fin de son adolescence et au début de sa vingtaine, après un apprentissage dans l'industrie de la soie et du vêtement, Fortuné voyagea beaucoup en France, en Italie et en Suisse grâce à la Banque de Papa. Cependant, le malheur allait de nouveau frapper. Le 19 mars 1868, à l'âge de 22 ans, une chute de cheval le laissa pratiquement paralysé.
Cet événement malheureux changea radicalement sa vie. Pour reprendre les mots de Fortuné : « À partir de ce moment, je dus renoncer à toute idée de me lancer dans les affaires, ce qui ne me déplut guère. Ma blessure eut un aspect positif, car je pus enfin réaliser mon rêve de peindre. Cette occupation me combla de joie et me permit, en même temps, de prendre tout le temps nécessaire pour me rétablir. »
Durant les années qui suivirent, Fortuné parcourut le pays pour se faire soigner dans divers spas, bains de sel et stations thermales des Pyrénées et des Alpes. Finalement, il retrouva l'usage de ses membres et put marcher assez bien, mais, comme me l'ont raconté mes parents, John et Blanche, il boitait encore visiblement. Sur les photos, on le voit avec une canne.
Le 11 juin 1871, neuf ans après le décès de sa mère, survint la mort subite de son père, Louis, à l'âge de 80 ans. Fortuné, âgé de 25 ans, hérita alors de ce que les historiens considèrent aujourd'hui comme une fortune considérable pour l'époque : plus de 500 000 francs, auxquels s'ajoutaient une rente mensuelle de 25 000 francs et des biens immobiliers. Ces informations figurent dans ses mémoires. Quant à Pauline, la sœur adoptive de Fortuné, le testament de Louis indique qu'elle avait reçu sa part d'héritage lors de son mariage.
Fortuné, désormais riche, commença à dépenser sans compter. Sa mère, Thérèse, avait toujours rêvé de vivre à la campagne. Son père, lui aussi, avait toujours rêvé de vivre à la campagne, mais sa carrière professionnelle ne lui en avait jamais laissé le temps. Fortuné n'appréciait guère la vie citadine ! Aussi, en 1871-1872, à l'âge de 25 ans, sans épouse ni famille, il engagea l'architecte M. Bourbon pour concevoir et faire construire une demeure de 1 850 mètres carrés (16 650 pieds carrés) sur un terrain de 17 hectares (42 acres) acquis auparavant par son père, Louis Fortuné. Cette propriété se situait à Blandin, charmant petit village français à quelques kilomètres seulement de Châbons, le hameau où était née sa mère, Thérèse Annequin.
Alors qu'il effectuait des recherches pour l'achat de meubles, de tapisseries et de tableaux pour sa future demeure, Fortuné remarqua un jour dans un journal lyonnais une publicité pour un établissement nommé « le Martouret », à Die, près des Alpes françaises. Cet établissement proposait des bains thermaux, des traitements qui semblaient convenir à son état, car il souffrait encore de problèmes de santé. Comme il l'écrit dans ses mémoires : « Fin juillet 1871, je me rendis au Martouret. Ce fut la première de nombreuses fois où j'y allais, car c'est là que je devais rencontrer ma femme ! »
Entre son besoin constant de thérapie et sa cour à Léopoldine Benoit (10), fille aînée du docteur Alexandre Benoit et d'Ernestine Croze, propriétaires de l'établissement thermal « Le Martouret », Fortuné se rendait fréquemment à Die. De plus, Mme Benoit amenait parfois Léopoldine à Lyon pour des cours de chant, et ils en profitaient pour rendre visite à Fortuné. Léopoldine était réputée pour sa très jolie voix et sa passion pour le théâtre. Par l'intermédiaire de son futur beau-frère Gabriel, Fortuné demanda sa main. Sa demande fut acceptée. Après environ quatorze mois de fréquentation, la date du mariage fut fixée. La cérémonie civile eut lieu le 4 octobre et la cérémonie religieuse, suivie des festivités, le 5 octobre 1872, à Die. Fortuné avait 28 ans et Léopoldine 20 ans. Historiquement, la Révolution française de 1789-1792 avait séparé les pouvoirs de l'Église et de l'État. Désormais, l'État exigeait l'enregistrement municipal des mariages, des naissances et des décès. L'Église et l'État tenaient des registres séparés et délivraient les certificats en conséquence. Après leur mariage, Fortuné et Léopoldine partirent en lune de miel puis s'installèrent au château de Blandin, situé dans le petit village du même nom, « Blandin ».

In 1871, Fortuné age 26, Léopoldine age 19.
Part 12 Chateau Blandin
Le château de Blandin se situe dans le petit village du même nom, dans le département de l'Isère, en région Rhône-Alpes, au centre de la France. Il se trouve à environ 80 kilomètres au sud-est de Lyon, la deuxième plus grande ville du pays et capitale gastronomique de la France. En 1999, Blandin comptait 122 habitants. La région, vallonnée et parsemée de vallées, est très propice à l'agriculture. Le climat y est tempéré, de type méditerranéen, malgré quelques chutes de neige en hiver. Pour vous donner une idée de l'envergure de ce grandiose château, construit par Fortuné avant sa rencontre et son mariage avec Léopoldine, il s'étend sur un domaine de 17 hectares (1 hectare = 2,47 acres), dominant la magnifique vallée de la Bourbre. Le château est une majestueuse demeure de briques de quatre étages, chauffée par de nombreuses cheminées dans différentes pièces. À l'origine, le sous-sol abritait une vaste cave à vin. Parmi les éléments aristocratiques les plus remarquables de l'intérieur, on trouve les immenses chambres « pour lui et pour elle » avec balcons donnant sur la cour avant et la magnifique vallée.

Painting: Chateau Blandin by Fortuné Mollot circa 1880

Le château possède un escalier des plus impressionnants, un grand salon et une salle à manger ornée d'un magnifique lustre en cristal. Fortuné y disposait même de son propre atelier de peinture. Parmi les traces durables de son passage dans ce château figurent plusieurs de ses toiles qui ornent encore aujourd'hui les murs de la salle à manger principale.
La salle à manger. Remarquez le lustre restauré et les tableaux de Fortuné qui ornent les murs.
Pour assurer un approvisionnement en eau suffisant, une conduite d'eau a dû être installée à environ un kilomètre et demi en amont du manoir. Cette source alimentait non seulement la maison, mais aussi les étangs à canards situés devant le château. Dans les années 1880, la majeure partie du domaine fut convertie en vignobles. De vieilles photos et cartes postales montrent un magnifique manoir avec un grand étang à canards au premier plan, entouré de superbes vignes sur les pentes et à l'arrière, dominant une vallée pittoresque. À partir de cette brève description, on peut imaginer que ce manoir et ce domaine étaient dignes d'une carte postale, et qu'ils le sont encore aujourd'hui.

Le salon. Remarquez le plafond d'origine.
Selon les normes architecturales françaises en vigueur, la taille du manoir et la superficie du terrain sur lequel il est situé déterminent sa désignation comme château, et le Château Blandin répond à ces critères. L'architecte initialement engagé par Fortuné Mollot en 1870-1871 pour concevoir le château était M. Bourbon.
Aujourd'hui, le château appartient à Michel et Arlette Auclerc. C'est l'un des trois châteaux de la vallée. Monsieur Auclerc est un architecte de renom et son épouse, Arlette, est médecin retraitée. Ils ont toujours été extrêmement accueillants envers notre famille et sont devenus de très bons amis. Ils se sont beaucoup intéressés à notre histoire familiale, ce qui a tissé des liens très forts. Michel et Arlette nous ont souvent dit : « Vous êtes chez vous ici. » Ils respectent profondément nos liens avec Blandin. Ce sont vraiment des amis formidables !
Lorsque Michel et Arlette Auclerc ont acquis le château en 1994, celui-ci était abandonné depuis plusieurs années. Fidèle à sa profession d'architecte, Michel s'est donné pour mission de restaurer le château dans son état du début des années 1870. Le résultat est remarquable ! Ils ont même agrandi le château en aménageant une vaste salle souterraine, servant à la fois à recevoir de nombreux invités et à abriter la collection de voitures de collection de Michel. Parmi les pièces restaurées figure d'ailleurs l'ancienne calèche de Fortuné ! Autre élément unique du domaine, une petite cabane à flanc de colline a également été restaurée. Construite par Fortuné au cœur du vignoble dans les années 1880, elle servait d'abri aux ouvriers et de remise à outils.
La ferme d'origine et la grange attenante de Louis Fortuné Mollot, construites en 1821. Le château Blandin fut édifié plus tard à côté de la cour de ferme. On remarque le hangar à outils sur la colline, tel qu'il se trouvait dans les vignes dans les années 1880.

La famille Auclerc a rebaptisé le Château Blandin en Château de Molinière. Ce nom fait référence à celui de la ferme de la Molinière, propriété de la famille Annequin jusqu'en 1844. Elle devint alors partie de la dot de Thérèse, épouse de Louis. À la mort de son épouse, Thérèse, en 1862, Louis hérita de la propriété ainsi que de la maison construite en 1821.
La famille Auclerc a vendu une petite partie du domaine (1 hectare), comprenant la ferme d'origine et la grange attenante, à une jeune famille du nom de Buisson. Cette demeure, où Louis s'est éteint en 1871, a été remarquablement bien conservée grâce à la préservation de ses éléments d'origine. Son intérieur est également tout à fait exceptionnel.
Part 13Tour de France 2008
En août 2008, une quarantaine d'ancêtres Mollot ont participé au « Tour de France Mollot ». Nous avons eu le plaisir d'être reçus par Michel et Arlette Auclerc à Blandin pour une journée mémorable, point d'orgue de notre voyage. À l'approche du petit village de Blandin, traversant la vallée, notre bus s'est arrêté pour nous permettre d'admirer le paysage pittoresque et, à notre grande surprise, nous avons aperçu le château. Le bus est ensuite entré dans le village au son des cloches de l'église. Une délégation, comprenant le maire, nous attendait pour nous accueillir.


Plus tard dans la journée, nous avons tous eu l'occasion de visiter le château et le domaine. Nous avons été reçus avec les plus grands honneurs dans un cadre magnifique. La famille Auclerc et le village de Blandin ont été des hôtes exceptionnels ! D'ailleurs, si vous visitez Blandin aujourd'hui, vous verrez une plaque et un érable plantés près de la mare aux canards, devant le château, en souvenir de notre visite.
L'étang aux canards dans le jardin du Château de Molinière
La propriété et le château possèdent une histoire fascinante. Vous trouverez ci-dessous la liste des familles qui en ont été propriétaires. Ces informations ont été compilées par nos amis et actuels propriétaires, Michel et Arlette Auclerc.

Arlette and Michel Auclerc, August 2008
Créez votre propre site web en quelques clics ! Mobirise vous permet de gagner du temps grâce à son éditeur de site web flexible doté d'une interface intuitive de type glisser-déposer. L'éditeur de sites web Mobirise crée des sites web responsifs, compatibles avec les écrans Retina et adaptés aux mobiles en quelques clics. Mobirise est l'un des outils de création de sites web les plus simples disponibles aujourd'hui. De plus, étant une application de bureau, il vous offre la liberté de créer autant de sites web que vous le souhaitez.
Comme mentionné précédemment, la propriété appartenait initialement à la famille Annequin. Lorsque Louis Fortuné Mollot épousa Thérèse Annequin en 1844, cette parcelle de terre faisait partie de sa dot. En 1852, Thérèse la légua à son époux Louis Fortuné et à leurs deux enfants, Pauline et Fortuné.
Le 26 décembre 1853, Louis Fortuné Mollot acquit la propriété en réglant les sommes dues à un certain M. Pierre Caillat. En 1862, Thérèse décéda et son époux, Louis, devint le propriétaire officiel.
Le 16 décembre 1869, Louis Fortuné légua la propriété à ses deux enfants, Pauline et Fortuné.
Entre 1871 et 1876, le château Blandin fut construit sur la propriété par son fils Fortuné Louis Mollot. Il devint la résidence principale de la famille en 1877. La propriété fut vendue le 4 juillet 1892, lorsque la famille Fortuné Mollot immigra au Canada.
4 juillet 1892 - La famille de Jean Antoine Benoît Ballofet, juge au tribunal civil de Lyon, acquiert la propriété. Le prix est de 69 000 francs.
4 août 1917 - La famille Camille Albert Suel, propriétaire d'une entreprise de fabrication de tissus, acquiert la propriété. Le prix est de 58 000 francs.
20 juillet 1939 - La famille de Xavier Aimé Morfin, professeur d'université, acquiert la propriété. Le prix est de 175 000 francs.
Le 10 avril 1969, la famille Fabre, dont un ancien ambassadeur de France était à la retraite, hérita de la propriété. Celle-ci avait été léguée par la famille Morfin à la famille Fabre.
Du 14 avril 1994 à nos jours – Les derniers propriétaires sont la famille Auclerc. Michel Auclerc est architecte et Arlette Auclerc est médecin.
C’est une véritable chance que cette propriété soit entre les mains de Michel et Arlette Auclerc, car ils ont mis un point d’honneur à la restaurer dans son état d’origine et à la maintenir à un niveau d’excellence.
Une analyse des prix de vente du château au siècle dernier montre à quel point l'inflation a érodé la valeur réelle et le pouvoir d'achat du franc français, sans parler de notre propre monnaie. En 2010, l'euro équivalait à 6,5 francs et 1 euro à environ 1,50 dollar américain. En 1892, Fortuné vendit le château Blandin pour 69 000 francs, soit l'équivalent actuel de 15 923 dollars américains (sur la base d'un euro équivalant à 6,5 francs aujourd'hui). C'est tout simplement incroyable ! De nos jours, la construction d'une telle demeure coûterait des millions de dollars. On comprend ainsi qu'en 1871, un franc français valait bien plus qu'aujourd'hui.

2010 – L’érable du Canada, planté en 2008 pour commémorer le Tour de France, prospère dans le jardin du Château de Molinière. De gauche à droite : Lucille Mollot, Arlette Auclerc et Vic Mollot.
La famille Auclerc a rebaptisé le Château Blandin en Château de Molinière. Ce nom fait référence à celui de la ferme de la Molinière, propriété de la famille Annequin jusqu'en 1844. Elle devint alors partie de la dot de Thérèse, épouse de Louis. À la mort de son épouse, Thérèse, en 1862, Louis hérita de la propriété ainsi que de la maison construite en 1821.
La famille Auclerc a vendu une petite partie du domaine (1 hectare), comprenant la ferme d'origine et la grange attenante, à une jeune famille du nom de Buisson. Cette demeure, où Louis s'est éteint en 1871, a été remarquablement bien conservée grâce à la préservation de ses éléments d'origine. Son intérieur est également tout à fait exceptionnel.
Partie 14 : Les racines des Benoît
Avant de s'étendre sur le mariage de Fortuné Mollot et Léopoldine Benoit, il est nécessaire de se pencher sur l'ascendance des Benoit.
Les recherches généalogiques sur les familles Azémar/Croze/Benoît remontent jusqu'à environ 1617. Cette information est bien documentée dans plusieurs ouvrages et articles d'histoire française, notamment dans *La France Moderne, dictionnaire généalogique, historique et biographique (Drôme et Ardèche)*, publié par Laffitte Reprints à Marseille en 1979. Ce livre a été obtenu auprès des Archives départementales de l'Ardèche à Privas. Sa cote est la 6363, pages 43 et 44. Une autre source précieuse est un document intitulé « La Famille d'Azémar à La Voulte-sur-Rhône », écrit par l'abbé Auguste Roche et publié en 1900 par l'Imprimerie centrale de l'Ardèche.
L'ascendance, telle que décrite dans La France Moderne, est fascinante et impressionnante, car la famille de Léopoldine remonte à l'aristocratie et à la noblesse françaises. Ses ancêtres, des deux côtés de sa famille, étaient très instruits et occupaient généralement des postes importants dans l'administration locale et/ou l'armée française. Les recherches sur cette famille sont moins approfondies que sur celle de la famille Mollot, mais nous disposons de documents officiels, tels que des testaments et des actes de naissance, qui contiennent des informations précieuses.
Ainsi, nous avons retracé l’ascendance de Léopoldine Mollot née Benoit, du côté maternel (Croze/Azémar), jusqu’aux alentours de l’année 1617.
Ces informations ont été tirées des documents français mentionnés ci-dessus ainsi que de divers actes de naissance, de mariage et de décès que nous avons obtenus auprès des services d'archives de la Drôme à Valence et de l'Ardèche à Privas.
Je vous recommande vivement de consulter l'arbre généalogique Mollot ci-joint. Les numéros qui suivent les noms dans ce document figurent également sur l'arbre, ce qui permet de mieux comprendre à qui il est fait référence. Par exemple : Guillaume Azémar (13).
GUILLAUME AZEMAR-(13)
Notre voyage commence en 1617, lorsque Guillaume Azémar, magistrat de profession, originaire de Pézenas, près de Montpellier en Languedoc, s'installe avec son épouse, Isabeau Cieppe, à La Voulte, sur les bords du Rhône, près de Valence. La Voulte, située dans le centre-sud de la France, fait aujourd'hui partie du département de l'Ardèche. La région de La Voulte est majoritairement boisée. Pendant des siècles, l'exploitation minière y a été une activité économique majeure. Plus au sud, cependant, la viticulture devient l'activité principale. Le frère de Guillaume, Antoine Azémar, épouse Catherine de Fabre.
Antoine Azémar et sa famille obtinrent le droit de percevoir les péages par eau. En 1652, la duchesse de Ventadour et le roi Louis XIV lui conférèrent le titre de baron Antoine d'Azémar (14). Le baron était ainsi autorisé à collecter les taxes pour le roi auprès des particuliers et des entreprises utilisant certaines voies navigables comme moyen de transport. En l'occurrence, il s'agissait du Rhône et de ses affluents dans la région. Le roi en question était Louis XIV, qui régna de 1643 à 1715, soit 72 ans. Comme chacun sait, Louis XIV était réputé pour son extrême extravagance. Le château de Versailles, l'une de ses réalisations les plus fastueuses, situé aux portes de Paris, fut construit grâce au labeur du peuple français.
Du BARON ANTOINE D'AZEMAR (14) dans les années 1650 au BARON MARTIAL-MICHEL D'AZEMAR (15) en 1805 :
Ces personnes occupaient également des postes importants au service de la Couronne de France. À titre d'exemple, le baron Martial-Michel d'Azémar était « avocat en parlement, juge général du comté de La Voulte et maire élu ». Il fut élu maire de La Voulte le 13 novembre 1791, durant les années terribles de la Révolution française. On peine à imaginer les persécutions et les exécutions publiques qui eurent lieu à cette époque où protestants et catholiques s'affrontaient, monarchistes et révolutionnaires ! Sa première épouse était Jeanne-Angélique Morier et, le 11 septembre 1804, il épousa en secondes noces Marie-Anne Désenfant. De cette seconde union naquit un fils, Jean-Jacques d'Azémar, le 18 juillet 1757.
Cela marque une période très intéressante de liens militaires dans notre arbre généalogique, et plus particulièrement dans la lignée directe de Léopoldine Mollot, née Benoit. Le baron Jean-Jacques d'Azémar est le premier de trois générations à atteindre le grade de général dans les différentes armées françaises, avant et après Napoléon.
1757-1816 – BARON GÉNÉRAL JEAN-JACQUES D'AZEMAR (16) Né à La Voulte le 18 juillet 1757, dans l'actuel département de l'Ardèche, il était issu d'une famille noble, instruit et occupait une position d'influence. Il débuta sa carrière en créant des mines et des fonderies à La Voulte. En 1778, il s'engagea comme volontaire dans le régiment militaire local. Peu après, il rejoignit l'armée et gravit rapidement les échelons. En 1785, juste avant la Révolution française, il rencontra Napoléon Bonaparte à La Voulte, alors officier supérieur. (Notez que la date de naissance imprimée sur la photo, provenant d'une autre source, diffère de celle de 1757 mentionnée dans l'ouvrage *La France Moderne*. On ne peut que spéculer sur le contexte politique de l'époque ! Un vent de changement révolutionnaire soufflait. Issu d'une famille aristocratique et occupant une position sociale élevée, le baron Jean-Jacques d'Azémar pressentait sans doute l'effondrement imminent du système féodal et des fastes de la monarchie française. Il s'interrogeait peut-être sur les conséquences de la pauvreté, de l'oppression et du luxe.)
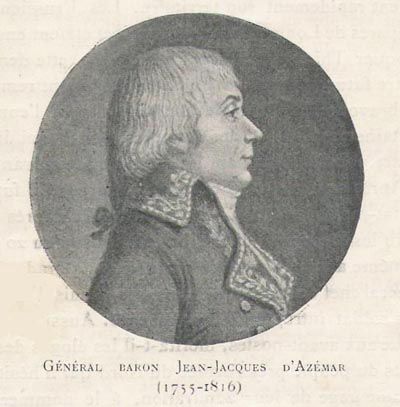
1816 – GÉNÉRAL BARON JEAN-JACQUES D'AZEMAR (16)
Quelques années plus tard, en 1789, la Révolution française éclata ! Le chaos et l'anarchie régnèrent et, quelques années plus tard, Napoléon, par la force des armes, accéda au pouvoir et devint empereur des Français.
Historiquement, le règne de Napoléon est très significatif pour les États-Unis. En 1803, l'achat de la Louisiane fut négocié entre la France (Napoléon) et les États-Unis. Ces derniers acquirent ainsi environ 828 000 miles carrés (2 150 000 km²) de la Louisiane, territoire revendiqué par la France. Ce territoire englobait tout ou partie de 14 États actuels, doublant ainsi la superficie des États-Unis. Le coût total pour les États-Unis s'éleva à 15 millions de dollars, soit environ 3 cents l'acre (3 cents l'hectare) en valeur actuelle. Cet accord fut motivé par la dette importante contractée auprès des États-Unis et par le besoin de financement des armées de Napoléon. De plus, la stratégie de Napoléon visait à créer un nouveau rival pour l'Angleterre. À la conclusion de l'accord, Napoléon déclara : « Cette acquisition territoriale affirme à jamais la puissance des États-Unis et j'ai donné à l'Angleterre un rival maritime qui, tôt ou tard, saura humilier son orgueil. »
Revenons-en au baron Jean-Jacques d'Azémar. Sous Napoléon, il gravit les échelons militaires jusqu'au grade de général en 1806. Il participa activement aux campagnes militaires de Napoléon en Europe du Nord et, plus particulièrement, en Italie.
Concernant sa vie privée, le 6 avril 1802, à l'âge de 44 ans, à La Voulte-sur-Rhône, il épousa Agathe Geneviève Fontneuve, fille de l'avocat parlementaire et juge de La Voulte. Il mourut le 31 janvier 1816 à La Voulte.
Leur fils, le baron général Léopold Michel Martial d'Azémar (1804-1888) : son acte de naissance indique qu'il est né le 22 mai 1804 à Privas. Lui aussi devint général dans l'armée française, mais il était surtout connu comme administrateur et stratège militaire. Il est l'auteur d'ouvrages tels que « L'Avenir de la cavalerie » et « Le Système de la guerre moderne ». Ce document contient des photos de trois générations : le général baron Jean-Jacques, son fils, le général baron Léopold Michel Martial, et son petit-fils, le général baron Adolphe Henry Gaston d'Azémar. Eugénie Marie Appolinaire d'Azémar (1803- ?) : outre un fils, le baron Jean-Jacques d'Azémar et Apolinaire Fonteneuve eurent une fille, née le 18 janvier 1803, prénommée Eugénie Marie Appolinaire d'Azémar, comme l'atteste son acte de naissance. D'après l'acte de mariage, le 2 août 1819, à l'âge de 16 ans, dans sa ville natale de La Voulte, elle épousa Jacques Joseph Hubert Croze, âgé de 30 ans, avocat originaire de Privas, ville voisine. Eugénie est notre lien de parenté direct avec la famille noble Azémar.
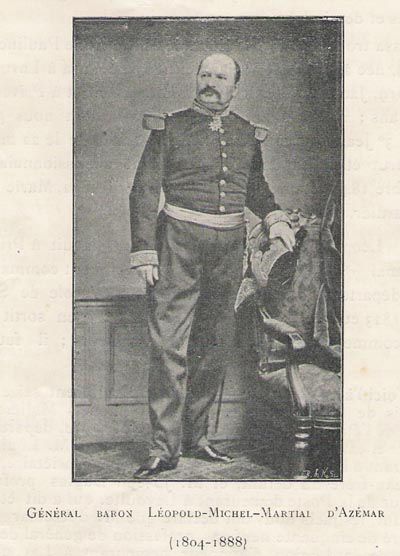
BARON GENERAL LEOPOLD MICHEL MARTIAL d'AZEMAR- 1804-1888 (18)
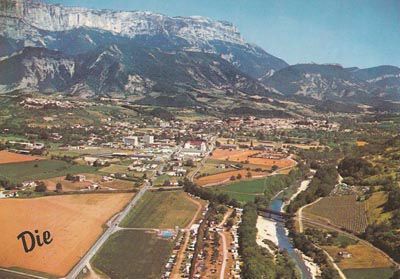
Mourir - France
1823-1887 – AGATHE ERNESTINE JULIE CROZE (12) Jacques Joseph Hubert Croze (20) et Eugénie Marie Appolinaire d'Azémar (17) eurent également une fille, née à Privas le 25 février 1823. Ils la prénommèrent Agathe Ernestine Julie Croze (12). D'après son acte de naissance, son père, Hubert Croze, était avocat et la famille résidait à Privas. Ernestine Croze épousa le docteur Alexandre Gabriel Hubert Benoit (11), médecin originaire de Die, petite ville gallo-romaine du IIIe siècle nichée au pied des Alpes françaises. Cette région de France est des plus pittoresques. Comme on peut l'imaginer, les distances étaient considérables à cette époque, contrairement à aujourd'hui. Bien que Privas, La Voulte-sur-Rhône, Die et Blandin soient toutes situées dans la même région et à environ 125 kilomètres les unes des autres, il fallait quelques jours pour se rendre du point A au point B.
Le docteur Alexandre Benoit et Ernestine Croze eurent cinq enfants, dont l'un est Marie Anaïs Léopoldine Benoit, (10) notre ancêtre directe et arrière-grand-mère de l'auteur de ce document.
1852-1944 - MARIE ANAIS LÉOPOLDINE BENOIT (10) – Léopoldine, qui immigra plus tard au Canada avec son époux Fortuné et sa famille, naquit le 8 juillet 1852 à Dié, en Drôme. Elle était la troisième des cinq enfants du docteur Alexandre Gabriel Hubert Benoit (11) et d'Agathe Ernestine Julie Croze (12). La même année, en 1852, le docteur Benoit fonda une station thermale appelée « Le Martouret » aux abords de Dié, destinée à soigner les patients souffrant de rhumatismes et d'arthrite. Il avait mis au point divers traitements novateurs à base de bains chauds et de vapeurs de térébenthine. Les patients se détendaient dans une chambre d'environ 1,80 m x 2,40 m où leurs membres étaient exposés aux vapeurs de térébenthine. D'après un schéma exposé au musée de Die, le sujet était assis dans une chambre, une partie de son corps recouverte d'un tissu. Les vapeurs de térébenthine s'écoulaient d'une chambre inférieure où la térébenthine avait été vaporisée. Ces gaz étaient acheminés par des tuyaux vers la chambre supérieure, dans l'espace situé sous le tissu, traitant ainsi le patient. Fait intéressant, le docteur Benoît présenta son procédé lors d'une exposition internationale à Venise, en Italie, à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui encore, au musée de Die, on peut voir une exposition et un grand schéma illustrant l'approche scientifique du docteur Benoît pour le traitement des rhumatismes et de l'arthrite.
Parmi les archives familiales, on trouve quelques photos de famille prises vers 1888 au lieu de villégiature. Sur ces photos, on peut identifier certains de nos ancêtres ainsi que quelques bâtiments. Certaines de ces photos ont été prises sur la véranda d'une maison qui était probablement leur résidence. Sur cette véranda, toujours existante aujourd'hui, on reconnaît les moulures et la balustrade ornementales qui figurent sur les photos de famille de juillet 1888.
Juillet 1888 Photo de famille sur la véranda du Martouret. Léopoldine Mollot (36 ans) est assise sur les marches inférieures – au centre devant. Autres inconnus.
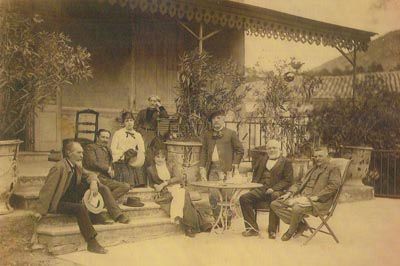
Même véranda… 120 ans plus tard ! Août 2008. Photo de famille sur la véranda du Martouret. Photo de groupe du « Mollot Tour de France ».

Le Martouret, toujours debout aujourd'hui, sert désormais de colonie de vacances pour les jeunes. Fait intéressant, les vestiges du bâtiment abritant six chambres de traitement sont encore visibles !
Le docteur Benoit est né à Dié, en France, le 27 avril 1818. D'après son acte de décès, il est décédé le 20 décembre 1892 à Dié, à l'âge de 74 ans. Comme mentionné précédemment, le docteur Benoit et Ernestine Croze eurent cinq enfants : Gabriel, né en 1847, qui devint lui aussi médecin de la troisième génération de la famille Benoit ; Hubert, né en 1849 ; Léopoldine, notre ancêtre, née en 1852 ; Eugénie, née en 1855 ; et enfin Adolphe, né en 1857. La mère de Léopoldine, Ernestine Benoit, née Croze, est décédée le 21 mars 1877, comme l'atteste la liquidation et la distribution de sa succession, documents que nous conservons dans notre collection familiale.
Il est également intéressant de noter que le père du docteur Benoit était lui aussi médecin, sous le nom d'Alexandre Gabriel Benoit, né en 1787. Sa mère s'appelait Anne Planel. D'après Jacques Planchon, directeur du musée local et historien de la ville, et d'autres sources, le cabinet médical et le domicile du docteur Alexandre Benoit se situaient au 14 rue Villeneuve, aujourd'hui 14 rue Émile Laurens, à l'intérieur des remparts, au cœur de la charmante petite ville gallo-romaine de Die, datant du IIIe siècle.
Comme mentionné précédemment, le lien familial avec la noblesse et l'aristocratie françaises remonte aux ancêtres de la grand-mère maternelle de Léopoldine, Eugénie Marie Appolinaire Croze, née Azémar. Dans toutes les générations précédentes, un membre de la famille portait le titre de « baron d'Azémar ». Les archives indiquent que ce titre était encore en vigueur en 1913.
Les livres d'histoire définissent la noblesse comme suit : des personnes considérées comme des dirigeants compétents, choisies par la Couronne pour gérer/administrer des territoires, contrôler des voies navigables, etc. Outre le titre, les familles nobles se voyaient généralement accorder des droits spéciaux et étaient récompensées financièrement de diverses manières.
Le titre de « baron » est resté dans la famille Azémar pendant des siècles, mais leurs droits de percevoir des taxes ou des péages sur les voies navigables ont été abolis après la Révolution française.
Partie 15 Le mariage Mollot-Benoît
Fortune Louis Joseph Mollot (8 ans) et Marie Anaïs Léopoldine Benoit (10 ans), qui immigreront plus tard au Canada, se marièrent à Die, en France. Le mariage civil eut lieu le 4 octobre 1872, suivi de la cérémonie religieuse le lendemain, 5 octobre 1872. La pratique de célébrer deux cérémonies est encore courante aujourd'hui, symbolisant la séparation de l'Église et de l'État. Avant la Révolution française, l'Église exerçait une grande influence sur l'État et le peuple, ce qui avait conduit à l'adoption de lois instaurant cette séparation.
Le mariage eut lieu à la cathédrale Notre-Dame de Die, suivi d'un grand banquet au Martouret. Quant à la dot, comme il était d'usage dans les familles aisées, le docteur Benoît donna trente mille francs à sa fille et deux cent mille francs à son gendre, Fortuné.
D'après les Mémoires de Fortuné, parmi les invités de marque au mariage figurait le grand-oncle de Léopoldine, le général-baron Adolphe Henry Gaston d'Azémar (né le 10 mars 1837 et décédé en 1921), de La Voulte. Il était le troisième d'une lignée de généraux dans l'arbre généalogique de Léopoldine. Il portait également le titre de baron, octroyé à la famille un siècle auparavant. Les annales de la famille Azémar indiquent que le général-baron Gaston d'Azémar était « également un musicien de talent », auteur de nombreuses compositions. Plus tard, les jeunes mariés passèrent leur lune de miel à Paris et à Châlons-en-Champagne pour rendre visite à leurs proches. Ils visitèrent ensuite Vienne, Naples, Venise, Rome, Florence et bien d'autres merveilles d'Autriche et d'Italie. Avec l'immense héritage récemment reçu de son père et une nouvelle épouse, on ne pouvait imaginer un avenir plus radieux ! Mais ce train de vie fastueux (une nouvelle résidence d'été à la campagne, une villa d'hiver à Lyon et de nombreux voyages) ne pouvait durer éternellement pour ce couple qui semblait avoir tout. Comme il l'a maintes fois répété dans ses mémoires et sa correspondance, Fortuné n'était ni financier ni homme d'affaires. Les vingt années suivantes allaient se révéler financièrement désastreuses ! Entre 1872 et 1877, le coût de la construction et de l'ameublement du Château Blandin dépassa largement les prévisions.
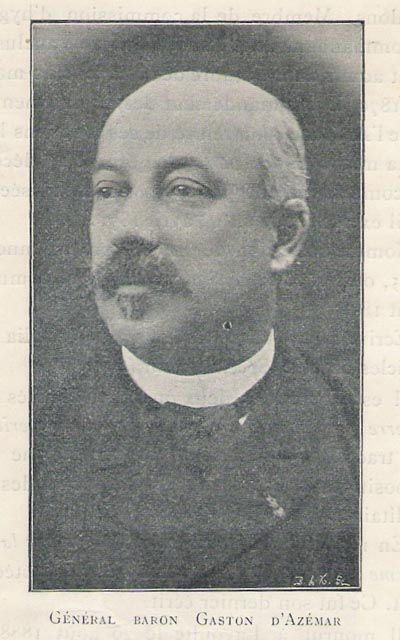
Général Baron Adolphe Henry Gaston d'Azemar

Fortuné Louis Mollot (approx. age 40) and Léopoldine Mollot, née Benoit (approx. age 33) circa 1885
Le contexte économique de l'époque n'arrangea rien. Juste après la guerre franco-prussienne de 1870, qui se solda par la défaite et l'humiliation de la France, le pays sombra dans une récession en 1873, qui dura jusqu'en 1895, soit 22 ans. De plus, au début des années 1870, Fortuné investit massivement en bourse, mais en 1877, le gouvernement en place mit en œuvre des « mesures radicales », selon ses propres termes, qui affectèrent gravement le marché. En conséquence, le marché s'effondra, réduisant considérablement la fortune familiale.
Puis survint le fameux fiasco du canal de Panama. Entre 1881 et 1888, les Français entreprirent la construction d'un canal reliant l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Ce gigantesque projet d'ingénierie, dirigé par Ferdinand Marie de Lesseps, se solda par un désastre financier total dès 1889 ! L'entreprise française de construction fit faillite, entraînant dans son sillage un scandale de corruption impliquant plusieurs membres du gouvernement. D'après les articles de presse, l'abandon du projet ruina de nombreux investisseurs. Fortuné, qui avait lui aussi investi massivement dans le canal de Panama, perdit la totalité de son capital. Ce fut un coup fatal !
Suite à ces événements, la famille dut vendre sa villa lyonnaise et s'installer définitivement au Château Blandin. Auparavant, elle avait le privilège de vivre en ville l'hiver et à la campagne l'été. Blandin devint leur demeure permanente, mais leurs malheurs n'étaient pas terminés ! Fortuné cherchait désespérément une source de revenus rapide et confortable. Il décida d'agrandir considérablement les vignes commencées par son père en 1869, mais le désastre allait de nouveau frapper ! Le vignoble fut ravagé par le phylloxéra, une maladie qui ruina la quasi-totalité de la production viticole française et sud-européenne de l'époque.
D'après des documents locaux de Blandin, les vignobles employaient une quinzaine à une vingtaine d'ouvriers originaires du village. Le vin blanc en barriques était ensuite transporté par chariots tirés par des chevaux jusqu'à la gare de Virieu, située à proximité. Les vignobles de Blandin fournissaient du vin blanc à de nombreuses églises de la région pour les messes.
Fortuné était également très impliqué dans la vie de la communauté de Blandin. Il fut conseiller municipal et élu maire de Blandin de 1886 à 1888. Outre le Château Blandin, Fortuné laissa une autre trace notable. Sur sa propriété, en bordure du village, il fit ériger une statue de la Vierge Marie et obtint du conseil municipal un arrêté municipal stipulant qu'elle y demeurerait à perpétuité ! Nous conservons une copie de cet arrêté dans nos archives familiales. Sans surprise, la statue s'y trouve toujours aujourd'hui ! Malgré de nombreux revers, la vie de Fortuné et Léopoldine, des années 1870 aux années 1890, fut également ponctuée de nombreux événements heureux et mémorables. Quatre de leurs cinq enfants naquirent durant cette période, source de leur grande joie.
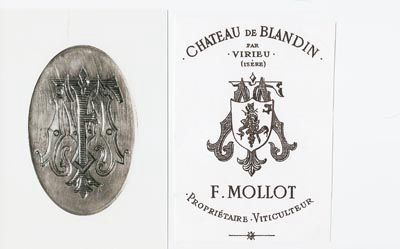
Blason de la famille Fortuné Mollot et son logo en tant que producteur de vin

Gabrielle Thérèse Mollot, (21) née le 4 décembre 1875, au n° 2, rue de la Bourse à Lyon. Louis Jean Baptiste Ernest Mollot, (22) né le 29 août 1879, à Die at the Martouret. Marcel Gabriel Mollot, (23) né le 22 octobre 1880, à Blandin. Marie Louise Mollot, (Lily) (24) née le 27 février 1891, à Blandin. Photo de famille à l'entrée du Château Blandin, septembre 1885. De gauche à droite : Gabrielle Mollot, 9 ans ; Léopoldine Mollot, 33 ans ; une petite fille, inconnue ; le Dr Benoit ; devant lui, Mme Benoit ; Marcel Mollot, 5 ans, sur un cheval à bascule ; à l'extrême droite, Ernest Mollot, 6 ans.
Bien que la fortune de la famille Mollot ait diminué durant ces années, leur train de vie demeurait très aristocratique. Tous leurs enfants fréquentaient des pensionnats privés et étaient initiés à diverses activités musicales et culturelles. Fait intéressant, notre collection d'objets familiaux comprend de nombreuses lettres écrites par les enfants à l'école et adressées à leurs parents. À six ans, ils avaient une très belle écriture ! Oui, une belle écriture manuscrite ! Aujourd'hui encore, en France, on enseigne d'abord l'écriture cursive aux enfants, puis l'écriture en lettres bâton.
Durant les premières années de leur mariage, Fortuné profitait de l'été avec Blandin et la peinture. L'hiver, il peignait au Salon de Peinture de Lyon. Léopoldine, quant à elle, qui n'appréciait ni la campagne ni Blandin, était comblée à Lyon, où elle s'immergeait dans la vie culturelle lyonnaise : musique, théâtre, opéra et autres activités mondaines. Fortuné écrit dans ses mémoires : « Mon statut d'artiste nous donnait accès gratuitement au Grand Théâtre de Lyon. Nous y passions de très bons moments. Les orchestres étaient excellents et les chanteurs, pour la plupart, de premier ordre. Outre le plaisir d'écouter de la bonne musique, il y avait aussi celui de converser avec le cercle artistique lyonnais, un cercle charmant et plein d'esprit dont les conversations animaient les entractes. »

Autoportrait de Fortuné Mollot dans son atelier à Blandin.

Painting of Léopoldine Mollot by Fortuné.
Cependant, pour Fortuné, les difficultés financières étaient une source constante de préoccupation et de stress, tout comme l'évolution de la situation politique et sociale en France à cette époque. Entre 1886 et 1891, en dernier recours, Fortuné accepta de confier à son beau-frère, J.B. Algoud, et à sa sœur adoptive, Pauline (9), la responsabilité de soigner et de restaurer les vignes. Toutefois, les résultats furent loin d'être satisfaisants. Finalement, la décision fut prise de vendre Blandin… mais où aller ? Que faire en France ?
Pour reprendre les mots de Fortuné : « La décision de vendre la propriété m’a fait réfléchir à notre avenir en France en général ! Honnêtement, je ne voyais aucun avenir… L’état de la société française me paraissait sombre et peu rassurant quant aux perspectives positives pour nos enfants. Des lois avaient été créées pour combattre tout ce qui touchait à la religion et à son enseignement ! Tant de choses allaient mal en France que j’ai commencé à me tourner vers des pays étrangers où il y aurait peut-être de la place pour toute l’énergie de la jeunesse ! »
Alors, pourquoi la famille Mollot a-t-elle émigré ? La question est complexe, mais d’après les mémoires de Fortuné, divers documents et lettres, il me semble qu’il y avait de nombreuses raisons : économiques, politiques, sociales et religieuses. Il avait perdu la majeure partie de la fortune héritée de son père, Louis, et l’évolution de la situation politique, sociale et religieuse en France le préoccupait profondément. Il était convaincu que son pays prenait une mauvaise direction ! Ainsi, compte tenu du contexte français de l’époque, il pensait que ses enfants auraient de meilleures perspectives et une vie plus heureuse ailleurs.
En réalité, l'un de ses tableaux, « Reproches ; le Bavard et le Moniteur », illustre clairement le sentiment de Fortuné envers la France de l'époque. On y voit une femme autoritaire (la France) réprimander deux enfants nus (la société française) coiffés de chapeaux en papier journal portant les noms « le Bavard » et « le Moniteur ». Le tableau suggère que la presse était réduite à porter des bonnets d'âne et que la société obéissait au gouvernement plutôt que d'exprimer ses propres opinions… L'un des enfants, au garde-à-vous, salue ! On y voit également un petit soldat de bois renversé dans une poubelle, donnant l'impression que l'armée française était dans un char. Ce tableau exprime le profond ressentiment de Fortuné envers un État omniprésent, la liberté de la presse et la liberté d'expression. Il résume en réalité les raisons de son émigration. Il était très désenchanté par la situation en France et entrevoyait un avenir encore plus sombre. Ce tableau est porteur d'un message profond !

Painting – ‘Reproches: Le Bavard et Le Moniteur’ circa 1887
Partie 16 : Événements et circonstances (suite)
Après mûre réflexion, la famille de Fortuné Mollot décida de quitter la France natale. Ce fut sans doute plus facile pour Fortuné, car il n'avait pratiquement plus aucun lien familial : sa mère, son père, ainsi que sa tante et son oncle étaient tous décédés. Seules sa sœur adoptive, Pauline, et sa famille lui restaient. Quant à Léopoldine, toute sa famille vivait encore en France. Quitter sa famille, et a fortiori leur mode de vie, dut être bien plus difficile pour Léopoldine que pour Fortuné.
La question était de savoir où la famille devait immigrer. Haïti et l'Algérie furent envisagées, car elles étaient alors des colonies françaises. Cependant, l'influence de l'ordre religieux de Blandin fut un facteur déterminant dans leur décision finale d'immigrer au Canada. Pour reprendre les mémoires de Fortuné : « Finalement, l'abbé de Saint-Antoine, l'abbé Cusset, dont la sœur était supérieure du couvent et de l'école de Blandin, nous apprit que les Chanoines réguliers de l'Immaculée Conception possédaient également une maison à Notre-Dame-de-Lourdes, au Manitoba, au Canada. Ce pays, nous dit-on, avait un bel avenir et nous y trouverions assurément ce que nous cherchions. Plus j'en apprenais, plus j'étais enthousiaste. Au Canada, mes enfants pourraient grandir libres et indépendants, pourvu qu'ils soient volontaires et dynamiques. »
Blandin a été mis en vente et, après quelques difficultés, a été vendu le 4 juillet 1892 !
Imaginez un peu : à deux mois de leur départ pour le Canada, Fortuné, 47 ans, Léopoldine, 40 ans, et leurs quatre enfants (Gabrielle, 17 ans ; Ernest, 13 ans ; Marcel, 12 ans ; et Marie Louise (Lily), 1 an et demi) peaufinent leurs préparatifs d'immigration au Manitoba, avant l'arrivée des rigueurs de l'hiver canadien. D'après les mémoires de Fortuné et la liste des passagers du navire d'août 1892, au moment de leur départ, ils ignoraient tout seulement que leur destination était Winnipeg, au Manitoba. Ils n'avaient pas encore choisi la localité où s'installer ; ce choix se ferait à leur arrivée.
Fin août 1892, la famille fit ses adieux à tous ses proches. Ils se rendirent à Paris, puis à Anvers, et traversèrent la mer du Nord jusqu'à Liverpool, en Angleterre, où, le 25 août 1892, ils embarquèrent à bord du « Circassian », à destination de Québec, au Canada. D'après la liste des passagers, ils étaient inscrits comme suit : Fortime Jos. (pour Fortuné) Mollot, chef de famille ; Annis L., épouse (Léopoldine-Anaïs était son deuxième prénom) ; Thérèse G. (pour Gabrielle) ; Louis J. (pour Ernest) ; Gabriel H. (pour Marcel) ; et Marie L. (pour Marie Louise). Outre le fait que la plupart de leurs deuxièmes prénoms étaient utilisés comme prénoms, nombre d'entre eux étaient mal orthographiés, ce qui était fréquent sur les listes de passagers.
Après une traversée probablement difficile de l'Atlantique Nord, le manifeste du navire indique qu'ils arrivèrent à leur port d'escale, Québec, le 4 septembre, et durent ensuite prendre le train pour atteindre leur destination, Winnipeg, au Manitoba, au Canada. Ils arrivèrent le 10 septembre 1892… après quatorze jours de traversée sur un petit navire et en train ! Quel voyage éprouvant cela dut être pour toute la famille !
La famille Mollot passa ensuite quelques jours à Saint-Boniface, village voisin, et, après avoir consulté divers prêtres, dont l'évêque Taché, pour savoir où s'installer, elle visita plusieurs villages francophones tels que Lorette, Saint-Pierre et Saint-Malo. Cependant, comme Fortuné l'explique dans ses mémoires, elle choisit finalement Fannystelle en raison de l'accueil chaleureux que lui réservèrent l'abbé Perquis et d'autres familles, comme les Guyot et les Guilbault, qui avaient immigré de France. Elle était également ravie de pouvoir acheter un terrain jouxtant le village. Selon le titre foncier n° 28191 que j'ai obtenu du Bureau des titres fonciers du Manitoba, le 15 septembre 1894, 80 acres de terre furent enregistrés au nom de « Léopoldine Mollot de Fannystelle, Manitoba, épouse de Fortuné Mollot ». Les deux lots qu'elle acheta également pour y construire sa maison se trouvaient en ville, et les 80 acres de terres agricoles étaient situés immédiatement au sud, à proximité du village. Cette propriété a été achetée à M. Veronneau, le maître de poste local. Sa description légale est la suivante : « La moitié nord du quart nord-est de la section 10 du neuvième canton et du troisième rang ouest du méridien principal du Manitoba, d’une superficie d’environ quatre-vingts acres. » Il est intéressant de noter que cette propriété est située à basse altitude. En fait, c’est aujourd’hui une excellente terre agricole, mais elle est sujette aux inondations et a été surnommée « le marais ». Étant donné qu’il n’y avait pas de fossés de drainage à cette époque, il est probable que cette terre ne convenait qu’au pâturage, et c’est ce que Fortuné a tenté de faire en élevant des bovins et des ovins.
Le village de Fannystelle fut fondé en 1889 par la comtesse Marthe d'Albuféra, une philanthrope parisienne, qui le nomma ainsi en mémoire de son amie disparue, Fanny Rives. Le nom Fannystelle dérive du latin « stella », qui signifie étoile (l'étoile de Fanny). Le projet de la comtesse d'Albuféra fut géré par M. T.A. Bernier, qui encouragea l'immigration de familles nobles et aisées de France. Noël Bernier, un historien manitobain, écrivit l'ouvrage Fannystelle, publié en 1939. Dans ce récit, cette nouvelle colonie est décrite comme « une fleur de France éclose en terre manitobaine »… Une fleur de France qui s'épanouit dans le sol du Manitoba !
À leur arrivée à Saint-Boniface, Ernest, âgé de 14 ans, et Marcel, âgé de 13 ans, furent rapidement inscrits et placés en pension au Collège Saint-Boniface, situé au 200 rue de la Cathédrale, sous la direction des Pères Jésuites. D'après les archives du Collège Saint-Boniface, les garçons y restèrent trois ans.
Cependant, quelques semaines plus tard, une mauvaise nouvelle arriva de France : la vente du Château Blandin avait échoué. Fortuné chargea alors son beau-frère, J.P. Algoud, de relancer la vente. Le Château Blandin fut finalement vendu à la famille Ballofay, mais pour un montant bien inférieur à leurs attentes et à l’offre précédente qui avait échoué.
Le 19 octobre 1892, Fortuné, Léopoldine, Gabrielle, âgée de 17 ans, et Marie Louise (Lily), âgée d'un an et demi, s'installent à leur destination finale : Fannystelle, au Manitoba, au Canada ! De toute évidence, ils étaient loin d'être préparés à ce qui les attendait ! Fortuné n'avait jamais vraiment exercé d'emploi stable. Depuis son adolescence, il se consacrait à la peinture et à son art. Imaginez la scène ! Pinceau à la main et toile sous le bras, il s'installe avec Léopoldine et leurs quatre enfants à Fannystelle, au Manitoba, au Canada. Ils avaient fait venir de France la plupart des objets non essentiels pour survivre aux rigueurs de l'hiver et à la nouvelle vie à la ferme : une machine à mayonnaise, des couverts de famille ornés des armoiries, quelques meubles Louis XVIII, un crucifix de 90 x 120 cm sur un grand cadre, des piles de livres de littérature française, une encyclopédie, une bible, des boîtes de lettres et de souvenirs, ainsi que plusieurs tableaux que Fortuné avait réalisés à Blandin.
Dans les archives familiales, nous conservons quelques photos en noir et blanc prises en 1893 et 1894 sur une estrade devant une maison. On y voit des membres de la famille et du voisinage. Ces photos témoignent de la vie rude de l'époque… un peu comme une scène du Far West sortie d'un film de John Wayne !
Photo prise sur le perron – famille et amis. Fannystelle, avril 1894. De gauche à droite : M. Allard, Rosenberg, de la Borderie avec Lily Mollot sur ses genoux, Mme Léopoldine Mollot, M. Marchisio, Duflot, Thomas et Mlle Gabrielle Mollot.
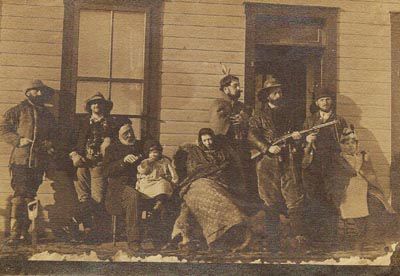
1816 – GÉNÉRAL BARON JEAN-JACQUES D'AZEMAR (16)
Lorsque la famille Mollot arriva à Fannystelle le 19 octobre 1892, le village ne comptait que six maisons, une école, une église, une laiterie appartenant à Pierre Rosenberg, une forge tenue par Honoré Lavasseur et une grande écurie. C'était tout ! Il n'y avait même pas de chemin de fer. En 1892, la ligne du Canadien Pacifique (CP) ne desservait que Starbuck, le village voisin, à treize kilomètres à l'est. Hormis le courrier du maître de poste, M. Veronneau, le seul moyen de communication était le télégraphe, et il fallait se rendre à Starbuck, puis à la gare du CP, en calèche sur des routes en très mauvais état. Selon l'annuaire Henderson de 1892, conservé à la Société de généalogie du Manitoba, le village de Fannystelle comptait seulement trente habitants ! Imaginez : seulement vingt-quatre autres personnes en plus de la famille Mollot.
Dans ses mémoires, Fortuné décrit son expérience ainsi : « Ce qui m’a le plus frappé dans ce lieu, c’est l’étrange mélange des mondes civilisé et sauvage, si différent de celui de l’Europe. Cela m’a brisé le cœur ! » La vie devait être extrêmement difficile durant ces années de pionniers.
Comme mentionné précédemment, les Mollot avaient acheté au maître de poste, M. Veronneau, un terrain de 80 acres bordant la ville au sud. À cette époque, comme vous pouvez l'imaginer, les terrains étaient très bon marché.
Le problème auquel ils étaient désormais confrontés était : « Où vivre ? » Comme indiqué dans ses mémoires et dans un article du journal « Le Manitoba » daté du 9 novembre 1892, Fortuné engagea un certain M. Cinq-Mars pour construire une nouvelle maison en ville, mais elle ne serait pas habitable avant au moins quatre mois. Heureusement, une des maisons de fortune de la ville se libéra et ils la louèrent. Dans cette maison louée, selon Fortuné, « nous vivions avec nos malles et nos caisses éparpillées un peu partout, transformées en chaises. Seul le piano, notre premier achat important au Canada, se dressait, si beau et tout neuf, au milieu de ce fouillis de bois brut. » Le piano avait probablement été acheté pour leur fille aînée, Gabrielle, musicienne très talentueuse, et pour Léopoldine qui aimait en jouer. En janvier 1893, les Mollot purent enfin emménager dans leur nouvelle maison ! Outre le fait de n'avoir que des lampes à pétrole pour s'éclairer et du bois pour se chauffer et cuisiner, il y avait un autre problème… l'absence d'eau courante ! En raison de la dureté de l'eau souterraine, toute l'eau destinée à la consommation et à la toilette devait être acheminée par des citernes tirées par des chevaux ou puisée dans des étangs ou dans la neige fondue.
Globalement, le contraste était saisissant entre le mode de vie de Blandin et celui de Lyon : d’une somptueuse demeure de 1 547 m² à Blandin à une modeste maison de style prairie à ossature bois de 65 m² à Fannystelle, au Manitoba, au Canada ! La maison Mollot, aujourd’hui disparue, se trouvait à l’angle de la rue, juste en face de l’église actuelle, du côté est.
Cette photo a été prise à la fin des années 1890. La maison a été vendue vers 1903 à la famille Black. Remarquez l'église, tout à droite. Dans ses mémoires, Fortuné indique que le premier hiver n'a pas été aussi terrible que prévu. Cependant, Léopoldine racontait, à maintes reprises, qu'il faisait si froid dans la maison que le pain gelait comme de la pierre et qu'au début, elle se demandait pourquoi il devenait si dur du jour au lendemain ! De l'avis général, la vie dans une nouvelle colonie des Prairies au début des années 1890 devait être un véritable défi : peu de courrier de Postes Canada, pas de téléphone, pas de télégraphe, pratiquement aucune communication avec le monde extérieur, pas d'eau courante, seulement des toilettes extérieures, pas d'électricité, un chauffage insuffisant dans les maisons pendant les hivers rigoureux, des maisons mal isolées, pas de voitures ni de tracteurs, seulement des chevaux et des mules pour se déplacer et travailler la terre. Pour se nourrir, les familles devaient se contenter de ce qu'elles pouvaient cultiver ou élever. Les épiceries n'ont fait leur apparition qu'avec la croissance démographique de ces petites villes. On se demande comment elles ont pu survivre !

BARON GENERAL LEOPOLD MICHEL MARTIAL d'AZEMAR- 1804-1888 (18)
Environ un an après leur arrivée, le 22 octobre 1893, naquit Marie Thérèse Albertine (25 ans). Ce fut le dernier membre de la famille.
Durant les années qui suivirent, de 1893 à 1903 environ, Fortuné tenta de se lancer dans l'agriculture en élevant des bovins et des ovins… mais sans grand succès. Selon l'Index généalogique canadien de 1901, Fortuné était répertorié comme agriculteur. Pour reprendre ses propres mots : « L'hiver 1894 marqua le début de nos premières déceptions. Jusqu'en 1902, ce ne fut qu'une succession de déceptions ! J'aurais dû abandonner l'élevage et l'agriculture. »
Selon le certificat de titre n° 28191, après avoir eu peu ou pas de succès dans l'agriculture, Fortuné et Léopoldine ont abandonné l'idée de cultiver la terre et ont vendu les 80 acres le 19 novembre 1903. Ce fut sans doute un autre revers dans leur vie.
À la fin de 1895, Gabrielle (20 ans), à la grande déception de ses parents, comme le relate Fortuné dans ses mémoires, s'installe à Winnipeg pour poursuivre sa carrière musicale. Elle ouvre un studio de musique dans la salle 22 de l'immeuble Clement, au-dessus du magasin de pianos Mason & Rich, sur la rue Main. Ernest (17 ans) et Marcel (16 ans), ayant terminé leurs études au collège de Saint-Boniface, trouvent du travail.
Après seulement trois ans passés dans ce pays, Fortuné, âgé de 50 ans, et Léopoldine, âgée de 43 ans, se retrouvèrent pratiquement seuls à la maison avec leurs deux bébés : Marie Louise (Lily), âgée de 4 ans, et Thérèse, âgée de 2 ans. Il y avait en réalité dix-huit ans d’écart entre Gabrielle, l’aînée, et Thérèse, la cadette. De l’avis général, la famille vivait chichement de ses maigres héritages. Fortuné tenta de cultiver la terre et continua de peindre ; l’un de ses grands projets était la réalisation de scènes religieuses au plafond de l’église de Fannystelle. Malheureusement, l’église brûla en 1912 et toute son œuvre fut perdue ! Léopoldine créa alors une troupe de théâtre à Fannystelle, composée d’amis qui se réunissaient chez elle pour répéter des pièces.
Une vieille amie de la famille, Donalda Guilbeault, aujourd'hui disparue, aimait raconter des anecdotes sur la famille Mollot et leur implication dans les spectacles de théâtre destinés au divertissement familial. L'historien Noël Bernier, qui a retracé l'histoire de Fannystelle, décrit lui aussi avec force détails les séances de spiritisme organisées chez les Mollot pour la communauté. La musique et les arts s'épanouissaient dans leur foyer, et il est remarquable que leurs trois filles, Gabrielle, Lily et Thérèse, aient toutes embrassé une carrière artistique. De plus, la tradition s'est perpétuée de génération en génération. La fille de Thérèse, Yolande, a connu une brillante carrière d'actrice en Angleterre et à Hollywood.
À proximité, la statue de Fanny Rives. De gauche à droite : Marie Louise, Léopoldine avec Thérèse. Une grande reproduction de cette photo est aujourd’hui accrochée au fond de l’église.
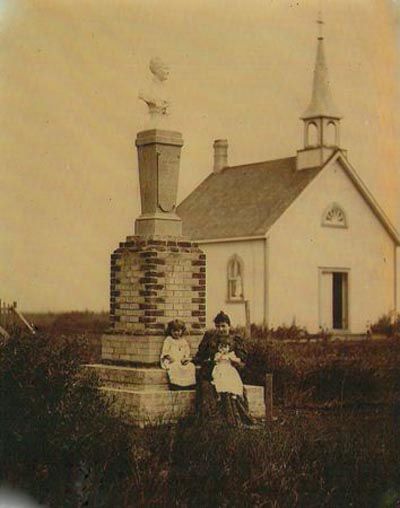
Église du Sacré-Cœur, Fannystelle, 1894.
Partie 17 : Événements et circonstances (suite)
Le chapitre suivant de la vie de Fortuné et Léopoldine a été principalement compilé à partir d'informations tirées des recensements canadiens de 1906, 1911 et 1916, ainsi que du répertoire Henderson de Winnipeg de 1898 à 1945. Voici le scénario probable :
À l'été 1904, Fortuné, la terre ayant été vendue, abandonna l'agriculture. La maison Mollot d'origine fut vendue à la famille de M. Jack Black, le nouveau forgeron et agent de police du village, et Fortuné, âgé de 59 ans, Léopoldine, âgée de 52 ans, et les deux plus jeunes, Marie Louise, âgée de 13 ans, et Thérèse, âgée de 11 ans, s'installèrent à Winnipeg. Cependant, pour l'année 1904, nous n'avons pas pu identifier d'adresse précise à Winnipeg. Il est fort probable qu'elles aient toutes vécu chez Gabrielle.
À cette époque, les trois aînés vivaient de façon autonome. Ernest, âgé de 25 ans, travaillait à Winnipeg ; Marcel, âgé de 24 ans, était marié et tenait une boucherie à Fannystelle. Gabrielle, âgée de 29 ans, selon une publicité du Manitoba Free Press datée du 7 septembre 1903, avait ouvert un studio de piano au Collège de musique de Winnipeg, rue Notre-Dame Est. D'après les registres scolaires des Sœurs du Saint-Nom, les deux plus jeunes, Marie Louise, âgée de 13 ans, et Thérèse, âgée de 11 ans, fréquentèrent l'école St. Mary's de 1904 à 1906. À cette époque, l'école St. Mary's, située à l'angle des rues Carlton et St. Mary's, au centre-ville de Winnipeg, relevait de l'archidiocèse de Saint-Boniface, car celui-ci n'avait pas encore été créé en 1908.
D’après ces recherches, nous savons que Fortuné et Léopoldine Mollot ont vécu à Fannystelle pendant seulement 12 ans, c’est-à-dire de 1892 à 1904.
Entre 1905 et 1907, Gabrielle décida de poursuivre ses études musicales au Conservatoire national de musique de Paris, à l'Université de Paris. En août 1906, Fortuné, Léopoldine, Marie Louise, âgée de 15 ans, et Thérèse, âgée de 13 ans, se rendirent en Europe pour lui rendre visite à Paris. Diverses cartes postales, envoyées de France au Canada et vice-versa, datées du 10 août 1906 au 28 mars 1907 et adressées à Marie Louise, Thérèse, Fortuné ou Léopoldine, attestent de leur séjour d'environ un an en France. Ces cartes postales nous apprennent également que la famille rendit visite à des proches à Lhuitre, village voisin de Trouans, berceau de la famille Mollot. Elles visitèrent aussi Die, ville gallo-romaine d'origine des Benoît, et Lyon, ville natale de Fortuné. Toute la correspondance destinée à la famille à Paris était adressée aux deux adresses où Gabrielle a vécu pendant ses études à Paris : 37, rue Davioud, dans le 16e arrondissement, un beau quartier près de la Tour Eiffel appelé Passy, et 62, boulevard de Strasbourg, tout près de l'université.
Selon une liste de passagers obtenue auprès d’Archives Canada, Fortuné, Léopoldine et les trois filles sont toutes rentrées au Canada le 1er août 1907 à bord de l’« Empress of Ireland », Québec étant le port d’arrivée.
À leur retour de France en août 1907, Fortuné et Léopoldine s'installèrent à Winnipeg, à une adresse inconnue. Par ailleurs, selon les registres scolaires de l'école St. Mary's, Marie Louise et Thérèse, alors âgées de 14 et 15 ans, y retournèrent pour y poursuivre leurs études.
De 1907 à 1919, Fortuné et Léopoldine ont vécu à différentes adresses à Winnipeg.
Leurs adresses confirmées à Winnipeg sont établies d'après les lieux et dates figurant sur des lettres et cartes postales personnelles, l'annuaire Henderson de Winnipeg et les recensements canadiens de 1911 et 1916. Toutefois, lors des recensements de 1911 et 1916, Fortuné, alors âgé de 66 et 70 ans respectivement, était enregistré comme résidant à Fannystelle, à la campagne, chez la famille de Marcel Mollot, tandis que dans le recensement de 1916, Léopoldine vivait avec Gabrielle en ville. D'autres documents indiquent qu'elles résidaient toutes deux en ville.
D'après l'annuaire Henderson de Winnipeg de 1908, Fortuné est répertorié comme artiste et la première adresse de la famille à Winnipeg est le 405, rue Sherbrook. Ernest y travaille comme contremaître à la blanchisserie Standard et Gabrielle comme professeure de musique. Tous deux habitent à cette adresse. De plus, selon un document de 1908 provenant de l'église Sainte-Marie, la famille figurait sur la liste des paroissiens et des donateurs.
1909 - Annuaire Henderson de Winnipeg - La famille est répertoriée comme résidant au 173, rue Langside. Fortuné est mentionnée comme artiste ; Ernest comme contremaître à la blanchisserie Standard ; Gabrielle comme professeure de musique ; et la profession de Lily n'est pas précisée. Des lettres personnelles datées du 30 août 1911, adressées à la famille, étaient également à cette adresse.
Il est important de noter que dans l'annuaire de Henderson, seuls les membres du foyer qui travaillaient étaient répertoriés. Par conséquent, la femme au foyer n'y figurait pas, sauf si elle exerçait une activité professionnelle à l'extérieur. Les enfants n'étaient pas non plus répertoriés.
1911 - Annuaire Henderson de Winnipeg - La famille habite toujours au 173, rue Langside. Fortuné est recensé comme artiste, Gabrielle et Lily comme professeurs de musique, et Ernest comme contremaître à la blanchisserie North West. Ernest réside maintenant au 158, rue Carlton.
1912 - Annuaire Henderson de Winnipeg - La famille réside désormais au 17, avenue Fawcett. Gabrielle et Lily sont recensées comme professeures de musique et Thérèse comme employée de bureau à la Great West Life Insurance Co. Des lettres personnelles datées du 12 février 1912, adressées à ces membres de la famille, sont également envoyées à cette adresse. Ernest, contremaître de la blanchisserie North West Laundry, habite maintenant au 779, rue Home, à quelques pas de son lieu de travail.
L'adresse du 17, avenue Fawcett revêt une signification toute particulière pour le Dr Marcel Mollot, arrière-petit-fils de Fortuné et Léopoldine. Marcel a exercé la dentisterie à quatre maisons de là pendant près de 35 ans, ignorant tout du fait que ses arrière-grands-parents avaient autrefois habité si près. Le monde est petit !
1913 - Annuaire Henderson de Winnipeg - La famille déménage à nouveau au 635, rue Furby. Gabrielle et Lily sont recensées comme enseignantes au Conservatoire de musique de Columbia. Thérèse est recensée comme sténographe à la Great West Life Insurance Co.
1914 - Annuaire Henderson de Winnipeg - La famille déménage au 326, rue Young, bloc Davidson, bureau 1. Fortuné est répertoriée comme artiste. Lily est répertoriée comme professeure de musique et Thérèse occupe toujours le même emploi à la Great West Life Insurance Co. Gabrielle continue d'enseigner au Conservatoire de musique de Columbia, mais réside désormais à une autre adresse : 446, rue Langside.
1918 - Annuaire Henderson de Winnipeg - Fortuné, Léopoldine et Gabrielle résident désormais au 366, avenue Qu'Appelle, appartement 503, avec vue sur Central Park, dans l'immeuble Warwick. Une lettre personnelle adressée à Fortuné et Léopoldine, datée du 11 septembre 1918, confirme également cette adresse. Gabrielle, toujours professeure de piano, a son studio de musique au Conservatoire canadien de musique. Thérèse travaille toujours à la Great West Life Insurance Co., mais réside maintenant rue Carlton. Un nouveau Mollot apparaît : Marcel Mollot, propriétaire de l'épicerie « Le Bon Marché ». Son domicile est indiqué au 53, rue Eugénie, dans le quartier de Norwood.
1919 - Annuaire Henderson de Winnipeg - Fortuné et Léopoldine résident toujours à la même adresse, l'immeuble Warwick. Cependant, ils se font appeler Frank et Grace, comme sur la liste des passagers du navire datée du 1er août 1907, à leur retour de France. Sans doute, Frank et Grace étaient des noms beaucoup plus faciles à expliquer et à utiliser. C'est intéressant ! Gabrielle est maintenant répertoriée comme enseignante au 347, rue Broadway, dans l'édifice de la musique et des arts. On trouve également dans l'annuaire Marcel Mollot, propriétaire du « Bon Marché », et Ernest Mollot, employé du « Bon Marché ».
Le Warwick Block possède une histoire fascinante. Construit au début du XXe siècle, c'est un édifice majestueux aux magnifiques sols en marbre et aux vastes balcons donnant sur ce que l'on appelle aujourd'hui Central Park. Le rez-de-chaussée abritait les chevaux et les calèches. L'immeuble est même doté d'un immense atrium. À son apogée, il devait constituer un ensemble d'une grande beauté. Toujours en activité aujourd'hui, il est classé monument historique.
Il est intéressant de noter que Fortuné et Léopoldine ont toujours vécu soit au centre-ville de Winnipeg, soit dans ce qu'on appelle aujourd'hui le « côté ouest », alors majoritairement anglophone. Ils n'ont jamais résidé à l'est de la rivière Rouge ni dans ce qui s'appelait alors Saint-Boniface, où la plupart des habitants parlaient français. Plusieurs des maisons et appartements de Winnipeg où ils ont vécu existent encore aujourd'hui.
À partir de 1919, les noms de Fortuné et Léopoldine ne figurent plus dans l'annuaire Henderson de Winnipeg ; on peut donc supposer qu'ils ne résidaient plus dans leur propre appartement/maison à Winnipeg.
En mai 1920, Léopoldine se rendit à Timmins, en Ontario, pour rendre visite à sa fille Marie Louise, qui venait de donner naissance à son petit-fils Georges Thériault, né le 25 avril 1920. Elle poursuivit ensuite son voyage jusqu'à Chicago pour voir sa fille Gabrielle, qui y effectuait ses études d'été. Selon un manifeste transfrontalier entre les États-Unis et le Canada daté de mai 1920, Léopoldine indiquait vivre avec son époux Fortuné au 53, rue Eugénie, dans le quartier de Norwood. Cependant, à cette époque, d'après l'annuaire Henderson de Winnipeg, le 53, rue Eugénie était le domicile de leur fils Marcel et de son épouse Eugénie. Marcel avait été courtier en bétail à Winnipeg et tenait également une petite épicerie appelée « Le Bon Marché », située à l'angle nord-est du boulevard Provencher et de l'avenue Taché, dans le quartier de Saint-Boniface. L'épicerie, alors connue sous le nom de « Le Bloc Dubuc », se trouvait juste à côté du pont Provencher, offrant une vue imprenable sur Winnipeg.
Entre 1918 et 1921, la famille Marcel Mollot résidait à Norwood, au 53 rue Eugénie. Leurs trois fils aînés, Archille, John et Gabriel (Barney), fréquentaient le collège Saint-Boniface, tandis qu'Alice était élève à l'Académie Saint-Joseph. Ces informations figurent dans les registres scolaires respectifs.
Durant cette période, la famille Marcel Mollot conserva sa maison de Fannystelle comme résidence principale.
Durant les dernières années de la vie de Fortuné, le couple âgé retourna probablement à Fannystelle où ils vécurent avec la famille de leur fils Marcel, son épouse Eugénie et leurs enfants, comme en témoignent diverses photos de famille datées de 1922, prises au domicile de Marcel Mollot. Il était assez courant à cette époque que les parents passent leurs vieux jours chez l'un de leurs enfants. La maison de Marcel Mollot était d'ailleurs toujours pleine de monde.
Il est également intéressant de noter que durant la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, Fortuné et Léopoldine ont reçu de nombreuses lettres d'amis et de proches en France décrivant les horreurs du conflit et soulignant leur chance de vivre au Canada. Comme chacun sait, la France a subi des pertes humaines extrêmement lourdes : près de cinq millions de soldats ont perdu la vie. Aujourd'hui, dans presque chaque village et bourgade de France, un émouvant monument aux morts commémore ce sacrifice terrible.
Les Archives du Manitoba possèdent un site web, Manitobia.ca, qui contient des extraits de journaux anglophones et francophones datant de 1889 : La Liberté, Le Manitoba, Libre Parole, Echo du Manitoba, Morning Telegram, The Winnipeg Tribune, The Voice, The Daily Nor'Wester et Winnipeg Free Press. Une recherche sur ce site a permis de trouver 580 références à la famille Mollot, dont certaines sont particulièrement intéressantes. Par exemple, dans La Liberté du 7 mars 1916, Fortuné a publié un article s'opposant aux célébrations canadiennes du 14 juillet, jour de la Fête nationale française. Un article humoristique du Winnipeg Tribune du 7 septembre 1940 raconte comment G.C. Mollot (oncle Barney Mollot) a été condamné à une amende de 5 $ par un tribunal du Manitoba pour avoir circulé sur une route interdite avec un camion chargé. Pour effectuer une recherche, tapez Manitobia.ca dans Google, sélectionnez « Français » ou « Anglais », puis cliquez sur « Journaux ». Saisissez ensuite « MOLLOT ». À cette époque, le journal jouait un rôle primordial dans l'annonce des réceptions, des événements familiaux et des voyages, qu'ils soient proches ou lointains. Les éditoriaux et les articles offraient un aperçu des enjeux de société du moment. D'après ces différents comptes rendus d'événements mondains parus dans les journaux de la ville, il semble que la famille Mollot entretenait des liens étroits avec le milieu politique. Elle fut invitée à de nombreuses reprises à la résidence du gouverneur pour des thés et autres réceptions.
Dans des documents tels que les manifestes transfrontaliers, les listes d'immigration, les manifestes de navires et les recensements, les noms étaient souvent mal orthographiés. Si les noms de famille étaient généralement corrects, les prénoms, eux, ne l'étaient pas. Les agents d'immigration et de recensement semblaient davantage s'intéresser au nombre de personnes et à d'autres informations qu'à l'exactitude de leurs noms. Comme mentionné précédemment, lorsque Fortuné, Léopoldine et leur famille ont immigré au Canada à bord du Circassion, le manifeste daté du 25 août 1892 comportait la plupart des prénoms des membres de la famille mal orthographiés. La liste indiquait que les immigrants étaient : « Fortime Jos Mollot et Annis L. Mollot » (Anaïs était son deuxième prénom). Dans le recensement canadien de 1911, Fortuné est orthographié « Fortuna ». Sur la liste des passagers de l'Empress of Ireland, en provenance de France et à destination du Canada, le 1er août 1907, après la fin des études de Gabrielle, Fortuné, Léopoldine et les trois jeunes filles étaient orthographiés comme suit : Frank pour Fortuné, Leafa pour Léopoldine, Mary pour Marie Louise et Tobenelle pour Gabrielle. Seule Thérèse était correctement orthographiée, bien que sans accent. De même, l'annuaire Henderson de Winnipeg de 1919 mentionne Fortuné sous le nom de « Frank » et Léopoldine sous celui de « Grace ». Sur de nombreux recensements et listes de passagers, les officiers ont également mal orthographié la plupart des noms de famille.
Partie 18 La mort de Fortune Mollot
Fortune est décédé à l'âge de 78 ans le 22 avril 1924 et a été inhumé le 25 avril 1924 au cimetière historique de la cathédrale Saint-Boniface, dans la parcelle ouest, rangée n° 2, emplacement n° 4, offrant une vue imprenable sur la rivière Rouge et la ville de Winnipeg. Une copie de son acte de décès a été obtenue auprès des archives paroissiales de Saint-Boniface afin de confirmer ces informations.
Au moment de son décès, tous les enfants avaient pris des chemins différents : Gabrielle et Ernest étaient à Winnipeg, Marcel était établi à Fannystelle, Marie Louise (Lily) à Timmins, en Ontario, et Thérèse à New York. On rapporte qu’à cette époque, Fortuné avait pratiquement dépensé tout son héritage, tandis que Léopoldine disposait encore d’une somme d’argent. Le fait que Fortuné ait dilapidé toute sa fortune et soit mort sans le sou constitue une fin tragique, compte tenu des divers héritages qu’il avait reçus de sa tante, de son père et même de la dot de son beau-père. Les héritages reçus par Léopoldine ont probablement constitué une partie des ressources qui leur ont permis de vivre durant leurs dernières années au Canada.
D'après les récits transmis, il semblerait que Léopoldine, dès son arrivée en 1892, n'ait jamais vraiment apprécié la vie au Canada. Elle aspirait à la culture française, à sa famille en France, à son mode de vie fait de musique et de théâtre ; autant de choses qui lui faisaient cruellement défaut au Canada. De plus, elle trouvait le climat rigoureux et rude.
Peu après le décès de son époux Fortuné, Léopoldine loua l'appartement n° 6 aux Norwood Courts Apartments, au 246, avenue Taché, dans le quartier de Saint-Boniface (Norwood). Cette information figure dans l'annuaire Henderson de Winnipeg de 1924. Le 246, avenue Taché se trouve à seulement un demi-pâté de maisons du 53, rue Eugénie, où résidait alors son fils Marcel et sa famille. Cependant, Léopoldine n'y vécut pas longtemps.
Sans surprise, trente-deux ans après son immigration et six mois après le décès de son époux, Fortuné, Léopoldine quitta le Canada pour ne jamais y revenir. En octobre 1924, à l'âge de 72 ans, elle s'installa à New York chez Thérèse pour aider à élever sa petite-fille Yolande, âgée de 4 ans, tandis que sa fille Thérèse poursuivait une carrière à Broadway. D'après les listes de passagers, un an plus tard, en octobre 1925, Léopoldine quitta New York pour la France. Elle y vécut pendant environ sept ans chez des amis et de la famille, dans des appartements loués, jusqu'en août 1932. À Paris, elle résida quelque temps à l'Hôtel de Turenne, au 6 rue de Turenne. Une lettre datée du 23 octobre 1930, adressée à son petit-fils John Mollot (le père de l'auteur de ces lignes), nous apprend que Léopoldine vivait alors dans un appartement loué à Genève, en Suisse, près de ses proches, les Brodart. Malheureusement, le 2 septembre 1931, en pleine Grande Dépression, Léopoldine, alors qu'elle vivait encore en France, perdit sa fille aînée, Gabrielle, de Winnipeg. Gabrielle, à l'âge incroyablement jeune de 55 ans, mourut subitement d'une crise cardiaque. Ce fut sans doute une terrible épreuve pour Léopoldine car, durant les sept années (1925 à 1932) qu'elle passa en France, parmi ses cinq enfants, Gabrielle était la seule à avoir pu se rendre du Canada pour lui rendre visite durant les étés 1926, 1927, 1928, 1929 et 1930, comme l'attestent les listes de passagers canadiennes. Gabrielle adorait voyager, surtout en France, et, étant célibataire, elle pouvait se permettre de passer du temps avec sa mère outre-mer. Sa mère la regretterait profondément. Elle fut inhumée auprès de son père, Fortuné, au cimetière historique de Saint-Boniface, dans la parcelle voisine, probablement réservée à l'origine à Léopoldine.
La dernière adresse connue de Léopoldine en France indiquait qu'elle vivait chez un cousin nommé R. Vigoureux, au 52, rue de Passy à Paris, comme le mentionne la liste des passagers. Finalement, en raison de l'âge avancé de Léopoldine (80 ans) et de sa santé fragile, sa fille Thérèse vint la rejoindre en France en août 1932. Elles retournèrent ensuite aux États-Unis, plus précisément au 1206 ½ Beachwood Drive à Hollywood, en Californie. C'était alors le nouveau domicile de Thérèse. Toutes ces informations figurent sur la liste n° 13 des passagers étrangers à destination des États-Unis, datée du 23 août 1932. Sur ce formulaire, les passagers devaient répondre à trente-sept questions. Elles quittèrent le port du Havre, en France, le 17 août 1932 à bord du SS « Ile de La France » et arrivèrent à New York le 23 août 1932. De là, elles poursuivirent leur voyage jusqu'à Hollywood, en Californie.
Environ un an après leur arrivée, le 22 octobre 1893, naquit Marie Thérèse Albertine (25 ans). Ce fut le dernier membre de la famille.
Durant les années qui suivirent, de 1893 à 1903 environ, Fortuné tenta de se lancer dans l'agriculture en élevant des bovins et des ovins… mais sans grand succès. Selon l'Index généalogique canadien de 1901, Fortuné était répertorié comme agriculteur. Pour reprendre ses propres mots : « L'hiver 1894 marqua le début de nos premières déceptions. Jusqu'en 1902, ce ne fut qu'une succession de déceptions ! J'aurais dû abandonner l'élevage et l'agriculture. »
Selon le certificat de titre n° 28191, après avoir eu peu ou pas de succès dans l'agriculture, Fortuné et Léopoldine ont abandonné l'idée de cultiver la terre et ont vendu les 80 acres le 19 novembre 1903. Ce fut sans doute un autre revers dans leur vie.
À la fin de 1895, Gabrielle (20 ans), à la grande déception de ses parents, comme le relate Fortuné dans ses mémoires, s'installe à Winnipeg pour poursuivre sa carrière musicale. Elle ouvre un studio de musique dans la salle 22 de l'immeuble Clement, au-dessus du magasin de pianos Mason & Rich, sur la rue Main. Ernest (17 ans) et Marcel (16 ans), ayant terminé leurs études au collège de Saint-Boniface, trouvent du travail.
Après seulement trois ans passés dans ce pays, Fortuné, âgé de 50 ans, et Léopoldine, âgée de 43 ans, se retrouvèrent pratiquement seuls à la maison avec leurs deux bébés : Marie Louise (Lily), âgée de 4 ans, et Thérèse, âgée de 2 ans. Il y avait en réalité dix-huit ans d’écart entre Gabrielle, l’aînée, et Thérèse, la cadette. De l’avis général, la famille vivait chichement de ses maigres héritages. Fortuné tenta de cultiver la terre et continua de peindre ; l’un de ses grands projets était la réalisation de scènes religieuses au plafond de l’église de Fannystelle. Malheureusement, l’église brûla en 1912 et toute son œuvre fut perdue ! Léopoldine créa alors une troupe de théâtre à Fannystelle, composée d’amis qui se réunissaient chez elle pour répéter des pièces.
Une vieille amie de la famille, Donalda Guilbeault, aujourd'hui disparue, aimait raconter des anecdotes sur la famille Mollot et leur implication dans les spectacles de théâtre destinés au divertissement familial. L'historien Noël Bernier, qui a retracé l'histoire de Fannystelle, décrit lui aussi avec force détails les séances de spiritisme organisées chez les Mollot pour la communauté. La musique et les arts s'épanouissaient dans leur foyer, et il est remarquable que leurs trois filles, Gabrielle, Lily et Thérèse, aient toutes embrassé une carrière artistique. De plus, la tradition s'est perpétuée de génération en génération. La fille de Thérèse, Yolande, a connu une brillante carrière d'actrice en Angleterre et à Hollywood.
Partie 19 La mort de Léopoldine Mollot
Léopoldine Mollot, née Benoit, est décédée le 20 avril 1944, à l'âge d'or de 91 ans. Sa tombe se trouve au cimetière Holy Cross à Culver City, dans le Grand Los Angeles, en Californie ; section C-Groupe 144, tombe n° 2.
Heureusement pour Léopoldine, grâce aux héritages reçus de ses parents à leur décès et qu'elle gérait avec sagesse, elle put maintenir un niveau de vie confortable et agréable, notamment de 1924 à 1944, les vingt dernières années de sa vie. Alors que Léopoldine, son époux Fortuné et leurs enfants vivaient encore à Blandin, sa mère, Ernestine Benoit, née Croze, décéda le 22 mars 1887 à son domicile, au 14, rue Villeneuve à Die. Dans son testament, un document de quatorze pages, il était stipulé que Léopoldine devait recevoir un cinquième de la succession. Les quatre enfants et son époux, le docteur Benoit, reçurent chacun une part égale. Une partie de cet héritage, comprenant des placements, des propriétés, des bijoux et de l'argent, provenait du grand-père de Léopoldine, Hubert Croze, qui avait exercé la profession d'avocat à Privas. D'après un tableau de succession récapitulatif détaillé, 82 813 francs ont été partagés, donnant à Léopoldine un cinquième.
Environ quatre mois plus tard, soit le 20 décembre 1892, alors que les Mollot avaient déjà immigré au Canada, le père de Léopoldine, le docteur Benoit, décéda. Là encore, elle hérita d'une somme d'argent et de biens immobiliers considérables. Le testament du docteur Benoit est très détaillé : quelque cinquante-huit pages. Les deux frères et la sœur de Léopoldine se partagèrent à parts égales 91 393 francs. Parmi les biens immobiliers de son père, elle hérita d'une partie du « Martouret ». Sa part de la vente du « Martouret » lui assura des versements annuels substantiels jusqu'en 1908, comme l'indique un acte de vente. De nos jours, ces sommes pourraient paraître dérisoires, mais à l'époque, elles étaient considérables. Fortuné et Léopoldine n'auraient probablement jamais immigré s'ils avaient reçu cet héritage avant leur départ pour le Canada quelques mois plus tôt.
Concernant les finances de Léopoldine, son petit-fils, Georges Thériault père, rapporte que lorsqu'elle s'installa en Californie en 1932 chez sa fille Thérèse, elle investit dans l'immobilier résidentiel à Hollywood, un investissement fructueux. L'analyse de ces documents anciens, rédigés à la main avec soin et méticulosité, est véritablement fascinante. Ce travail a dû représenter un investissement considérable en temps pour les juristes et les comptables ! Il est intéressant d'y découvrir les signatures de certains de nos ancêtres. Ces signatures proviennent de divers actes de naissance, de mariage, de décès, etc.
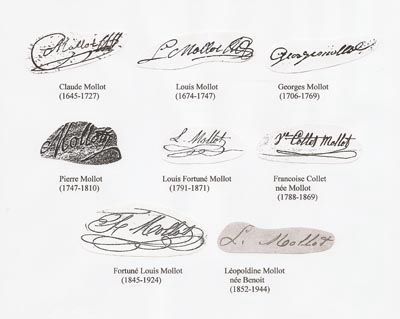
Signatures des certificats de naissance de Mollot
Nul doute que Fortuné et Léopoldine aient connu des moments très décevants dans leur vie, car ils avaient tout au départ, mais leur richesse et leur train de vie leur ont rapidement échappé ! Leur situation financière était un véritable désastre ! Ils se sentaient complètement déracinés en arrivant à Fannystelle, et encore plus au Canada ! Fortuné n'était pas agriculteur… il aspirait à devenir artiste… et Léopoldine n'était pas faite pour le travail à la ferme et la vie rurale. Quelques extraits intéressants des mémoires de Fortuné expriment des sentiments profonds quant à leur immigration au Canada : « Si j'étais venu seul, je ne serais jamais resté », et « Ma femme ne voulait pas que je parte seul, alors, avec l'aide de Dieu, partons ! Nous avons donc tenté notre chance sur une terre qui semblait presque trop belle pour être vraie. »
Un autre événement qui allait bouleverser leur vie fut le décès du père de Léopoldine, le docteur Benoît. Dans ses mémoires, Fortuné indique que si le docteur Benoît était décédé alors qu'ils vivaient encore en France, ils n'auraient pas immigré. La famille Mollot se serait probablement installée à Die, au Martouret. Mais le destin en décida autrement : les Mollot immigrèrent en août 1892, et le docteur Benoît décéda subitement le 20 décembre 1892, six mois plus tard.
Pour Fortuné et Léopoldine, la plus grande récompense fut sans doute de voir leurs enfants prospérer dans ce nouveau pays, même si cela ne fut pas toujours facile. Leurs arrière-arrière-petits-fils, Marc et Roger Mollot, retracent avec humour l'essence de leur vie dans leur chanson et leur CD intitulés « Pourquoi diable suis-je parti ! »
In the book about the history of Fannystelle by Noel Bernier, the author indicates that M. Fortuné Mollot, “Etait un peintre paysagiste de la meilleure école francaise. Madame Mollot était une artiste en musique.’ (Mr. Fortuné Mollot was a well known landscape painter of the best French school. Madame Mollot was an artist in music.) The same type of comments are found in Bernard Mulaire’s Dictionnaire des artistes de langue francaise en Amérique du Nord, University of Laval, 1992.
Aujourd'hui, plusieurs tableaux de Fortuné se trouvent chez ses descendants. La plupart représentent des scènes de nature ou des scènes religieuses. L'un d'eux, comme mentionné précédemment, est une expression de la société française de l'époque. Certains sont signés et datés, remontant jusqu'à 1878, année où il vivait à Blandin, et jusqu'à 1912, année où il résidait à Winnipeg. Fortuné a également peint des meubles dans un style baroque. Au Château de Blandin, aujourd'hui appelé Château de Molinière, plusieurs de ses toiles ornent les murs de la salle à manger. Il existe probablement d'autres œuvres de sa jeunesse en France. Un autre tableau, Mont Blanc, a été acquis à Londres au début des années 1920 et a rejoint une famille de Winnipeg. Pendant les années où les Mollot vivaient à Fannystelle, Fortuné a peint des scènes religieuses au plafond de l'église du Sacré-Cœur. Malheureusement, tout son travail a été perdu lors de l'incendie qui a ravagé l'église en 1912. L'église a été reconstruite et les peintures religieuses ont été réalisées par d'autres artistes. Le talent artistique de Fortuné transparaît clairement dans ses nombreuses peintures sur toile, tissu et meubles. Devenir artiste était son désir… et il peignit toute sa vie. Nous possédons de nombreuses esquisses de divers lieux, à caractère religieux et pastoral. Il transposa ensuite ces dessins sur toile. L'une d'elles, Mont Blanc, représente des scènes pastorales des Alpes autour de Die, et une autre, peut-être inspirée par l'œuvre de Léonard de Vinci, représente Jésus dans les bras de Marie.
Fortuné était également un écrivain d'une grande éloquence, comme en témoignent ses mémoires, ses lettres et même ses poèmes. Il nourrissait des convictions religieuses, sociales et politiques très fortes qu'il n'hésitait pas à exprimer ; cela transparaît clairement dans les nombreux éditoriaux qu'il a publiés dans la presse, et qui sont répertoriés sur le site web Manitobia.ca.
Les enfants, petits-enfants et tous ceux qui ont eu la chance de connaître Fortuné le décrivent comme un rêveur. Artiste, homme de principes et d'une foi profonde, il était cependant un piètre gestionnaire. Son héritage se compose de sa famille, de son art et de ses mémoires.
Léopoldine était une femme cultivée et raffinée qui appréciait la vie citadine et les voyages, passionnée d'art et douée pour la musique et le théâtre. Courageuse, elle a suivi le rêve de son mari au Canada et a surmonté les nombreux obstacles de sa vie. La famille Mollot est aussi son héritage.
Partie 20 : Conclusion
L'histoire de Fortuné et Léopoldine Mollot et de leurs ancêtres est un récit passionnant que nous chérissons tous. Nous avons une ascendance riche et, heureusement, bien documentée. Il est fascinant de constater qu'en consultant notre arbre généalogique, nous pouvons remonter treize générations jusqu'à notre ancêtre direct, Georges Mollot, charron né en 1613 à Trouans, puis huit générations jusqu'à Louis Mollot, marchand de soie né en 1791 à Châlons-en-Champagne, et quatre générations jusqu'à Fortuné Mollot, artiste née en 1845 à Lyon. Et ainsi de suite ! Quiconque lira ce récit pourra lui aussi revivre le passé de la famille.
Nous espérons que ce résumé, « Un voyage au cœur de l’arbre généalogique des familles Mollot et Benoit », fournira les informations nécessaires à la compréhension, à l’appréciation et à la connaissance de notre patrimoine familial. Nous espérons également que les membres de la famille partageront ces informations et les transmettront aux générations futures.
Une suite à ce document est nécessaire pour retracer la vie de la génération suivante ; celle de Gabrielle (21), Ernest (22), Marcel (23), Marie Louise (Lily) (24) et Thérèse (25) !
J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers l'arbre généalogique des Mollot !
Sincèrement,
Vic Mollot