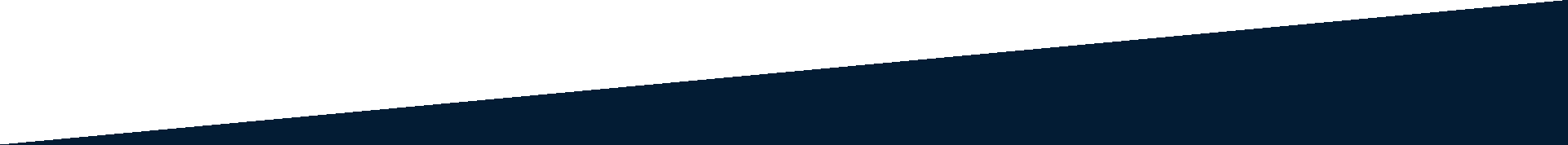LES MÉMOIRES DE FORTUNE MOLLOT
Né le 4 novembre 1845
Décédé le 25 avril 1924
Voici les mémoires de Fortuné Mollot, qui a immigré au Manitoba, au Canada, en 1892, en provenance de Blandin, en France.
Pour télécharger au format PDF, cliquez ici.
DÉDICACE : à ma femme Lucille
Je souhaite dédier ce document à mon épouse Lucille pour son soutien indéfectible à ma passion pour la recherche de nos racines familiales. Ces quinze dernières années, ces recherches nous ont conduits à de nombreuses reprises en France, où nous avons passé de longs séjours dans divers services d'archives et dans de petits villages et villes à la recherche de nos ancêtres. Je dois dire que ces recherches ont été extrêmement fructueuses et enrichissantes. L'engagement et la contribution de Lucille nous ont également permis de mener à bien d'autres projets familiaux. Ces activités n'auraient pas été possibles sans le soutien indéfectible de ma chère épouse.
Août 2008 à Blandin, France.
Vic et Lucille Mollot sont reconnus pour avoir organisé le Tour de France.
PRÉFACE
Les mémoires originaux ont été transcrits à la machine par Yves Marquié car ils étaient difficiles à lire. Ils ont également été transcrits par une amie de Cécile Mestan.
Les mémoires originaux ont été traduits en anglais à différentes époques par Arlan Gates et par Judy Code.
Un comité, composé de Victor et Lucille Mollot, Marcel et Louise Mollot, et Blanche Mollot, a examiné tous les documents et vérifié les informations pour produire l'édition que vous lisez actuellement.
Merci à Alice Mollot d'avoir conservé ces mémoires et à Vic Mollot de les avoir rendus accessibles. Merci également à Louise Mollot d'avoir préparé ce document et d'y avoir inclus des photographies.
Apprécier!
AVRIL 2002
Nous avons également la grande chance que les archives familiales en France existent encore, ayant survécu à des événements terribles tels que les guerres de Religion du XVIe siècle, la Révolution française de 1789-1793, les guerres napoléoniennes du XIXe siècle et les deux guerres mondiales du XXe siècle. Malheureusement, lors de ces conflits, de nombreuses archives ont été détruites.
À mes chers enfants — (Écrit le 18 juillet 1912)
Gabrielle, Ernest, Marcel, Marie Louise, Thérèse -
C’est à vous tous que je dédie ces impressions et souvenirs de mon expérience de vie. Mais c’est pour toi en particulier, Marcel, toi seul qui perpétueras les traditions et le nom de cette famille, qu’ils ont été écrits.
Je crois que ces mémoires vous permettront de mieux me connaître. Peut-être vous épargneront-elles aussi certains regrets que j'ai éprouvés en ignorant de nombreux détails de la vie de mes parents et grands-parents. Si ces détails peuvent paraître insignifiants sur le moment, ils sont souvent perçus plus tard sous un tout autre angle. Grâce à ces informations, nous apprenons à mieux connaître nos proches et, par conséquent, à les aimer davantage.
Au final, elles forgent les traditions familiales, sources de réflexion souvent passionnantes. Parmi elles, des souvenirs de joie et de prospérité, mais aussi de douleur et de tristesse. Chaque génération en porte les marques.
Depuis que mes jambes m'ont privée de toute vie active et m'ont clouée au lit, je connais de longues heures de solitude. Si elles me déplaisent, elles me permettent néanmoins de réfléchir. Ma solitude me donne l'occasion de remonter le temps et de repenser mon parcours, de revisiter, parfois sous un angle très différent, mon histoire et de revivre les moments heureux du passé. Mais il y a tant de choses dans mon passé que j'aimerais effacer ou changer, si seulement je pouvais tout recommencer !
Ce sont donc tous ces souvenirs, agréables et douloureux, que je vais tenter de vous transmettre.
Mais avant tout, je tiens à vous dire que malgré tout, je remercie Dieu de m'avoir donné une telle vie. Si elle a été semée d'embûches et de soucis (dont la plupart sont de ma faute – il est vrai, à tel point, que l'on n'a pas de pire ennemi que soi-même !), elle a aussi été comblée de nombreux plaisirs. D'ailleurs, même si je n'ai jamais connu beaucoup de bonnes choses dans la vie, aucune ne m'aurait donné envie d'échanger ma vie contre la vôtre ! Il faut toujours regarder au-delà des apparences. Et au-dessus, il faut ne voir que le bien et le beau, afin de pouvoir s'efforcer de les atteindre.
Je remercie Dieu du fond du cœur pour tous les bienfaits qu'il m'a accordés. Je le remercie tout particulièrement de m'avoir permis d'être touché par la splendeur de la foi catholique, qui m'a conduit à accepter avec résignation toutes mes épreuves et toutes mes souffrances. Ces mémoires constitueront peut-être une forme de paiement de ma dette envers Dieu.
J'espère de toute mon âme que la lumière de la grâce divine ne cessera jamais de briller sur vous, que vous en serez tous bénis sans exception, et qu'un jour elle nous réunira tous sur les rivages divins du Ciel.
F. Mollot
les expériences de ma vie :
impressions et souvenirs
Situé sur les rives de la Lhuitrelle, petite rivière du département de l'Aube, dans l'ancienne province de Champagne, le village de Trouan-le-Grand, avec sa belle église du XIIIe siècle, est le berceau de la famille de mon père.
Mon grand-père, Pierre Mollot, quitta le village plusieurs années avant le début de la Révolution française pour s'installer à Châlons-sur-Marne. Il se maria en 1787 et fonda un petit commerce spécialisé dans le vêtement, les tissus et les accessoires. Ma grand-mère, Marie Françoise Freminet, était elle-même née à Châlons. Ils eurent deux enfants : ma tante Françoise, qui devint plus tard ma tante Collet, et mon père, né le 15 février 1791. Sa sœur avait deux ans de plus que lui.
C’est au milieu du tumulte révolutionnaire, des guerres qui s’ensuivirent et du grand régime impérial qui suivit que mon père passa son enfance et son adolescence.
Après le décès de mon grand-père le 5 août 1810 et sa retraite de l'armée pour cause de déficience visuelle, mon père vint à Paris et entra au travail dans une maison de commerce de la soie, où il resta plusieurs années. Quelque temps plus tard, son employeur l'envoya à Lyon, qui devint le centre de son activité, puis son lieu de résidence permanent.
À cette époque, le commerce se pratiquait bien différemment d'aujourd'hui. Les chemins de fer n'existaient pas encore. Le transport maritime se faisait à cheval ou en bateau, moyens de transport peu rapides et souvent fastidieux. Les transactions se déroulaient sur de grands marchés ou lors de foires commerciales, comme le Boquaire, dans le sud, qui avait un air d'Europe. Ces événements avaient lieu à date fixe dans chaque région de France. Les acheteurs des maisons de commerce des grandes villes industrielles s'y rendaient régulièrement, emportant les marchandises qu'ils souhaitaient proposer à leurs clients. Mon père fut l'un de ces acheteurs pendant de nombreuses années, d'abord pour le compte d'autrui, puis à son compte. Plus tard, lassé des voyages, il fonda sa propre entreprise et la consacra à la fabrication de la soie, industrie qui avait fait la renommée de Lyon dans le monde entier.
C'est à peu près à cette époque que mon père rencontra ma mère. Compte tenu de sa position privilégiée, il aurait dû, selon les normes sociales, rechercher une épouse d'un rang social plus élevé. Mais il suivit son cœur. Ma mère était la fille de petits agriculteurs travaillant pour le Dauphin, c'est-à-dire de simples paysans. Les grands-parents de mon père, originaires de Trouan, appartenaient au même milieu. Bien que ni mon père ni ma mère ne fussent très jeunes, ils formaient un couple parfait que je considère encore aujourd'hui comme le plus inséparable que j'aie jamais connu. Mon père était extrêmement vif et colérique, du moins envers moi (il est vrai que j'étais une enfant insouciante, espiègle et bruyante). Mais sinon, à la maison, je n'entendais jamais un mot ni ne voyais le moindre signe de dispute ou de querelle. En toutes circonstances, s'il y en avait une, mes parents avaient toujours la dignité et la sagesse de ne pas m'en faire assister. Pendant longtemps, j'ai cru que ce que je voyais chez moi et autour de moi était normal. Cette illusion m'a rendu quelque peu malheureux par la suite, lorsque j'ai réalisé que ce n'était pas le cas partout.
Ma mère était originaire du petit hameau de Viallière, dans le district de Chabon. Elle est née le 31 décembre 1806. Mon grand-père, Joseph Annequin, et ma grand-mère, Marie Malens, son épouse, ont eu six enfants : deux fils et quatre filles : Joseph, Louis, Pauline, Thérèse (ma mère), Rose et Henriette.
Quant à moi, je suis né le 4 novembre 1845. À l'époque, mes parents habitaient un appartement au troisième étage d'un immeuble situé au 4, place Sathonay, dans le premier arrondissement de Lyon. Ma mère ne pouvait pas m'allaiter seule ; c'est l'une de ses sœurs, ma tante Chaboud (Rose), qui s'en chargeait. Elle venait de donner naissance à ma cousine Pauline. Auguste Chaboud, que j'admirais comme un père, était son fils aîné. Il avait onze ans de plus que moi. Je suis resté chez ma tante pendant près de deux ans, à son domicile de Blandin. Mais, naturellement, je n'ai que peu de souvenirs de cette période. Ce n'est qu'après notre déménagement dans notre petite maison de la rue Béguin – que mon père avait achetée pour se rapprocher d'un de ses bons amis, M. Chadebec, dont l'épouse était ma marraine – que j'ai pris conscience de mon existence et que commencent mes premiers souvenirs.
La propriété, qui appartient aujourd'hui à ma sœur, fut agrandie et embellie par mon beau-frère, M. Algoud. À l'époque, elle se composait de deux bâtiments séparés par une cour, reliés au premier étage par une sorte de terrasse formant un passage entre les deux. En contrebas de cette terrasse se trouvait un grand portail carrossable qui servait d'entrée principale. Ensuite, séparé des deux bâtiments et de la cour par un muret à deux colonnes et une grille en fer forgé en son centre, s'étendait un jardin fabuleux qui se terminait par une magnifique enceinte ombragée formée de seize châtaigniers, déjà superbes dans ma petite enfance. Vu de l'entrée, le jardin paraissait beaucoup plus vaste qu'il ne l'était en réalité. Dans la cour, adossée à la plus petite maison, se trouvait une grande pompe synchronisée datant du règne de Louis XV. Lorsque mon père l'ouvrait, ses réservoirs et ses bassins miniatures se dressaient comme un animal immense et fantastique, et c'est avec une certaine appréhension que je m'en approchais.
Mon souvenir le plus ancien remonte à l'époque où le plus grand des deux bâtiments, qui allait devenir notre maison, était en travaux. Nous vivions temporairement dans le plus petit. J'avais peut-être deux ans et demi. Je me souviens de ma surprise lorsque, assise dans un petit peignoir rose près de l'entrée, j'ai vu pour la première fois le tonnerre et la grêle.
Puis il y eut ma première neige. Je me souviens, blottie sur les genoux de ma mère dans la diligence qui nous emmenait de Lyon au Dauphiné, c'était une nuit d'hiver. Le sol était recouvert de neige. Par les fenêtres, je voyais les chevaux trotter devant nous, éclairés d'un côté par la lune et de l'autre par la lanterne. Chacun de leurs mouvements dessinait une danse d'ombres fantastique sur la route. Cette image est restée profondément gravée dans ma mémoire, tout comme celle du gros chien rencontré lors de ce même voyage et que j'ai taquiné avec un bâton.
Je me souviens aussi d'être dans la petite maison de ma grand-mère à Viallière, avec ma tante Pauline et sa fille, qui avait mon âge. Nous jouions le long du ruisseau qui descendait de la vallée de Viallière et traversions le joli hameau pittoresque, ombragé par de grands noyers. Je revois encore les sentiers en pente, jonchés de cailloux qui me faisaient souvent trébucher sous mes petits pieds. Je me souviens aussi de ma tante, de ma cousine et moi marchant jusqu'à Chabon pour accueillir mon père à son arrivée en diligence. Tous ces souvenirs sont si lointains maintenant, mais qu'ils restent doux !
Notre maison de la rue Béguin était un véritable paradis pour un garçon de mon âge. J'y goûtais à une liberté relative (pour un petit enfant, bien sûr) et à une joie de vivre intense, insouciant jusqu'à mes six ans. Notre jardin, qui paraissait immense à ma taille, abritait la magnifique haie de châtaigniers dont j'ai parlé. Une échelle me permettait d'escalader le muret qui séparait notre jardin de celui de ma marraine, Mme Chadebec, et d'étendre ainsi mon espace pour mes promenades. L'hiver ou les jours de pluie, ce qui me faisait le plus plaisir était ma diligence imaginaire. Ma grande chaise haute faisait office de siège de conducteur, cinq ou six chaises devenaient des sièges, et les dossiers des sièges de devant, reliés par de la ficelle, figuraient mes chevaux. Cela m'aidait à passer le temps. Et comme j'étais seul, je n'avais personne avec qui me disputer.
Ma marraine, sa fille, Mme Auray, et sa sœur, qui vivait également avec elle, étaient à mes yeux les femmes les plus charmantes du monde. J'allais souvent les voir, car il me suffisait d'escalader le muret du jardin. J'étais toujours si bien accueillie, caressée et on m'offrait des bonbons ou des jouets, surtout le jour de l'An.
Quelle journée merveilleuse pour un petit garçon ! Dès mon réveil, je récitais ma petite prière, puis ma mère me prenait dans ses bras et m'emmenait à la cuisine, où une table débordait de jouets. Mes parents étaient comblés de joie. Plus tard, mon cousin Auguste et les employés du magasin de mon père venaient déjeuner et m'apportaient un nouveau cadeau. Je ne voulais pas que ces moments de bonheur s'arrêtent.
Mais à mon sixième anniversaire, les soucis et les responsabilités inhérents à la nature humaine — et chaque génération a les siens — allaient commencer pour moi. Je devais aller à l'école et apprendre à lire et à écrire. Ma sœur, qui avait treize ans de plus que moi, venait de terminer ses études au couvent des Ursulines, situé sur la colline de Fourvière où mon père m'emmenait parfois, et était rentrée à la maison.
Chaque jour, elle me conduisait chez une charmante vieille dame, Mme Georges, dont le mari fabriquait des casquettes. Elle tenait une petite école pour enfants rue Guillotière, à cinq minutes de chez nous. C'est là que j'ai commencé à apprendre à lire et à écrire. Mais je prenais déjà plus de plaisir à gribouiller qu'à faire quoi que ce soit d'autre. Les jolies couleurs m'attiraient. En bas de mon école se trouvait une merveilleuse papeterie remplie de couleurs, de stylos, de crayons et bien d'autres choses encore. Je ne passais jamais devant sans m'arrêter pour admirer avec tendresse tout ce qu'elle contenait. Quand j'ai enfin eu en ma possession quelques-uns de ces objets convoités, c'était un véritable événement pour moi. Oh, que de dessins j'ai faits ! Mais comme vous pouvez l'imaginer, mes dessins n'étaient pas vraiment des chefs-d'œuvre.
En 1852, plusieurs événements importants ont ouvert de nouveaux horizons à mon esprit. Pour la première fois, j'ai accompagné mon père et ma sœur à Paris et à Châlons-sur-Marne, où nous avons passé plusieurs semaines chez ma tante Collet, qui vivait seule depuis le décès de son mari deux ans auparavant. Son mari était mon parrain, mais je ne l'avais malheureusement jamais connu. D'après ce qu'on m'a dit, c'était un homme charmant, et mon père l'appréciait beaucoup.
Ce fut un voyage formidable, surtout pour moi. La ligne de train Paris-Lyon était en construction. À l'époque, elle ne desservait que Châlons-sur-Sône ; pour prendre le train jusqu'à Paris, il fallait donc emprunter un bateau à vapeur sur la Sône pour aller de Lyon à Châlons. Je ne saurais décrire le plaisir et la sensation nouvelle que j'ai éprouvés en voyageant ainsi. J'avais l'impression d'aller au bout du monde. J'étais empli de fierté. À Paris, cependant, le plaisir fut quelque peu atténué par la fatigue. Je trouvais souvent nos excursions un peu longues pour mes petites jambes. La visite du parc et du château de Versailles, en particulier, marqua l'imagination d'un enfant de sept ans d'une manière plutôt malheureuse – à tel point que j'en ai longtemps tremblé. Ce n'est que bien plus tard que j'ai décidé d'y retourner. C'est seulement alors, devenu adulte, que j'ai pu commencer à apprécier la splendeur du Grand Roi.
Je me souviens aussi de mon désespoir le jour où je me suis perdue dans les rues de Paris et où j'ai fondu en larmes devant une foule de gens qui me demandaient mon nom. Je n'ai pu que répondre que je m'appelais Fortuné et que je venais de Lyon. Soudain, le visage souriant de mon père est apparu. Imaginez ma joie ! Il me faisait une blague, ai-je appris plus tard, car j'avais la fâcheuse habitude de m'arrêter devant chaque magasin et de devoir ensuite le rattraper. Mais je ne pouvais m'empêcher d'être fascinée par tout ce que je voyais, surtout par les jouets !
J'ai aussi de nombreux souvenirs, aussi vifs que s'ils s'étaient déroulés hier, des moments agréables et amusants passés à Châlons avec ma tante. Je la trouvais un peu trop sérieuse, voire rabat-joie. Mais il est tout aussi vrai que j'étais étourdie et bruyante, et quelque peu pénible pour elle. Le fait qu'elle n'ait pas d'enfants n'arrangeait rien.
Non loin de chez ma tante vivait un vieil ami de mon oncle Collet, un capitaine à la retraite comme lui. Ils avaient servi ensemble sous Napoléon Ier. Ce sympathique vieux capitaine – il s’appelait Normalle – devint un ami très proche. Il avait conservé une personnalité jeune et enjouée, et nous passions de très bons moments ensemble. Souvent, nous faisions de longues promenades dans les vieux quartiers de la ville, par de jolis sentiers ombragés par de magnifiques arbres centenaires, à travers les jardins publics, le long du canal de la Marne ou même directement sur la Marne. Il vivait avec ses deux filles, dont je garde également de tendres souvenirs, dans une jolie maison avec un jardin donnant sur un canal qui traversait la ville et qui servait de lieu de rencontre aux canards, qui s’y ébattaient souvent en cancanant gaiement. Un de nos passe-temps favoris était de « pêcher » les canards. Au bout d’un long fil, j’attachais un morceau de pain et le lançais aussi loin que possible dans le canal. Dès que les canards l’apercevaient, ils accouraient tous. Quand l'un d'eux s'apprêtait à le saisir et à l'avaler, je remontais le fil. Alors, le pauvre canard était obligé de s'approcher ou de me céder ce morceau de pain. Mon compagnon et moi, nous étions pliés de rire ! Ce grand vieux canard, que je visitais avec un plaisir renouvelé à chaque passage à Châlons, mourut en 1867 à l'âge de 86 ans. Jusqu'à la fin, il conserva sa gaieté et son affection pour moi.
Mon père avait beaucoup d'autres parents à Châlons que j'ai eu la chance de connaître. D'abord, sa tante, Mme Fréminet, son fils et ses deux filles, Mme Perurdel et Mme Boullaire, toutes deux mariées et mères de famille. Mon cousin Fréminet était le fondateur d'une Maison de Champagne, aujourd'hui dirigée par ses fils. Parmi les autres parents que j'appréciais beaucoup figuraient la famille Adnet-Collot. M. Adnet travaillait à la préfecture de la Marne et était un ami fidèle de ma tante Collet. Son beau-père, M. Collot, était l'un des dauphins de France, c'est-à-dire né le même jour que le pauvre Louis XVII. Je n'ai jamais connu de personne âgée plus alerte, plus joyeuse et plus enjouée. Les moments passés avec lui étaient toujours empreints de plaisanteries et de rires. Il est décédé à 96 ans, après avoir fêté ses noces de diamant avec son épouse, de deux ans sa cadette, qui fut plus tard inhumée près de lui dans leur caveau.
C’est à mon retour de ces premiers voyages qu’en septembre 1852, ma sœur épousa M. J.B. Algoud. Il était notre voisin depuis longtemps, tout comme ses parents, M. Hippolyte Algoud. Mon nouveau beau-frère aîné ne m’était pas inconnu. Quand j’étais petite, Mme Algoud m’emmenait souvent chez elle, et son fils prenait plaisir à jouer avec moi dès qu’il le pouvait.
Peu après le mariage, il était temps pour moi d'entrer en pension. J'allais bientôt avoir sept ans. L'idée ne m'inquiétait pas ; c'était une nouveauté. Mes parents décidèrent de me placer chez l'abbé Bland à Mulatière, situé à l'entrée de Lyon, près du confluent du Rhône et de la Saône. Dans le petit pensionnat attenant, on trouvait des classes de primaire et l'enseignement des classiques jusqu'en CM2.
L'emplacement du pensionnat sur les collines de la Mulatière était magnifique. La terrasse où nous nous détendions surplombait Lyon, dominée par les pentes de Fourvière et leur statue de la Vierge Marie. On apercevait aussi les couvents de la Croix-Rousse, de Sainte-Claire et de Chartreux. Au premier plan se dessinaient le confluent du Rhône et ses ponts, ainsi que la plaine du Dauphiné, bordée au loin par les sommets des monts Chartreuse et Savoie, et par les Alpes et le Mont Blanc. Par temps clair, ce panorama était d'une beauté exceptionnelle.
Mon initiation à ce nouveau mode de vie commença en octobre 1852. Cela ne me dérangeait pas outre mesure. J'y rencontrai d'autres enfants, impatients de jouer avec moi. Je n'avais besoin de rien de plus pour me consoler de ma séparation d'avec mes parents. De la terrasse, je pouvais même apercevoir le quartier de la Guillotière où nous avions vécu quelque temps. Le simple fait de le voir me satisfaisait, du moins sur le moment. Plus tard, lorsque je dus étudier, j'éprouvai quelques regrets. Si la visite de la maison avait tenu à moi, je suis sûre que je n'aurais pas hésité. Je ne tardai cependant pas à m'acclimater à mon nouvel environnement, grâce notamment à l'abbé Bland. Connu de tous à Lyon sous le nom de « Mère Bland », il prenait grand soin de ses élèves et s'efforçait de nous divertir autant que possible. Les vacances étaient nombreuses tout au long de l'année.
Mon plus beau souvenir reste nos vacances tant attendues à Charbonnière, qui eurent lieu en juillet. Le matin du jour choisi par l'abbé Bland — qu'il avait gardé secret jusqu'au dernier moment —, une série de pétards nous tira du sommeil. Aussitôt, les dortoirs résonnèrent de cris de joie. Nul n'eut besoin d'être forcé pour se lever ce jour-là, malgré l'heure matinale.
Nous nous sommes rapidement rafraîchis, puis avons pris le car pour les bois de Charbonnière, un charmant village près de Lyon où se trouve un établissement thermal très fréquenté par les Lyonnais en été. Nous y avons passé la journée entière. Nous avons déjeuné en plein air, sous les grands arbres qui entourent le restaurant « Bois de l'Étoile ». L'après-midi a été consacrée à des jeux et à des promenades dans la verdure à la recherche de fleurs, de plantes ou d'insectes à collectionner. Cette journée de liberté partielle était exquise et nous l'avons tous trouvée trop courte, bien qu'elle ait été longue. Nous ne sommes rentrés que tard dans la nuit.
Que puis-je ajouter à mon récit des six années passées avec l'abbé Bland, si ce n'est que, malgré tout, elles m'ont paru interminables ? À mon âge, c'était comme passer des années à la campagne dans un régiment. Elles comptaient double. Quand on est petit, ce qui nous hante le plus, c'est de grandir, d'avoir vingt ans. Ce moment paraît si lointain qu'on croit ne jamais l'atteindre. Et pourtant, une fois qu'on y est, tout change !
Je savais à peine lire quand je suis entrée à l'internat. J'étais de nature rêveuse et insouciante ; j'aimais jouer et courir. Les études ne me plaisaient guère. Pendant les cours, je pensais davantage à mes jeux qu'à mes leçons ou à mes devoirs. C'est pourquoi ces six années furent entièrement consacrées à mes cours de primaire et à mes cours de lettres classiques de quatrième et de cinquième. Je n'ai jamais gagné de prix qu'en gymnastique, en écriture et en géographie, cette dernière matière me plaisait surtout pour les cartes que nous devions réaliser. C'est durant cette période que mon talent pour le dessin et le coloriage a commencé à se révéler. Un de mes camarades, un peu plus âgé que moi, possédait une petite boîte de couleurs à l'huile et je l'ai vu réaliser de petits tableaux que je trouvais très beaux. Cela m'a donné envie d'en faire autant. Il s'appelait Léon Caron. Lorsque je l'ai revu plus tard, il était devenu un artiste talentueux.
L'anticipation de mes vacances occupait une place importante dans mon esprit, et je les attendais avec beaucoup de joie. Elles m'offraient une immense liberté, que je sois à Lyon, à Blandin ou à Châlons. À Lyon, mon père m'emmenait souvent dans son magasin. J'y voyais toujours quelque chose qui me plaisait. Le simple fait de me promener sur la route était agréable et intéressant. Je me souviens que j'aimais passer devant une route qui menait au pont de la Guillotière. Dans le virage formé par une autre petite route étroite, la route d'Asperges, qui y rejoignait, j'apercevais une chapelle abritant une statue de la Vierge Marie. L'endroit était éclairé par une lampe et entretenu par une gentille vieille dame à qui mon père donnait souvent une pièce ou deux, si je l'encourageais.
J'accompagnais aussi ma mère dans ses courses. Nous faisions souvent de longues promenades en calèche. De temps en temps, mon père m'emmenait à la crèche, où se trouvait un petit théâtre pour enfants dont les pièces commençaient toujours par la crèche vivante. D'autres fois, il m'emmenait au théâtre Guignol. Tout cela était si passionnant que je ne voulais plus jamais retourner à l'école. Chez mes parents, je pouvais courir à ma guise dans le jardin, ce qui était particulièrement agréable quand mon cousin Auguste était là.
Auguste est arrivé pour faciliter le changement lorsque mes parents m'ont retirée de la nourrice ; encore jeune, je l'aimais déjà beaucoup et ne voulais pas qu'il parte. Il est resté avec nous dès lors, comme un autre enfant de la maison. Plein d'enthousiasme et de joie de vivre, il insufflait une extraordinaire vitalité partout où il allait. À maintes reprises durant la longue et cruelle maladie de ma mère, sa présence réconfortante lui a remonté le moral. J'adorais passer mes journées avec lui, surtout le dimanche, jour où il avait plus de temps libre. Je ne le quittais jamais. Il était un véritable grand frère. Je l'aimais beaucoup et c'était réciproque. Nos deux personnalités ne faisaient qu'une. Il trouvait toujours le moyen de me faire rire. J'ai même appris de lui une anecdote sur mon père ; il en avait été témoin et je l'avais trouvée très amusante.
Mes parents habitaient encore à Sathonay, et c'était peu après mon retour de chez ma tante, qui était ma nourrice. Un jour d'été, nous déjeunions vers 14 heures. Il faisait très chaud et les fenêtres de la salle à manger étaient ouvertes. Soudain, un petit rayon de soleil, qui éclairait la façade de la maison à cette heure-ci, frappa mes parents au visage. Cette gêne fut d'autant plus irritante qu'ils étaient assis à l'ombre. Il s'avéra que des personnes, dehors, s'amusaient avec un petit morceau de verre qui reflétait la lumière du soleil.
Pendant quelques instants, mon père garda le silence. Mais, voyant que le jeu se prolongeait, il finit par perdre patience et dit : « Ces gens n'ont rien de mieux à faire, alors je vais leur donner quelque chose. » Il monta sur une chaise, dos tourné aux fauteurs de troubles, mais bien en vue. Ils continuèrent leur jeu. Soudain, sous leurs yeux ébahis, mon père se pencha brusquement, baissa son pantalon et leur montra une superbe image de la lune – à la vue de celle-ci, le rayon de soleil inopportun disparut instantanément, emportant avec lui les astronomes improvisés qui, dès lors, semblèrent en avoir assez, tandis que nous riions de bon cœur à l'intérieur.
Pendant deux ans, il y eut aussi un locataire à la maison, Paulin Carré, que mon père avait engagé pour son commerce. Cousin de ma mère, il avait alors dix-huit ou vingt ans. Il était plein de vie, mais un vrai commère. Nous n'avons jamais été très proches ; même plus tard, nous sommes restés assez distants. À cette époque, Auguste et lui rivalisaient de farces. Je me souviens toujours de l'une d'elles. Un dimanche, après le dîner, ils aidèrent tous deux notre bonne, un peu ronde et peu avenante, à soulever la nappe. Chacun prit un bout, et, pliant la nappe en deux, ils coincèrent la pauvre fille au milieu et filèrent à toute vitesse vers le jardin, la faisant courir bien plus vite qu'elle ne l'aurait souhaité. C'était un spectacle hilarant : la colère d'Alexandrine, les rires des deux diables. Elle avait envie de les frapper, tandis qu'ils l'esquivaient et la faisaient tournoyer.
Les vacances que j'ai passées à Blandin m'ont également beaucoup plu. Mon père avait acheté la jolie ferme de Mollinière. Là-bas, je n'avais jamais de murs pour limiter mes explorations. Je pouvais errer librement dans les vallées et les collines, certaine de ne rencontrer que des visages amicaux et des gens accueillants, sans me soucier de savoir s'ils étaient bien habillés ou bien logés. La hiérarchie sociale ne m'a jamais beaucoup préoccupée. Dans mes amitiés, j'ai toujours privilégié la courtoisie, la gentillesse, la politesse et la bonté, et je rencontrais ces qualités plus souvent au bas de l'échelle sociale qu'au sommet.
Pendant mes vacances de 1855, alors que je rendais visite à ma tante Collet avec mes parents, nous avons visité la première grande exposition universelle du XIXe siècle. J'avais alors dix ans et je commençais tout juste à apprécier la beauté, et assurément, les œuvres exposées en étaient pleines. Chez ma tante, j'avais déjà remarqué les magnifiques tapisseries de Beauvais, avec leurs forêts et leurs oiseaux, aux couleurs très agréables, qui ornaient les murs de notre chambre. J'ai vraiment regretté par la suite de ne pas les avoir conservées lors de la vente de la maison.
C'est à peu près à cette époque que quelque chose d'étrange commença à m'envahir. Au-dessus de la terrasse où nous prenions notre récréation, séparée par un chemin, se trouvait un pensionnat de jeunes filles. Comme nous, elles allaient souvent visiter les bureaux de la paroisse. Nous nous voyions tous les dimanches. Parmi elles, il y en avait une qui avait captivé mon attention d'une manière très particulière, et lorsque nos regards se croisaient, une chaleur m'envahissait et je pâlissais. Je ressentais une étrange sensation dans tout mon corps. Je ne pouvais pas la définir. C'était à la fois du plaisir et de la douleur. Cette jeune fille était plus âgée que moi, cependant – elle devait avoir 15 ou 16 ans. Un jour, pendant nos vacances, je la croisai par hasard dans notre rue, avec ses parents. Quand je la vis, je me sentais comme une méduse ; je voulais me cacher la tête dans le sable ! Je ne savais plus quoi faire. J'ai dû changer de couleur de la tête aux pieds. Elle a certainement dû remarquer mon trouble, car je l'ai vue sourire en passant. Plus tard, j'ai éprouvé des sentiments presque identiques devant la sœur d'une amie. Mais cette fois, c'était avec moins de difficultés apparentes et avec encore plus d'assurance de ma part, car j'essayais d'attirer son attention par les gestes maladroits que font les enfants lorsqu'ils veulent se faire remarquer. C'était le premier éveil d'un jeune Casanova.
L'année 1858 fut marquée par un heureux tournant dans ma vie : ma première communion. Quel beau et joyeux jour que ce 16 mai ! Mais ce n'est que plus tard que j'ai pu pleinement apprécier toute sa magie et sa joie. Bien que n'étant qu'un enfant, j'en ai toujours gardé un souvenir ému, car ce fut véritablement un jour de bonheur. Depuis, j'ai certes vécu d'autres communions mémorables, mais aucune ne m'a procuré une joie aussi douce que la première.
Je remercie Dieu infiniment pour sa grâce de m'avoir donné de bons parents chrétiens qui ont eu la bonté de m'envoyer dans d'aussi bonnes institutions catholiques. Tout l'enseignement que j'y ai reçu m'a grandement éclairé, pour le présent et, surtout, pour l'avenir.
Cette année-là, j'ai passé mes vacances à Châlons-sur-Marne. C'est là que j'ai vu une comète pour la première fois ; c'était la plus belle que j'aie jamais vue. Elle occupait une place immense dans le ciel. Chaque soir, tout au long du mois de septembre, nous sortions de la ville pour prendre la route de Reims, où nous pouvions l'admirer dans toute sa splendeur.
À la rentrée scolaire, je ne suis pas retourné à l'école de l'abbé Bland. Mon père m'a plutôt envoyé au petit séminaire des Minimes, où j'ai terminé mes cours de lettres classiques de 6e, 5e et 4e. Mais je n'y ai pas non plus rencontré beaucoup de succès. Je ne m'y sentais pas à ma place. L'atmosphère qui y régnait ne me convenait pas. C'est pourtant là que j'ai appris à dessiner. En terminale, j'ai suivi un cours avec un excellent professeur de l'École des Beaux-Arts de Lyon, M. Bonirotte, un artiste de grand talent qui m'a inspiré et encouragé à me dépasser.
Durant mon séjour à Minimes, le malheur s'abattit sur ma famille. Ma pauvre mère commença à ressentir les premiers symptômes d'une terrible maladie. Tous les soins qu'elle prenait ne purent retarder son décès. Elle subit une opération pour un cancer du sein, ce qui lui apporta espoir et soulagement pendant un an ou deux. Mais la maladie revint ensuite avec une violence inouïe, plus forte et plus douloureuse qu'auparavant, et fit de ma mère une véritable martyre durant sa dernière année.
En juin 1860, je reçus une distinction dont je fus très fier. J'étais devenu oncle pour la première fois à sept ans et demi, puis une seconde fois à dix ans. J'allais désormais être à la fois oncle et parrain. Tout cela me paraissait alors tout à fait extraordinaire. À quatorze ans, c'était un véritable honneur d'être l'oncle de trois jeunes enfants : Louis, Marie et Fortuné, mon filleul.
À cette époque, je prenais mes études un peu plus au sérieux. Je comprenais que la routine dans laquelle je m'étais enlisé ne me mènerait à rien de bon. Je demandai à mon père de me faire changer d'établissement afin d'étudier les sciences, qui étaient alors enseignées dès le troisième. Mon père accepta sans hésiter et, en octobre 1861, je devins interne au lycée de Lyon. Je m'investis pleinement dans mes études et y pris même plaisir, car ce domaine me passionnait. À la fin de l'année, mes parents eurent enfin la satisfaction de me voir nominé huit fois pour des prix. En revanche, mes dessins ne progressaient pas aussi bien. Nous avions un vieux professeur maladroit et peu inspiré, incapable de me motiver comme M. Bonirotte. Je le regrettai beaucoup, surtout par la suite.
J'avais bien commencé, mais le décès de ma mère, le 4 décembre 1862, me détourna complètement de mes études. Bien que toujours incertain de mon avenir, j'avais envisagé d'intégrer soit l'École polytechnique de Saint-Cyr, soit le Lycée central. Mais après la disparition prématurée de ma mère, mon père se retrouva seul, et je ne pus envisager de poursuivre mes projets. Ayant perdu l'enthousiasme de ma première année, je retournai en internat au Lycée de Lyon. Je n'avais plus qu'un seul désir : terminer mes études au plus vite, sans chercher à aller plus loin que le baccalauréat, que j'obtins en novembre 1863. J'avais alors 18 ans.
Je me trouvais désormais confronté à la difficile question de mon avenir. J'aurais vraiment aimé intégrer l'école des beaux-arts. Mais mon père, comme la plupart des gens de sa génération (1830), nourrissait un préjugé tenace contre les artistes et refusait catégoriquement d'en entendre parler. Il avait fait fortune dans les affaires et c'était ce qu'il envisageait pour moi. Or, ce genre de métier ne me convenait absolument pas et je savais que je ne serais jamais un homme d'affaires comme lui. Néanmoins, pour lui faire plaisir, je me résignai et, grâce à mon beau-frère, M. Algoud, je commençai comme employé subalterne dans une grande maison de vente en gros d'articles de fantaisie, dirigée par l'un de ses cousins : Magnun Faure & Compagnie, située au 40, rue de l'Impératrice. On ne s'ennuyait jamais dans ce lieu. Depuis mon plus jeune âge, j'appréciais cependant l'activité. Heureusement, je ne m'occupais pas des achats. Mon rôle se limitait à la préparation des marchandises vendues, au rangement des étagères et à la préparation des colis pour l'expédition.
C’est ici que je fis la connaissance d’Aristide Armand, qui devint un de mes bons amis de jeunesse. Nous passions la plupart de notre temps libre ensemble, fréquentant le théâtre, le casino ou l’Eldorado. Nous étions aussi fous de danse. L’Alcazar, en hiver, et la Closerie des Lilas, en été, étaient nos salles de bal préférées. L’Alcazar était une immense et magnifique rotonde patchwork, admirablement décorée à l’intérieur avec deux longs chemins périphériques, dont le plus beau était agrémenté de grottes, de fontaines, de petites cascades et de charmants fauteuils moelleux. Il y avait aussi des tables de café et de restaurant, offrant une vue imprenable sur la piste de danse, où l’on pouvait se rafraîchir et bavarder. Je n’ai jamais vu de salle comparable nulle part ailleurs, dans aucune ville, pas même à Paris. Aujourd’hui, une belle église l’a remplacée. Avec le temps, les splendeurs du monde se transforment. Les temples du paganisme cèdent la place aux sanctuaires. Quant aux hommes qui fréquentaient généralement cette salle, c'étaient les mêmes personnes que l'on croise partout dans ce genre d'établissements : étudiants, fonctionnaires, jeunes hommes d'affaires – en un mot, des jeunes en quête de divertissement. On pouvait parfois y trouver des hommes d'âge mûr, voire des vieillards en quête de fortune. Mais pour ce qui est des femmes, ce n'était pas là qu'on trouvait des modèles de vertu.
À cette époque, l'argent ne coulait pas à flots. Les 25 francs que nous gagnions chaque mois ne nous permettaient pas de faire grand-chose. Mais nous nous amusions tout de même, peut-être même davantage alors que plus tard, lorsque nos bourses furent plus garnies. Pour les grandes occasions, il m'arrivait de demander de l'argent à mon père. Mais je n'obtenais pas toujours ce que je voulais. Je reconnais aujourd'hui que c'était une chance, car il est facile de se laisser emporter. La prudence n'est pas la vertu dominante de la jeunesse. Tôt ou tard, cependant, on paie ses erreurs. Je l'ai appris à mes dépens lorsque, après d'interminables danses, trempé de sueur, j'ai attrapé froid et finalement succombé à une fièvre qui a mis un terme à mes ambitions chorégraphiques. Il m'a fallu plus d'un an pour me remettre de cet état de grande faiblesse. Ce n'est qu'après une saison passée dans les eaux de Royat, une jolie source thermale située au pied du Puy-de-Dôme, que j'ai pu recouvrer mes forces.
Ma maladie m'a contraint à quitter mon emploi chez Magnun. Une fois rétabli, je n'avais aucune envie d'y retourner. Je souhaitais plutôt me lancer dans l'industrie de la soie – la plus importante activité commerciale de Lyon – même s'il me fallait au moins effectuer un court apprentissage. Mon beau-frère m'a embauché dans son entreprise et est devenu mon mentor. Peu de temps après, j'ai réussi à produire une pièce de taffetas de 80 mètres de long, d'une facture plutôt correcte, qui m'a rapporté 100 francs.
C'était au printemps 1864. En juin, le cousin germain de mon père vint nous rendre visite pour la première fois. Nous lui avions rendu visite l'année précédente en Champagne. Bardon, comme on l'appelait, affichait la force et la vigueur d'un jeune homme, bien qu'il eût soixante ans à l'époque. C'est grâce à lui que j'eus l'occasion de faire plusieurs voyages merveilleux. Il était allé à Paris pour l'Exposition universelle et ma tante le recevait chaque année à Châlons-sur-Marne. Mais en dehors de ces lieux, et mis à part son village natal, Lhuiître, il ne connaissait aucune autre région de France. Aussi, il était très désireux de découvrir de nouvelles parties du pays et avait amassé une petite fortune pour pouvoir se permettre ce plaisir.
C’est pourquoi il accepta avec enthousiasme l’invitation de mon père à nous rendre visite à Lyon. Il désirait ardemment voir les montagnes qui manquaient à la Champagne, et je fus choisi comme guide personnel. Je ne pouvais refuser une telle mission, si parfaitement en accord avec mon goût du voyage et de l’aventure. C’est le Midi qui nous attira d’abord. Voir la mer était presque un rêve. Quelle merveilleuse impression elle nous fit à Marseille, et surtout à Notre-Dame de la Garde ! J’étais émerveillé. Nous fûmes même allés en bateau jusqu’au château d’If, la vieille forteresse immortalisée dans le célèbre roman d’Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Cristo. Au retour, le mistral se leva et la mer se mit à s’agiter. Quel soulagement de poser enfin le pied à terre ! Le mal de mer commençait à se faire sentir dans cette petite embarcation.
Toulon et son splendide port nous attirèrent ensuite. Nous fûmes enchantés par notre visite de l'arsenal des chantiers navals Seyne, surtout par la vue du Montebello, l'un des plus beaux navires de la Marine nationale française en 1864. Huit jours après notre retour à Lyon, nous partîmes pour Grenoble et visitâmes la magnifique Chartreuse, ainsi qu'une partie de la Savoie, Aix-en-Provence et Chambéry. Nous passâmes même devant le lac d'Aigueblette et le village de Novalaize, où vivait la plus jeune sœur de ma mère, ma tante Henriette. Elle et son mari, mon oncle Montfulcon, tenaient un petit hôtel dans ce charmant village. Nous y séjournâmes quelques jours, d'abord parce que j'appréciais beaucoup mon oncle et ma tante, mais aussi parce que Novalaize offrait une multitude d'excursions agréables. Mon oncle était marguillier de l'église de Novalaize. Il disposait de quatre cloches dont le son était des plus mélodieux. Artiste accompli, il jouait également du violon avec une parfaite harmonie. Ce fut un grand plaisir pour moi d'aller voir ma tante et mon oncle, car j'étais certain d'être accueilli à bras ouverts.
L'année suivante, en 1865, j'atteignis enfin ce tournant tant attendu de ma vie : mon vingtième anniversaire. Mais cela soulevait une question cruciale : aurais-je la chance d'échapper au service militaire ? À cette époque, l'armée n'enrôlait qu'un nombre limité d'hommes, mais ceux qui étaient sélectionnés étaient soumis à des exigences énormes. Certes, on pouvait se faire remplacer si l'on tirait un mauvais numéro. Mais il fallait être riche pour cela. J'eus la chance de choisir le numéro 504, suffisamment élevé pour m'exempter de la conscription. La garde mobile n'était pas encore organisée ; elle ne fut pas déployée avant la guerre de 1870.
Mon cousin Bardon revint nous voir en mai 1866 et je fus de nouveau son compagnon de voyage. Cette fois, nous fîmes un véritable voyage en Suisse et dans le nord de l'Italie. Ce fut l'un des plus beaux que j'aie jamais faits. Le train nous conduisit d'abord à Genève. De là, nous visitâmes les rives du lac en bateau. Puis nous poursuivîmes notre route vers Lausanne, Berne, Interlake et la Jungfrau. Nous vîmes Lucerne, le lac des Quatre-Cantons, Altorf et Saint-Gothard. Nous nous rendîmes ensuite en Italie et découvrîmes le lac Majeur et les îles Borromées. Nous visitâmes même Milan, où l'enthousiasme était palpable à l'approche de la guerre contre l'Autriche (c'était huit jours avant la bataille de Custoza). Puis nous visitâmes Turin et le col de Saint-Bernard, où nous arrivâmes épuisés après trois heures de marche dans la neige et où nous passâmes la nuit. Nous descendîmes ensuite à Martigny et franchissâmes le col jusqu'à Chamonix, afin de voir le Mont Blanc. Après trois semaines de voyage, nous retournâmes à Genève, puis finalement à Lyon. C'était parfois assez fatigant, mais on n'aurait pas pu être plus heureux que pendant ce voyage.
Malgré notre grande différence d'âge, Bardon et moi nous entendions à merveille. Les moments passés ensemble lors de toutes ces excursions sont restés gravés dans ma mémoire, aussi indélébiles que mes plus beaux souvenirs.
Après mon apprentissage, je fus engagée chez M. et Mme Sisley et Colleuil, fabricants de soie et de vêtements neufs. J'y restai jusqu'au 19 mars 1868, date à laquelle je fis une chute de cheval et découvris le lendemain matin que je ne pouvais plus bouger les jambes. Je devins paraplégique. Deux jours avant ma chute, survenue un dimanche, nous avions organisé une petite réunion entre amis, au cours de laquelle une de nos jeunes voisines, Mlle Hortense Hugenaise, et moi avions joué Les Noces de Jeannette. Lors de la scène de rage où Jeannette jette tout en tirant un tiroir de la commode, je tombai à la renverse et ressentis ma première douleur. Deux jours plus tard, après ma chute de cheval, je fus paralysée.
Après trois semaines d'hydrothérapie intensive, je pouvais me déplacer un peu et faire quelques pas avec une béquille. Dès lors, j'ai dû renoncer à tout projet d'entreprendre, ce qui ne me déplaisait guère. Si ma blessure a eu un aspect positif, c'est que j'ai enfin pu réaliser mon rêve de peindre. Bien que j'aie essentiellement appris par moi-même, je n'ai pas tardé à obtenir des résultats satisfaisants, car j'avais un don inné. Plus tard, lorsque j'ai pu peindre plus facilement, j'ai passé plusieurs mois dans l'atelier de M. Louis Guy, un artiste renommé de Lyon. Je m'y suis alors consacré pleinement et j'ai fréquenté régulièrement les galeries d'art lyonnaises. Cette occupation me plaisait beaucoup et me laissait en même temps le temps de me rétablir. Il m'a fallu deux ou trois ans de traitement pour parvenir à une amélioration vraiment notable. Chaque année, pendant deux saisons, je suivais des cures thermales à Plombière, aux thermes Amélie, à Luchon ou à Biarritz. Entre-temps, je poursuivais mon hydrothérapie, notamment les douches froides. Finalement, j'ai retrouvé des forces dans mes membres et je pouvais marcher assez bien, même si mon pied droit boitait sensiblement. Mais il m'était impossible de courir, même un tout petit peu, ou de danser. J'avais l'impression d'être punie, ou d'avoir péché.
J'ai passé les étés 1868 et 1869 dans les Vosges et les Pyrénées. Mes souffrances s'étant apaisées, je pouvais me divertir et profiter de tous les plaisirs que les stations thermales offraient aux baigneurs. Il m'était d'autant plus facile de me détendre que mon père, à cette époque, ne se souciait guère d'argent. J'avais largement de quoi payer les frais de mon traitement et la plupart de mes loisirs.
En septembre 1869, ma tante Collet décéda. J'étais à Biarritz. Juste après ma cure aux bains de mer, j'avais passé un moment près d'elle. Je lui avais raconté mes activités, et c'est alors qu'elle lisait une de mes lettres que la pauvre femme fut victime d'une attaque. Un télégramme de mon cousin Freminet m'informa de la nouvelle et je partis aussitôt pour Châlons, où mon père et mon beau-frère me rejoignirent pour lui dire adieu. Je regrettais profondément la mort de ma tante, car, surtout durant ses dernières années, elle avait été si gentille et si affectueuse envers moi. Je n'étais plus l'enfant d'autrefois, et je faisais tant de choses pour elle à chacune de mes visites.
Après mes traitements, souvent sur le chemin du retour de Plombière, je prenais la route de Metz, Nancy et Châlons, où je faisais une halte. Puis je retournais à Lyon, en m'accordant un détour par Paris, ce qui était encore pour moi une nouveauté. C'est lors d'un de mes traitements à Plombière que je retrouvai un vieil ami que je n'avais pas revu depuis nos années d'études au pensionnat de l'abbé Bland. Il s'était marié récemment et sa femme était charmante. Nous sommes vite devenus très proches. Ils habitaient non loin de Lyon, à Monplaisir, et je fus leur voisin pendant un temps. Mais le pauvre Morel ! Il avait son lot d'épreuves et de revers. Malgré son activité débordante et son sens des affaires, il peinait à réussir dans ses entreprises. Le pauvre était dur d'oreille, un problème incurable à l'époque.
Nous voici en 1870, année de ruine, de misère et de sang. Elle avait pourtant commencé sous de bons auspices, mais s'acheva en catastrophe. Seuls ceux qui vécurent ces heures de souffrance, qui subirent désastre sur désastre, peuvent véritablement comprendre le contraste entre le début et la fin. Tout l'optimisme initial s'effondra sous le choc des défaites tragiques qui entraînèrent la chute de la France, laissant derrière elles ruine et désintégration. Pourtant, je ne saurais trop louer le courage, l'héroïsme et les actes nobles dont firent preuve, si vains soient-ils, nos soldats dans une bataille qui se profilait depuis des années, mais que nos dirigeants français n'avaient pas su prévoir. Le résultat fut d'autant plus funeste que, tandis que la France s'affaiblissait, l'Europe entière se rapprochait dangereusement de n'être plus qu'un vaste camp retranché. Armée de la tête aux pieds, engluée dans les préparatifs de guerre, l'Europe attendait le massacre général, la gloire suprême de la devise de Bismarck et des Allemands : « La puissance, c'est le droit ». C'était un retour à la barbarie.
Je venais de terminer une cure aux thermes Amélie et me trouvais à Luchon, dans les Pyrénées, lorsque la guerre éclata. En quelques jours, les hôtels se vidèrent et la petite ville, jadis si joyeuse et animée, était désormais déserte. Rien, pourtant, n'aurait pu prédire les terribles événements à venir. Bien au contraire ! Partout, la confiance régnait. On nous persuadait que la guerre serait courte. Comme je devais encore faire une cure aux thermes, je me rendis à Biarritz, où je ne trouvai qu'un seul groupe, composé principalement d'inconnus ! Je n'y restai que quelques jours, car les nouvelles s'assombrirent. Je retournai précipitamment à Lyon – plus précisément, je fus rappelé par les autorités militaires qui recrutaient pour la garde mobile. Malgré mon infirmité, qui m'empêchait d'assumer le service militaire, je fus contraint de me présenter. Je dus comparaître devant le conseil de révision au camp de Sathonay, où je fus mis à l'écart. J'étais attristé de voir partir tous mes camarades et connaissances. Certains sont allés à Paris, d'autres à Belfort. Mon régiment a été envoyé là où il avait le plus de chances de tenir jusqu'à la fin de la guerre et de défendre l'honneur de la France.
Tandis que les événements de cette guerre dévastatrice suivaient leur cours, je restais avec mon père, ma sœur, son mari et leurs enfants, qui vivaient avec nous rue Béguin depuis la mort de ma mère. Nos émotions oscillaient anxieusement entre espoir et découragement au fil des événements. Puis vint le coup de grâce : la trahison de la France. Avec la signature du traité de Versailles, l’Alsace-Lorraine était abandonnée et notre nation devait payer cinq milliards de francs. C’était un coup dur. Pour couronner le tout, à peine le traité signé, la guerre civile éclata à Paris. C’était l’œuvre de la Commune de Paris, ce conseil créé en 1871 qui s’opposait à la paix avec la Prusse. La Commune prônait la rébellion contre le gouvernement français, ce qui ne fit qu’aggraver la ruine de la partie de la France que les Prussiens avaient épargnée. Nous ne pûmes réagir qu’avec horreur et effroi en apprenant que les troupes de la Commune, incapables d’empêcher l’entrée de l’armée française dans Paris, avaient massacré les otages qu’elles avaient faits et détruit les plus beaux monuments de la capitale.
À Lyon, les anarchistes ont tenté, eux aussi, de semer le trouble. Bien que rapidement réprimées, leurs actions ont été contrées par des coups de canon et, à plusieurs reprises, par des sifflements de détonation au-dessus de nos têtes dans le jardin.
Les conséquences de ces terribles événements furent très graves. Mon père, qui souffrait déjà de problèmes cardiaques, était de plus en plus perturbé. Ses crises cardiaques devinrent plus fréquentes et plus douloureuses. Espérant que le grand air de la campagne améliorerait son état, je l'emmenai à Blandin, où il avait de toute façon prévu de passer l'été. Il comptait veiller sur la nouvelle plantation de vignes qu'il avait créée l'année précédente et que la guerre avait interrompue. Malheureusement, sa maladie ne fit qu'empirer et il dut être alité vers la fin du mois de mai, au moment même où la Commune de Paris s'effondrait dans le feu et le sang. Le peu de force qui lui restait l'abandonna et, malgré les soins de notre ami le docteur Chadebec et du docteur Groz de Virieu, il mourut le 11 juin 1871, après six jours d'atroces souffrances. Sa souffrance nous affecta profondément, ma sœur et moi, car rien n'est plus terrible que d'être impuissant à soulager la douleur d'un être cher. Mon père nous avait demandé de l'enterrer auprès de sa femme, au cimetière de Guillotière. Nous avons respecté ses dernières volontés et, après une grande et solennelle cérémonie en l'église de Blandin, son cercueil a été transporté à Lyon pour l'inhumation. Ce furent des jours très tristes pour moi.
Après le décès de mon père et la liquidation de sa succession – que ma sœur, mon beau-frère et moi avons menée à bien sans la moindre difficulté –, j'étais ravi des 25 000 francs qui devenaient ma rente mensuelle. Mon père, peu bavard comme moi, n'avait rien laissé paraître, et je savais qu'il avait subi une perte importante en se retirant du commerce de la soie. Mais je savais aussi qu'il y en avait toujours eu assez pour moi. Je n'ai jamais été excessivement ambitieux. Je voyais l'argent simplement comme un moyen de vivre confortablement. Je ne l'ai jamais considéré comme le seul et unique but à atteindre dans la vie. J'ai toujours essayé de tirer le meilleur parti de ma situation. Heureux d'accepter les bonnes choses, j'acceptais aussi volontiers ma part de malheurs. J'étais plutôt conciliant et tolérant, peu enclin à la confrontation. À mon grand regret, j'étais aussi assez timide. Mais je redoutais de perdre mes libertés. J'étais bien plus artiste qu'homme d'affaires ou comptable. Discuter de questions commerciales était un cauchemar pour moi ; en parler était une véritable torture. Mais par-dessus tout, j’aimais l’indépendance, la liberté, les Lumières et les belles choses. J’étais tout aussi heureux de les posséder dans une petite maison confortable, aménagée et décorée à mon goût, que dans un château somptueux.
Imaginez un peu ce que j'ai ressenti en ayant autant d'argent à ma disposition, moi qui n'avais jamais eu en main que de quoi couvrir mes dépenses quotidiennes ! J'étais désormais propriétaire d'une fortune de plus de 500 000 francs ! Hélas, je dois avouer qu'au début, j'ai perdu tout sens des réalités. Mes projets étaient bien plus ambitieux que ce que je pouvais espérer financer, même avec un tel héritage. Ce fut le cas pour la construction que nous avons entreprise à Blandin. Depuis l'achat de notre ferme, ma mère rêvait d'y bâtir une jolie maison. Sa longue maladie, puis sa mort, ont empêché mon père de la construire. Il s'est contenté, temporairement, de transformer l'un des bâtiments de la ferme en une maison de fortune. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours beaucoup aimé cette belle campagne. À la mort de ma mère, son rêve est devenu le mien, et j'ai longtemps nourri l'espoir de le réaliser un jour.
Quand ce jour arriva enfin, je ne voulais plus perdre une seconde. Je savais que l'atmosphère des grandes villes ne me convenait pas de toute façon. Mais, comme je l'ai dit, j'avais tendance à voir les choses en grand. J'ai été encouragé tout au long du processus par mon architecte, et aussi par mon goût pour les belles choses. J'ai alors surestimé les profits du vignoble que mon père avait créé et que j'espérais agrandir un jour, afin de faire de cette propriété un lieu à la fois grandiose, confortable et agréable à vivre.
Les dépenses se poursuivirent à Lyon où, en attendant la fin des travaux de Blandin, je fis l'erreur de louer une petite villa à Monplaisir, juste à l'extérieur de la ville, pour une somme assez importante. C'est en partie sur les conseils de mon beau-frère, et en partie par plaisir de posséder une calèche, que je me retrouvai là. J'aurais dû me contenter du petit appartement de la rue de la Barre que j'avais loué et meublé avec grand soin, à l'insu de mon père, après le décès de ma tante Collet, qui m'avait légué 42 000 francs. Mon père, notre vieille bonne, Alexandrine, et moi-même étions bien à l'étroit dans la petite maison de la rue Béguin ; ma sœur occupait la plus grande pièce depuis la mort de ma mère, et mon père et moi devions partager une chambre. Frustré par mon manque d'indépendance, j'acceptai l'héritage de ma tante et louai ce petit appartement, qui devint mon atelier. J'aurais dû le garder en attendant mon déménagement à Blandin. Financièrement, j'aurais été bien mieux loti qu'avec la villa de Monplaisir, avec tout le luxe que j'aurais autrement réservé à Blandin. Cette villa si tentante m'a entraîné plus loin que je ne pouvais raisonnablement le faire.
Tout en m’occupant du choix des meubles, des tapisseries et des tableaux, et en pensant à mon avenir à Blandin et à l’achat de chevaux et d’une voiture, je n’oubliais pas que mes membres n’étaient pas encore assez forts pour que je puisse renoncer à mes soins. Dans le journal que je recevais alors, « Le Salut Public de Lyon », j’avais souvent remarqué des publicités pour des thermes, un traitement qui semblait convenir à mon état. Je ne connaissais pas encore la vallée de la Drôme où ils se situaient. Sur les conseils avisés du docteur Chadebec, je décidai de m’y rendre pour une cure. Fin juillet 1871, je pris la route pour le Martouret. Ce fut la première d’une longue série de visites, car c’est là que je devais rencontrer ma femme.
Mes premières impressions ne furent pas des plus favorables. Habitué aux établissements les plus raffinés de France, j'avais raison de penser que, si l'endroit était globalement confortable, moderne et plutôt charmant, les bâtiments anciens étaient en revanche peu attrayants et assez inconfortables. Le voyage lui-même n'avait pas été facile, surtout depuis Valence, où j'avais quitté le train. À cette époque, pour aller de Valence à Die, il n'y avait qu'une vieille diligence délabrée qui transportait voyageurs, courrier et marchandises. Le train n'en était encore qu'à ses balbutiements. Le trajet dura sept ou huit heures. La poussière et la chaleur estivale le rendirent assez fatigant. Néanmoins, le parcours était intéressant, notamment entre Crest et Die, où il devenait particulièrement pittoresque.
Arrivé dans cette vieille ville romaine aux rues étroites, sombres et douteuses, l'une des premières personnes que je vis fut Louis, un garçon aimable et honnête. Il travaillait pour le docteur Benoît et faisait tout, des petits boulots aux bains, en passant par le service en chambre et la conduite de la diligence, qui, à ce moment-là, était chargée de colis et de provisions. Lorsqu'il s'approcha de moi, son visage joufflu arborant un sourire à la fois niais et rusé, et me demanda si je voulais vraiment parcourir les deux kilomètres de montée qui nous séparaient de l'endroit où se trouvait Martouret, je m'irrita. Ce fut tout autre chose lorsque j'arrivai, haletant et en sueur, pour découvrir une chambre horrible, laide et mal meublée où je dus passer deux heures à me laver, me sécher et me changer afin de pouvoir dîner avec mon hôte, qui avait réuni le docteur, sa famille et ses pensionnaires. Je me demandais bien comment j'avais atterri là !
À ce moment-là, j'ai ressenti une forte envie de tout remballer et de reprendre la route pour Lyon. Je n'ai pas osé. Finalement, j'ai conclu que, puisque j'étais déjà sur place, il valait mieux attendre un peu et espérer trouver un prétexte anodin pour partir.
Le lendemain, j'ai pu emménager dans une chambre plus confortable que celle qui m'avait été attribuée initialement. Très vite, j'ai fait la connaissance de plusieurs personnes sympathiques et compréhensives. Après quelques jours, j'ai commencé à apprécier l'endroit, à tel point qu'une fois mes trois semaines de traitement terminées, j'avais hâte d'y retourner pour le mois de septembre, après un bref passage à Lyon pour constater l'avancement des réparations de ma villa à Montplaisir. Malgré mes premières impressions, j'avais été conquis par Martouret, et à la fin du mois de septembre, je l'ai quitté presque avec regret. Bien que plutôt rustique, le mode de vie me convenait parfaitement. J'ai certes dû apprendre à fermer les yeux sur les défauts des autres, bien plus marqués lorsqu'on vit si près les uns des autres. J'étais souvent surpris par certains préjugés des habitants des petites villes, que je trouvais un peu trop bavards et parfois assez étroits d'esprit.
Il y avait aussi une certaine prétention de la part de la famille du médecin qui, avec l'arrogance des nobles, exagérait régulièrement l'importance de son nom, pourtant en réalité plébéien. Quelque obscure alliance ancestrale suffisait à gonfler leur vanité, ce qui arrachait parfois des sourires aux personnes présentes. Mais c'était un petit défaut, et qui n'en a pas ? Je pus apprécier la situation, ne serait-ce que grâce à la gaieté et à l'entrain de Mme Benoît qui l'animaient et la rendaient très agréable. Je fis même la connaissance du fils aîné du médecin, Gabriel, étudiant en médecine à Paris, en vacances à Martouret avec sa famille. Il avait un frère cadet de treize ou quatorze ans, élève au lycée de Lyon. Ses deux sœurs, âgées de seize et dix-neuf ans, avaient souvent une manière moqueuse que je trouvais assez amusante. L'aînée était chargée de disposer les fleurs sur les tables de la salle à manger et du salon. J'éprouvais un grand plaisir à la voir dans ses petites robes légères, conservant son style d'internat, allant et venant avec la grâce d'un oiseau, cueillant des fleurs et les disposant avec goût dans des paniers et des vases au salon et à la salle à manger. La plus jeune, plus joyeuse et élégante, était très drôle. Elle était comme une petite jument sauvage. Il m'arrivait de bavarder avec elle et elle m'amusait beaucoup.
De retour à Lyon fin septembre, je me suis aussitôt consacrée aux préparatifs de mon installation. Je quittai sans trop de regrets la petite maison de la rue Béguin, qui appartenait de toute façon à ma sœur. Je me suis empressée de trouver un logement pour notre vieille femme de ménage et moi. Je pensais que le moment était venu, puisque la maison était prête, d'accueillir une jeune épouse qui, sans aucun doute, serait ravie dans ce joli endroit, tout décoré, tout prêt, n'attendant plus que sa présence pour l'animer et l'illuminer.
L'hiver 1871-1872 s'écoula, et je restai préoccupé par mon mariage ainsi que par les plans de la construction à Blandin que M. Bourbon, mon architecte, m'avait soumis. Je souhaitais que les travaux commencent au printemps. Ce même hiver, Mme Benoît, avec qui j'entretenais une correspondance régulière, amena sa fille aînée à Lyon pour des cours de chant. Elle avait une très jolie voix et chantait avec passion. Je les vis à plusieurs reprises durant leur séjour à Lyon. J'eus même le plaisir de les recevoir à dîner chez moi, à Monplaisir.
La jeune fille me plut. Sans être particulièrement jolie, elle était charmante et menue, et bien que très délicate et un peu maigre, j'étais persuadé que dans deux ans, elle serait très séduisante. Je pensai alors qu'il serait peut-être judicieux de la demander en mariage. D'après ce que j'avais vu et entendu à Martouret, je savais que le docteur n'avait pas
Une fortune considérable, de toute façon à partager en quatre. Cela m'importait peu. Plaire à la femme qui me plaisait me suffisait. Je pensais avoir assez d'argent pour nous deux. C'est dans cet esprit que j'attendais l'ouverture de la saison thermale à Martouret, bien décidé à y passer de longues vacances et à décider si je voulais ou non épouser cette femme.
J’ai entrepris les démarches nécessaires au début du mois de juin 1872. Je me suis d’abord adressée à mon amie Gabriel, à qui j’ai demandé de transmettre le message à ses parents et à sa sœur. À ma grande joie, elle a accepté avec enthousiasme. Quelque temps après, mon beau-frère est arrivé pour accomplir les formalités. Dès lors, je suis entrée plus intimement dans la vie de celle que j’aimais.
Quel bel été que ce fut 1872 ! Il était empli de joie, d'espoirs, de projets et de douces illusions sur l'avenir. J'avais fait venir mes chevaux et ma calèche de Lyon, ce qui nous permettait de faire de longues promenades à travers la campagne, si riche de ses paysages pittoresques et de ses couleurs chaudes. Ces trois mois passés ensemble furent emplis de bonheur : les préparatifs du mariage, prévu le 5 octobre après la fermeture de l'établissement, et l'achat de nos cadeaux de mariage, que je souhaitais aussi beaux que possible. Ma sœur m'a été d'un grand secours, car elle a toujours eu un goût exquis, et j'en avais grand besoin pour le choix de nos produits de toilette.
Le jour de la signature du contrat arriva. Pour moi, c'était comme se marier à la mairie, une simple formalité légale. Seule la dimension religieuse du mariage revêtait une réelle importance à mes yeux. C'était la consécration devant Dieu de l'union légitime d'un homme et d'une femme consentant librement l'un à l'autre. Une telle union recèle suffisamment d'affection et d'amour pour que les deux personnes ne fassent qu'un pour toujours. Le contrat n'était requis que par la loi civile. Sur les conseils de mon beau-frère, j'ai opté pour la même formule que celle utilisée pour le mariage de ma sœur, celle d'un régime matrimonial commun, ne comprenant que les biens acquis après le mariage. Le médecin a versé 30 000 francs de dot à sa fille et 200 000 francs à moi.
La cérémonie de mariage à la mairie connut au moins un moment cocasse. Pour aller de Martouret à Die en diligence, il fallait traverser un ruisseau. Les pluies récentes l'avaient transformé en torrent. Madame Benoît, déjà très craintive en calèche, fut doublement effrayée de voir ses chevaux s'arrêter au milieu du ruisseau pour reprendre de la vitesse et terminer la traversée. Désespérée, elle descendit de la diligence, au milieu de l'eau, et traversa le reste du chemin à pied, non sans être trempée jusqu'aux os ! Elle dut se changer à la mairie, dans la salle juste à côté de celle où se déroulaient les formalités de notre mariage civil. Ses propos provoquèrent un éclat de rire général, au grand désarroi de Monsieur Goubert, le maire de Die, qui ne put plus prononcer le beau discours qu'il avait préparé pour l'occasion.
Le lendemain, mardi 5 octobre 1872, était le grand jour de la cérémonie religieuse. J'étais néanmoins soulagé d'en voir la fin ; ces défilés, où l'on joue le rôle principal, où l'on attire toute l'attention et où l'on est le sujet de toutes les conversations (même si la plupart sont plus ou moins aimables), sont d'un ennui mortel. J'aspirais à ce que toute cette cérémonie prenne fin pour pouvoir retrouver ma vie ordinaire. J'en étais venu à chérir le proverbe : « Pour être heureux, menez une vie privée. »
Le somptueux dîner qui suivit la cérémonie réunit nos parents et leurs amis les plus proches. Ma sœur, mon beau-frère et leurs enfants, Louis, Marie et Fortuné, mon cher cousin Auguste Chaboud et Aristide Armand, mon meilleur ami, étaient tous présents. Du côté de mon épouse, toute sa famille de Martouret était venue nous rejoindre, y compris son grand-oncle, le général d'Azémar, et sa fille, venus de leur domicile de La Voulte, ainsi que son cousin germain, Paul Bodart, arrivé de Marseille. Madame Massoneau, une amie de la famille parisienne qui avait passé le mois de septembre avec nous à Martouret pour suivre un traitement, avait également été invitée. C'est elle qui s'occupa de tous les moindres détails, contribuant ainsi à la beauté de l'événement. La journée s'acheva par un bal traditionnel.
Les festivités enfin terminées, ma chère épouse et moi avons quitté Die et le Martouret le lendemain matin. Nous avons rejoint la maison que j'avais préparée pour elle et dont elle allait désormais devenir la maîtresse. D'une certaine manière, c'était notre première lune de miel. Nous allions éviter la monotonie des hôtels, puisque nous aurions une maison entière pour nous seuls. Pour ma femme, l'expérience était aussi nouvelle et excitante qu'un voyage.
Cet hiver-là, nous fûmes partis en lune de miel une seconde fois, d'abord à Paris, où je pris plaisir à lui faire découvrir la ville, puis à Châlons, où je la présentai à la famille de mon père et à quelques amis qui y vivaient encore. Mais ce n'étaient que des préludes à la véritable raison de ce voyage, que j'avais organisé pour qu'il coïncide avec l'Exposition universelle de Vienne, en Autriche, en mai 1873 : nous allions explorer les merveilles de l'Italie. Depuis sa jeunesse, elle rêvait de voir le Saint-Père et le Vésuve ; quant à moi, Naples, Venise, Rome et les splendeurs du musée de Florence m'attiraient.
De ce fait, Vienne et son exposition universelle passèrent au second plan. Malgré la fatigue, nous gardions d'excellents souvenirs de l'Autriche et de sa capitale, où nous avions la chance d'avoir comme guide un ancien employé de mon père. Jeune Autrichien, il était venu à Lyon pour apprendre le français. Il s'était récemment marié à une femme avec laquelle nous nous entendions à merveille. C'est également lors de ce voyage que nous avons eu l'occasion de visiter les grottes d'Alderbéry, l'une des merveilles naturelles les plus époustouflantes d'Europe.
Lorsque j'ai présenté ma chère épouse à sa nouvelle villa de Monplaisir, j'étais certain de son bonheur. Elle avait quitté Die, ville sans grand charme, pour se retrouver rapidement dans une atmosphère élégante, artistique et confortable qu'elle appréciait sans aucun doute. Durant les quelques mois passés à ses côtés à Martouret, j'avais constaté qu'elle possédait toutes les qualités d'une femme charmante. On disait d'elle qu'elle était la perle de Martouret. J'avais éprouvé une immense joie à partager les nombreux plaisirs de sa nouvelle vie, ainsi que sa transformation d'une jeune fille naïve en une femme accomplie. Mais malgré toutes ces qualités indéniables, elle avait du mal à se maîtriser. Sensible, elle s'irritait pour un rien. Il lui arrivait souvent de blesser, d'offenser, voire d'indigner son entourage par ses paroles.
J'étais à la fois ravi et attristé par cet esprit critique, observateur et dominant, si caractéristique de la famille Benoît. Je compris rapidement que je ne pourrais, comme je l'avais rêvé, faire de ma femme la confidente de mes peines et de mes soucis, mais seulement de mes joies. De nature un peu introvertie, peu communicative, je ne pouvais m'ouvrir qu'aux personnes qui manifestaient de l'affection, de la gentillesse ou de la sympathie. Dès le début, certaines de ses critiques me touchèrent profondément : je n'aurais pas dû meubler la villa avant le mariage, car elle aurait préféré une chambre de style Louis XVI à celle de style Louis XIII que j'avais choisie ; elle aurait préféré vivre à Lyon plutôt qu'à Monplaisir ; et enfin, puisqu'elle n'aimait pas la campagne, pourquoi diable construire une maison à Blandin ? J'aurais sans doute mieux fait de sacrifier mes rêves de jeunesse, mes aspirations et mes désirs avant qu'elle n'entre dans ma vie.
Je dissimulais néanmoins ma peine au plus profond de mon cœur et cherchais un moyen de me réconcilier. Quitter Monplaisir, m'installer dans un appartement en ville et ne plus vivre à Blandin que par beau temps, n'était qu'une question d'argent. Avec les dépenses déjà accumulées et celles à venir, il me fallait augmenter mes revenus. Les vignes de Blandin ne me rapportant plus suffisamment, je me tournai vers la bourse et me lançai dans quelques spéculations à la Bourse de Lyon. Cela me permit de continuer à me consacrer à la peinture.
Par conséquent, nous avons déménagé à Lyon, dans un bel appartement situé au 2, rue de la Bourse, au début de l'hiver 1874. Le 4 décembre 1875, notre première fille, Gabrielle, est née. Elle était l'objet de tous nos désirs. Elle a été baptisée le jour même de sa naissance, mais nous avons réservé les grandes cérémonies pour après la convalescence de sa mère. Nous avons donné une magnifique fête en présence de nos parents et amis. C'était assurément l'une des plus belles que nous ayons jamais eues.
À cette époque, mon statut d'artiste nous donnait accès gratuitement au Grand Théâtre de Lyon, situé à deux pas de chez nous, où nous allions souvent, sur un coup de tête, passer nos soirées. Nous y passions de très bons moments. L'orchestre était excellent et les chanteurs, pour la plupart, de premier ordre. Outre le plaisir d'écouter de la bonne musique, il y avait aussi celui de converser avec le milieu artistique lyonnais, un milieu charmant et plein de vie, dont les échanges animaient l'entracte.
En hiver, l'un des divertissements à Lyon était le Salon de Peinture. Chaque année, j'y envoyais une toile. Pour les artistes, c'était un lieu de rencontre privilégié, surtout le vendredi, jour choisi par la Société Lyonnaise. Si l'art était intéressant à admirer, il était bien plus captivant pour un esprit observateur et philosophe comme le mien de regarder les gens et d'écouter leurs réflexions, plus encore que d'admirer les nouvelles œuvres. Que de mariages s'y sont formés ! La société des amateurs d'art qui se réunissait chaque année au salon offrait de nombreux services aux artistes, notamment l'achat de nombreuses œuvres exposées à un prix considérable. Les tableaux ainsi acquis étaient tirés au sort par les membres de la société. Nous avons participé et avons eu la chance de gagner deux toiles que nous avons ensuite revendues à un très bon prix.
En mai, nous sommes allés à Blandin et y sommes restés jusqu'en août. Nous devions ensuite passer quelque temps à Die, puis retourner à Blandin pour les vendanges. Nous sommes rentrés à Lyon vers la fin octobre. C'est alors que mes placements ont commencé à péricliter. Jusqu'en janvier 1877, j'en avais toujours été très satisfait. Mais à partir de ce moment-là, le gouvernement français s'est radicalisé. L'inquiétude s'est généralisée. Le taux de change n'était plus aussi stable qu'auparavant. J'ai subi des pertes et, pour la première fois, j'ai commencé à m'inquiéter sérieusement pour mes finances.
J'étais mal préparé à y faire face. Jusqu'à la mort de mon père, je n'avais jamais eu à me soucier d'argent. Il subvenait à mes besoins : logement, nourriture, chauffage et vêtements. Le peu d'argent que je gagnais ne servait qu'à assouvir mes plaisirs. Je n'étais pas habitué à la valeur quotidienne de l'argent. C'était une lacune béante dans mon éducation. J'aurais aimé prendre en charge mes finances après le baccalauréat. Certes, la maladie m'a freiné, mais peut-être alors ne me serais-je pas retrouvé dans une telle situation. Hélas, tel était le cas et il n'y avait rien à faire. Les résultats de fin de mois étaient de moins en moins prometteurs. Puis, une chute des prix, provoquée par un événement politique, m'a frappé de plein fouet et je me suis retrouvé lourdement endetté. J'ai tout abandonné et je me suis enfui comme un fou à Bois-le-Roi, en périphérie de Paris, où je ne désirais rien d'autre que mon pinceau. Ma chère épouse, dans ces circonstances difficiles, m'a beaucoup soutenu. Elle et mon beau-frère sont venus me chercher. Je suis tombée malade et j'ai été victime d'une attaque qui m'a laissée quelque temps avec une légère paralysie faciale. Mais grâce aux bons soins que j'ai reçus chez ma sœur, où j'ai été soignée, je me suis rétablie petit à petit.
Durant cette période, mon beau-frère a pris en charge mon entreprise et l'a liquidée dans mon intérêt. Je lui en suis très reconnaissant. Mais après ce désastre, il m'était impossible de conserver l'appartement lyonnais. Blandin est devenu notre domicile, mais ma sœur a eu la gentillesse de nous héberger près d'elle pendant les mois les plus froids de l'hiver. L'ancienne maison de mon père avait été rénovée et disposait désormais d'un petit appartement attenant, alors inoccupé. Nous pouvions y vivre sans peser sur ma sœur. Cela nous a permis de passer nos hivers à Lyon et de suivre de plus près la scène artistique et musicale qu'à Blandin.
Blandin avait ses propres attraits. Dès le début, nous avons entretenu d'excellentes relations avec l'abbé de Blandin et de Virieu, ainsi qu'avec le marquis et la marquise de Virieu, dont le château, sur l'autre versant de la vallée, offrait un superbe panorama sur la campagne environnante. C'était cette même vallée qui avait inspiré au poète Lamartine, ami intime du père du marquis, son célèbre poème « Le Vallon ». Virieu était au cœur du canton, à seulement quatre kilomètres de Blandin. Outre l'abbé, M. Perra, nous connaissions également le notaire, M. Humbert, le juge de paix, M. Billiez, et le docteur Groz. Un jour, en partant en vacances, nous avons rencontré M. et Mme Dugeyt et leurs nombreux enfants. Il y avait aussi Mme Fabre, sa sœur et leurs filles, amies de Gabrielle.
Avant de devenir abbé de Virieu, M. Perra était abbé de Blandin. C'est là qu'il se trouvait au moment du décès de mon père. C'est avec lui que j'avais organisé la création d'un nouveau cimetière à Blandin. L'abbé devait utiliser l'ancien pour agrandir le jardin du presbytère, plutôt que de laisser le village y construire un nouveau cimetière – Blandin était déjà assez grand ! J'ai réservé une place dans ce nouveau cimetière pour ma famille et moi. C'est un vaste emplacement qui sera exclusivement réservé à mes descendants à perpétuité. J'avais bien l'intention d'y faire transférer les dépouilles de mes parents, qui avaient été inhumés au cimetière de la Guillotière grâce à une concession de trente ans. Cette concession avait été renouvelée pour 1892 par ma sœur, mais devait expirer en décembre 1922.
Peu après notre mariage, M. Perra fut remplacé par M. Aubry, un homme très franc et ouvert. Mais il ne resta pas longtemps en poste. Au moment de nos difficultés financières, le Père Gautier lui succéda. Cet abbé ne me plut guère au début, mais avec le temps, je finis par l'apprécier et il devint un ami sincère et dévoué. Dans les moments les plus difficiles de notre existence, il perçut nos souffrances et nous témoigna sa profonde compassion. À cette époque, M. Perra et M. Gautier furent si bons, si dévoués et si réconfortants qu'ils devinrent et restèrent toujours nos meilleurs amis. Nous leur devons une gratitude éternelle, non seulement pour les bienfaits qu'ils nous ont prodigués par leurs actions, mais aussi et surtout pour les précieux enseignements qu'ils nous ont transmis.
Dès mon entrée au lycée de Lyon, et surtout après la fin de mes études, je suis devenu – par éducation ou par ignorance – de plus en plus indifférent à la religion. Je n'étais pourtant ni athée, ni irrévérencieux. Pourtant, la conduite des deux abbés et leurs paroles encourageantes furent comme une véritable révélation. Ils contribuèrent à dissiper le brouillard de l'indifférence qui m'avait envahi. Non que je sois devenu un saint – hélas, ma nature ne le permettait pas. Mais je me suis néanmoins engagé sur une nouvelle voie, et aujourd'hui j'en suis bien plus heureux. Seule la religion pouvait me donner force et réconfort face à ma douleur et à ma souffrance. Je ne pouvais plus faire semblant du contraire. Plus que jamais, je reconnaissais que tous mes malheurs et mes soucis étaient en réalité des expériences positives.
À onze kilomètres de Blandin, à Grand-Lemps, mon beau-frère possédait une entreprise de soie gérée par Paul Thévenot, un de mes jeunes cousins paternels. C'était un garçon très doux et plein de bonté. Il venait de se marier et, avec sa femme, ils étaient devenus d'excellents amis. Nous étions régulièrement invités à dîner, nous faisions de nombreuses promenades agréables à travers la campagne et passions de merveilleux dimanches après-midi ensemble.
Mes angoisses et mes inquiétudes, cependant, étaient loin d'être dissipées. Telles des vagues déferlantes, elles se succédaient, et souvent leur force s'intensifiait. Les vignes sur lesquelles j'avais tant compté étaient ravagées par le terrible fléau du phylloxéra qui avait déjà causé tant de dégâts dans le Midi. Une partie était déjà touchée. Nous savions qu'il nous fallait lutter.
Nous avons consacré beaucoup de temps et d'argent à essayer de nous défendre, mais les moyens de défense étaient encore mal connus. Au fil des ans, nos revenus ont diminué. Nous avons finalement dû mettre notre propriété en vente. Pour moi, ce fut un grand sacrifice, d'autant plus douloureux que je savais que je ne pourrais jamais récupérer mon investissement initial. En attendant un acheteur, j'ai tenté de me lancer dans la production de raisins secs, ce qui me semblait rentable compte tenu de la dévastation des vignes dans le Midi. Nous avons également accueilli des pensionnaires pendant l'été. Tout cela nous a permis de survivre un certain temps. L'espoir nous a toujours soutenus.
Le 29 août 1879, notre deuxième enfant, Ernest, est né. Nous étions à Martouret.
Après une petite fille, l'arrivée d'un petit garçon fut une joie immense. Nous étions comblés. Mais la naissance de Marcel, l'année suivante, le 22 octobre 1880, fut une surprise inattendue, du moins pas si tôt. Il fut néanmoins bien accueilli, même si cela posa quelques problèmes à sa mère, qui allaitait encore Ernest. Sa lactation cessa et nous dumes passer au biberon. Heureusement, nous avions encore notre vieille femme de ménage, Jeannette, qui s'était déjà occupée de Gabrielle et sur laquelle nous pouvions compter en cas de besoin. Cependant, Jeannette avait parfois un caractère exécrable, ce qui rendait difficile sa présence auprès d'enfants impressionnables. Après son départ, la garde des enfants la nuit me revint. Leur mère avait vraiment besoin de se reposer.
Si les enfants étaient parfois turbulents, ils étaient aussi merveilleux à côtoyer. C'est si amusant de les voir grandir, d'observer leurs différentes personnalités, de découvrir non seulement leurs petits défauts, leurs petites bêtises, mais aussi leurs qualités. Il n'y avait rien de plus charmant que lorsqu'ils ont découvert mes genoux, qu'ils ont doucement enlacés et caressés de leurs petites mains. Ils prenaient souvent le petit peigne dans la poche de mon gilet et le passaient dans ma barbe. Alors, je les taquinais avec un couteau de poche, que je faisais disparaître puis réapparaître, à leur plus grande surprise. Chaque soir, avant de me coucher, je les entendais murmurer, entre deux doux baisers : « Bonne nuit, papa ». Tout cela était merveilleux, mais cela n'a pas duré assez longtemps. Bientôt, l'école a commencé, et c'est ce qui est devenu ma préoccupation. Je dois dire que commencer leur scolarité n'a pas été une tâche particulièrement agréable pour moi.
Compte tenu de la position que j'occupais au pays depuis notre installation à Blandin, les résidents locaux souhaitaient me nommer conseiller municipal. Puis, ils m'ont offert le poste de maire. Cela ne me posait pas de problème, et je sentais que je pouvais être utile au pays en acceptant, car la situation politique se dégradait. La guerre contre le clergé et contre la religion s'était intensifiée, et les écoles étaient menacées. À Blandin, comme partout ailleurs, il y avait quelques éléments subversifs qu'il fallait surveiller de près afin d'éviter qu'ils n'exercent une trop grande influence sur la population. J'ai tout mis en œuvre pour protéger la communauté du fléau du radicalisme et de la franc-maçonnerie.
Lors des élections à la Chambre des représentants, qui eurent lieu la deuxième année de mon mandat, je pris ouvertement parti pour le candidat catholique contre le candidat officiel, M. Dubost, ancien huissier de justice à La Tour du Pin et aujourd'hui président du Sénat (encouragé par les francs-maçons, la politique lui avait ouvert les portes de la fortune). J'organisai une réunion publique à la mairie et m'efforçai de convaincre mes électeurs de mon point de vue sur les valeurs respectives des deux candidats. J'étais résolu à ne pas suivre le gouvernement dans sa lutte contre toutes les traditions françaises, ce qui nous aurait assurément conduits à la ruine morale et matérielle.
L'une des personnes présentes, au caractère bien trempé, s'empressa de résumer ma conversation avec le magistrat adjoint de La Tour du Pin. Je fus donc contraint de m'expliquer. Je répondis, car cela m'arrangeait et que je n'avais pas à dissimuler mon opinion sur le gouvernement. Mes propos, bien entendu, entraînèrent ma rétrogradation. Je rentrai chez moi comme simple conseiller municipal. Mais je fis tout mon possible pour que le prochain maire soit J.B. Poncet, un homme courageux, propriétaire terrien et agriculteur, que j'estimais beaucoup. Je savais qu'il dirigerait bien la mairie et qu'il travaillerait efficacement tant qu'il resterait à Blandin.
Un de mes plus beaux souvenirs de 1882 fut notre séjour d'un mois chez ma belle-sœur, Nini, à Saint-Pierre-d'Albigny. Cet été-là, nous avions loué Blandin à la famille Despinay de Lyon ; c'était le troisième été consécutif. Au début de l'été, nous sommes allés à Martouret. Puis nous avons passé le mois de septembre à Saint-Pierre, l'un des plus beaux endroits de Savoie. J'en ai rapporté plusieurs croquis. Ma belle-sœur venait d'épouser M. Brunier, alors banquier de Saint-Pierre. Ils habitaient un magnifique hôtel particulier, récemment restauré et très bien situé, où ils nous ont accueillis chaleureusement. Ils ont tout fait pour rendre notre séjour aussi agréable que possible, en organisant des réceptions intimes ou en nous faisant découvrir les magnifiques environs. Le vieux château féodal de Miolan, en particulier, a attiré mon attention : très bien conservé, il dominait la splendide vallée de l'Isère en contrebas, l'une des plus belles que je connaisse. Notre séjour à Saint-Pierre fut le seul que nous y ayons jamais fait. Lorsque la ruine s'abattit sur nous, elle détruisit la maison et brisa le mariage de ma belle-sœur.
En mars 1883, le petit Marcel n'était toujours pas sevré de sa mère, et celle-ci ne pouvait plus tenir longtemps sans risquer l'épuisement et sa santé. Sa mère, Mme Benoit, qui avait prévu de passer quelque temps à Paris, proposa que sa fille l'accompagne. C'était une excellente occasion, et elle accepta. C'était le meilleur moyen de mettre fin à la longue dépendance de Marcel envers elle. Malgré sa grande taille et sa force, il n'en souffrit pas le moins du monde. Les distractions du voyage eurent un effet bénéfique sur ma femme. À son retour, reposée et revigorée, Marcel était aussi heureux qu'Ernest et Gabrielle de revoir sa mère, et tous trois fêtèrent son retour. Il avait oublié le reste et ne demandait rien.
En novembre de la même année, je fus sélectionné pour siéger comme juré aux assises de Grenoble. Cela m'obligea à m'absenter de Blandin pendant dix jours, mais à part cela, ce ne fut pas contraignant. Je n'avais jamais eu l'occasion d'assister aux débats dans une telle juridiction, et bien qu'aucun événement sensationnel ne se soit produit, mon expérience de juré fut fort instructive.
Cette année encore, nous avons appris avec tristesse la mutation de notre cher ami, l'abbé Gautier. Il a été nommé aumônier du couvent Notre-Dame de Bon Accueil, qui gérait également un magnifique pensionnat pour jeunes filles. Situé à Estressin, près de Vienne, ce lieu, niché sur les hauteurs du Rhône, avec la vieille ville viennoise en arrière-plan, offrait un panorama d'une grande beauté.
L'abbé Gautier succéda à l'abbé Lagier. Ce dernier était un homme froid et autoritaire, d'emblée peu aimable. La jalousie qu'il semblait nourrir envers son prédécesseur nous le rendit hostile et nous causa même des difficultés, qui ne purent malheureusement être réglées que devant un tribunal, où il fut condamné. C'est à contrecœur que je portai l'affaire devant un tribunal. Jusque-là, nombre de mes amis étaient issus du clergé, et il m'était de toute façon insupportable de traduire un dignitaire religieux devant un tribunal civil. Quelque temps après le règlement de l'affaire, Madame Virieu s'efforça, par charité, d'apaiser les tensions entre nous. Mais nos relations ne purent jamais égaler celles que nous avions entretenues avec tous ses prédécesseurs.
À partir de ce moment, nos relations avec lui, jusqu'à notre départ pour le Canada, se limitèrent à de simples formalités sociales et aux questions relatives à son ministère et aux besoins de la paroisse – l'érection d'une statue de la Vierge Marie dans le village, par exemple. Il était absolument nécessaire que nous placions ce petit monument de manière à ce que les autorités locales ne puissent rien y toucher. Compte tenu de l'opinion générale de l'époque, il était fort probable que quelqu'un s'y soit opposé, ou, même s'il l'avait autorisé dans un premier temps, qu'il l'ait fait enlever par la suite. Pour éviter cela, je fis don à la paroisse de quelques mètres carrés de terrain en bordure du parc, juste en face de l'église. L'endroit était entouré d'un bosquet de sapins qui formait un joli coin ombragé où la statue de la Vierge se dressait admirablement. Ainsi, le monument était pleinement visible de tous, mais aucune autorité civile n'avait le droit d'y toucher.
En 1885, notre jeune Gabrielle avait presque dix ans. Il nous fallait commencer à penser à son éducation, très difficile à obtenir à Blandin. Notre excellent ami, l'abbé Gautier, était idéalement placé pour nous aider. Il obtint la coopération des religieuses de Notre-Dame, où il était aumônier, et il fut décidé que Gabrielle entrerait au couvent en octobre. Au nom de sa filleule, ma sœur me proposa la somme de 600 francs par an pour toute la durée de son séjour. Son grand-père, le docteur Benoît, offrit quant à lui de prendre en charge les leçons de piano que sa mère lui avait suivies depuis trois ans. L'aspect financier était ainsi réglé, comme nous l'avions souhaité.
Quand octobre arriva, notre chère petite fille entra à Bon Accueil. J'avais l'impression de repartir moi-même en pension. Mais elle souriait, et cela nous réconforta de la voir partir sans trop de souffrance. Pourtant, la séparation fut un peu difficile à accepter. Si j'avais pu choisir, j'aurais voulu vivre au plus près de mes enfants toute ma vie. Pourquoi la vie nous oblige-t-elle à être séparés ? J'ai toujours rêvé d'une famille unie, comme les cinq doigts d'une main, vivant sinon sous le même toit, du moins dans la même ville, s'aimant et se soutenant mutuellement, et se voyant chaque jour. Mais ce genre de famille se fait de plus en plus rare. L'éducation dispensée aux enfants est de plus en plus axée sur le développement de l'individu plutôt que sur celui de la famille. Heureusement pour moi, les séparations de ma famille n'ont jamais été très longues ni très éloignées, à l'exception d'Ernest.
Le temps passa et ma lutte contre la maladie qui ravageait nos récoltes se poursuivit. Les moyens de la combattre se précisaient d'année en année, mais ils n'en étaient pas moins coûteux. Il fallait aussi reconstituer les terres détruites afin de préserver leur valeur et de les rendre vendables, ce qui, malgré ma déception, était désormais inévitable. Au printemps 1886, une offre qui semblait sérieuse me fut faite. Je consultai ma sœur et mon beau-frère, qui m'avaient toujours soutenu dans ces moments difficiles et à qui j'aimais demander conseil. Ils comprenaient ma souffrance et pensaient qu'il valait mieux que je fasse un dernier effort pour sauver les vignes, dans l'espoir d'assurer des revenus futurs et de pouvoir rester. Ils proposèrent de prendre en charge la propriété pendant cinq ans et d'assumer toutes les responsabilités liées au traitement et à la restauration du vignoble. Ils offrirent même de racheter le terrain si, au final, les résultats étaient satisfaisants et que je souhaitais toujours le vendre. J'acceptai cette proposition avec enthousiasme. Elle me redonna espoir pour l'avenir et me soulagea grandement de mes soucis.
L'année suivante, 1887, fut marquée par le décès de ma belle-mère, Mme Benoit, décédée dix jours après une attaque cérébrale. Ma pauvre épouse fut profondément affectée pendant un long moment. Ce triste événement entraîna également un changement dans notre mode de vie. Avant le décès de Mme Benoit, nous passions plusieurs semaines par an à Martouret. Mais à partir de ce moment, mon beau-père demanda à sa fille de venir lui rendre visite pendant la saison des bains, remplaçant ainsi sa mère dans ses soins et lui offrant par la même occasion une petite compensation pour la tâche qu'elle s'était occupée. Cet arrangement, malgré quelques inconvénients, nous fut très avantageux. De 1887 à 1891, nous passâmes tous nos étés à Martouret. Pendant ce temps, ma sœur et mon beau-frère restèrent à Blandin.
La naissance de la petite Dieudonnée (Marie Louise), une surprise inattendue, fut accueillie avec joie. Cet heureux événement eut lieu le 27 février 1891, année du centenaire de la naissance de mon père.
Cette même année, mon beau-père, qui prenait de l'âge, décida qu'il en avait assez de gérer son cabinet, dont l'activité déclinait depuis quelques années. Il souhaitait le louer à un autre médecin, mais il semblait incapable de s'adapter à cette nouvelle situation. Cela engendra plus de soucis que de bénéfices. Ce revers nous contraria un peu. Même si les bénéfices n'avaient pas été importants, ils n'en étaient pas moins réels.
Un autre problème a rapidement suivi celui-ci. La cinquième année de notre collaboration avec mon beau-frère touchait à sa fin. Malgré un investissement important, les résultats furent décevants et il me conseilla de vendre la propriété. Cette décision fut à l'origine de certaines difficultés. Des malentendus engendrèrent des tensions entre ma sœur et ma femme. Il s'ensuivit une dispute que je regrette profondément, car si ma sœur et mon beau-frère avaient leur part de responsabilité, la mienne était bien plus importante. Je n'ai jamais douté de leur générosité à me proposer leur aide, même si leurs efforts n'ont pas été couronnés de succès. Je ne peux leur être moins reconnaissant sans devoir exprimer à maintes reprises ce regrettable constat : ils auraient pu et dû faire davantage.
En octobre de cette même année, 1891, Ernest et Marcel partirent pour les Pères Maristes de Saint-Chamond, que nous avait recommandés mon cousin Paul Bodart, alors directeur du Crédit Lyonnais à Saint-Étienne, tout près de Saint-Chamond. À leur arrivée, ils devaient préparer leur première communion, qui eut lieu l'année suivante et qui fut pour nous tous un motif de réjouissance. Gabrielle quitta le couvent du Bon Accueil et rejoignit ses frères à la maison, qui semblait désormais bien moins vide.
La vente de notre propriété ne pouvait plus être retardée, et j'étais moi-même très intéressé par sa vente. Nous évoquions notre intention de vendre à chaque occasion avec nos amis.
Que faire en France ? La décision de vendre la propriété m'a amenée à réfléchir à notre avenir en France en général. Honnêtement, je ne voyais aucun avenir : l'état de la société française me paraissait sombre et peu rassurant quant aux perspectives d'avenir de nos enfants. Des lois avaient été créées pour combattre tout ce qui touchait à la religion et à son enseignement. Les débouchés professionnels pour les enfants catholiques étaient de plus en plus rares ; ceux qui existaient étaient saturés et très concurrentiels. Tant de choses n'allaient pas en France que j'ai commencé à me tourner instinctivement vers l'étranger, où je pensais trouver un terrain propice à l'épanouissement de toute l'énergie de la jeunesse.
On parlait beaucoup de l'Algérie, mais l'avenir dans ce pays était encore trop incertain pour s'y aventurer, et son administration était sous contrôle français. On évoquait aussi Haïti. Si nous avions consulté le clergé, nous aurions sans doute trouvé une solution qui nous convienne ; mais le climat tropical représentait un obstacle insurmontable.
Finalement, l'abbé de Saint-Antoine, l'abbé Cusset, dont la sœur était supérieure du couvent et de l'école de Blandin, nous apprit que les Chanoines réguliers de l'Immaculée Conception, établis dans cette paroisse, possédaient également une maison à Notre-Dame-de-Lourdes, au Manitoba, au Canada. Ce pays, nous dit-on, avait un bel avenir et nous y trouverions assurément ce que nous cherchions. Je me mis aussitôt en quête d'informations sur le Canada. Plus j'en apprenais, plus mon enthousiasme grandissait. Au Canada, mes enfants pourraient grandir libres et indépendants, pourvu qu'ils soient volontaires et dynamiques. Nous n'aurions pas besoin de beaucoup d'argent, car la terre y était peu coûteuse et très facile à cultiver. Nos questions morales et religieuses y trouveraient également des réponses satisfaisantes.
Alors que nous rêvions de notre avenir au Canada, deux visiteurs arrivèrent, un père et son fils, qui semblaient d'emblée être des acheteurs sérieux. Ils l'étaient, mais leur offre était loin d'égaler celle que nous avions refusée cinq ans plus tôt. Néanmoins, nous n'étions pas en mesure de refuser. Le titre de propriété fut transféré rapidement et le nouveau propriétaire, M. Ballofay, devait prendre possession des lieux le 1er août 1892. Nous avions deux mois pour préparer notre immigration au Canada.
Le Canada étant devenu notre objectif, j'ai pensé qu'il serait judicieux que je m'y rende seul, afin de découvrir le pays par moi-même, d'évaluer les informations recueillies en France et de décider si un déménagement là-bas serait réellement avantageux. Pendant ce temps, ma femme et mes enfants auraient pu aller à Martouret m'attendre. Mais le destin en avait décidé autrement. Ma femme ne voulait pas que je parte seul. Alors, « Avec Dieu, partons ». Nous avons donc tenté notre chance sur une terre qui semblait presque trop belle pour être vraie.
Notre départ de Liverpool était prévu pour le 25 août 1892. Après avoir remis les clés au nouveau propriétaire, nous avons passé quelques jours à Grand-Lemps chez Paul Thévenot, où nous avons fait nos adieux à tous nos proches et amis avant de prendre le train pour Paris. Après deux ou trois jours passés dans la capitale, nous sommes allés à Anvers, puis de là à Liverpool, où nous avons embarqué à bord du Circassion, un navire de la compagnie Allan, qui nous a conduits à Québec.
Adieu la vieille France ! Nous étions dans le nouveau monde, au Canada. Deux jours de train à bord du Canadien Pacifique et nous serions à Winnipeg, notre destination. Quelles furent mes premières impressions ? Certes, le voyage ne fut pas des plus confortables. Mais l'excitation du déménagement, alliée aux nouveautés découvertes en chemin, contribua à nous distraire et à faire oublier les petits désagréments inévitables. Ce qui me frappa le plus, ce fut l'étrange mélange de civilisation et de sauvagerie, si différent de l'Europe. Cela nous rendit presque tristes. Je crois que si j'étais venu seul, je ne serais pas resté longtemps.
Au bout de quelques jours, cependant, ces sentiments s'évanouirent. L'espoir d'un avenir meilleur brilla comme un rayon au plus profond de mon cœur et illumina notre nouvelle patrie d'une manière inédite. Arrivés à Saint-Boniface le 10 septembre 1892, nous logeâmes chez Mme Jean, hôtelière, qui nous accueillit chaleureusement. Ernest et Marcel partirent aussitôt étudier auprès des pères jésuites, dont les cours avaient déjà commencé. Nous avions des lettres de recommandation de Monseigneur Perraut, évêque d'Autun, et de Monseigneur Ferra, évêque de Grenoble, pour Monseigneur Taché, évêque de Saint-Boniface. Ce dernier avait déjà été informé de notre venue par Dom Gréa, supérieur des chanoines réguliers de Saint-Antoine, que nous avions rencontré avant de quitter la France et auprès duquel nous avions croisé les jeunes Bernier et Dubuc, qui nous avaient donné des renseignements sur Saint-Boniface et le collège jésuite.
Nous étions impatients de rencontrer l'évêque, Monseigneur Taché. Malgré sa maladie, il nous reçut avec une immense chaleur. Il nous mit en contact avec l'abbé Cloutier, trésorier de l'archevêque, qui nous fit visiter les villages de Lorette, Saint-Pierre, Saint-Malo, etc. Nous fûmes ensuite envoyés chez l'abbé Perquis, responsable de la nouvelle paroisse de Fannystelle. Il nous fit découvrir les lieux, dont l'aspect nous plut immédiatement. Un petit groupe de jeunes Français du village nous accueillit chaleureusement. L'abbé Perquis, lui-même français, se montra très compréhensif dès le début. Nous eûmes également l'occasion d'acheter un terrain qui nous convenait parfaitement : il bordait le village et comprenait deux parcelles où M. Veronneau, le propriétaire, avait construit sa maison. L'église, la gare, la poste, l'épicerie et la laiterie étaient quasiment à notre porte. Il n'y avait qu'un seul problème : pas d'eau ! Mais on nous a dit qu'avec des réservoirs, des puits et des étangs, on pouvait facilement contourner cette difficulté.
Nous nous sommes installés là, et j'ai finalisé l'affaire avec M. Veronneau, qui a quitté le pays avec sa famille. À cette époque, Fannystelle n'existait que depuis trois ou quatre ans et ne comptait que six maisons, sans compter l'église, l'école, la laiterie, la forge et une grande écurie ayant appartenu à la comtesse d'Albuféra, qui, avec l'aide de M. Bernier, avait fondé Fannystelle. Sa ferme était occupée depuis le printemps par la famille Guyot. Au nord, à environ
À un mille et demi se trouvait une autre ferme, exploitée par la famille Painchaud. Plus à l'est, deux autres grandes fermes furent finalement achetées par M. Duflos. Une cinquième ferme, appartenant à la comtesse, était située à quatre milles au nord. À l'ouest du village se trouvait également la ferme de M. O. Coté, et à trois milles à l'est, celle de son père, M. P. Coté. C'était tout ce que Fannystelle offrait à notre arrivée. Une grande partie du territoire était marécageuse.
Habituée aux montagnes, l'immensité de ces plaines sauvages me rappelait la mer et m'a profondément impressionnée. Que de magnifiques couchers de soleil j'ai contemplés ! J'ai rapidement été conquise par la beauté de cette région.
La maison du village où avait vécu la famille Veronneau ne nous convenait pas vraiment. Je l'ai fait transporter par voie terrestre et elle est devenue une ferme. M. Cinq-Mars, qui avait pratiquement tout construit à Fannystelle, nous a proposé de nous bâtir une maison qui correspondrait davantage à nos goûts. En attendant la construction, nous avons emménagé dans une petite maison appartenant alors à M. Cinq-Mars et aujourd'hui occupée par M. Hébert. Nous y sommes installés le 15 octobre. Nous vivions avec nos malles et nos caisses éparpillées un peu partout, servant de chaises. Seul le piano, notre premier achat de meuble important au Canada, se détachait, si beau et tout neuf, au milieu de ce fouillis de bois brut. Le 23 janvier, nous avons enfin pu emménager dans notre nouvelle maison. Nous avions apporté quelques objets de décoration pour la rendre très agréable à vivre.
Nous sommes venus au Manitoba avec l'idée de nous installer sur ces terres, mais notre décision était empreinte de craintes liées à l'isolement. Dès notre première visite à Fannystelle, cependant, j'ai su que nous n'avions rien à craindre de ce côté-là. En effet, la paroisse de l'abbé Perquis et la petite colonie française à laquelle nous appartenions nous ont grandement aidés à nous acclimater pendant les deux ou trois premières années. Notre séjour à Fannystelle m'a rendu plus heureux que je ne l'avais été depuis très longtemps. Mais notre bonheur fut interrompu en janvier par la nouvelle du décès de mon beau-père, le docteur Benoit, survenu le 25 décembre 1892. Si cela s'était produit quatre mois plus tôt, notre destin en aurait certainement été bouleversé. Mais la volonté de Dieu est impénétrable et la Divine Providence nous guide là où elle veut que nous allions.
Après notre premier hiver – bien moins rigoureux que prévu, d'après ce qu'on nous avait dit – je suis parti pour Saint-Jean-Baptiste voir la famille Fréchette. J'ai pu acheter du bétail qu'il a ensuite amené avec lui à Fannystelle. Entre-temps, M. Cinq-Mars avait construit une grande grange pour les abriter. Mais ces animaux ont engendré toute une série de nouveaux problèmes. Il était encore trop tôt, cependant, pour prévoir le pire.
Le 23 octobre 1893, nous avons eu la joie d'accueillir parmi nous Thérèse, comme pour nous faire croire que nos dix dernières années n'avaient été qu'un rêve avant la naissance de Lillie.
L'hiver 1894 fut le début de nos premières déceptions. Les puits de la ferme étaient insuffisants pour abreuver les animaux. Un troupeau de vingt têtes de bétail, loué à deux Canadiens, Grasson et Dubé, qui séjournaient à la ferme de M. Duflos, me fut confié pour être nourri, faute de foin. Je dus m'arranger avec M. Allart (ou Allard ?) pour qu'il les héberge.
Gabrielle nous a ensuite quittés pour aller à Winnipeg afin de poursuivre sa carrière. Elle désirait ardemment y aller, mais notre séparation a été douloureuse pour moi.
L'étoile de l'espoir qui avait brillé si intensément au début de ma vie au Manitoba commençait rapidement à pâlir face à la dure réalité. Seules la première année et une partie de la seconde furent heureuses et confiantes. Tout le reste, jusqu'en 1902, fut empli de déceptions. Et pourtant, je n'ai jamais perdu espoir en un avenir radieux dans cette nouvelle terre. C'est pourquoi j'ai persévéré malgré tout. J'aurais dû abandonner les animaux et l'agriculture. Car mes prédictions étaient justes, et le temps l'a amplement confirmé. Mais pourquoi revenir sur ce passé ? Ce qui est fait est fait, et on ne peut le refaire. Avec le recul, on peut aller bien loin, et hélas, on ne peut prédire l'avenir. Je préférerais jeter un voile sur cette période et ne plus en parler. Car depuis lors, cette belle étoile d'espoir qui s'était éteinte pour moi s'est rallumée, et je la vois briller à nouveau, éclatante, au-dessus de mes enfants. Je suis si heureux, en ces derniers jours, de les voir réussir bien mieux dans leurs entreprises que je n'aurais pu le faire moi-même.
Il n'y a qu'une seule ombre, mais elle disparaîtra sans doute lorsqu'Ernest renouera avec les traditions familiales pour marcher au même pas que les autres. Je ne doute pas qu'ils l'auront tous fait.
J'espère qu'ils éprouveront la profonde satisfaction de trouver, à travers leur travail, avec la grâce de Dieu, ce que j'ai vainement cherché à leur offrir.
F. Mollot
18 juillet 1912